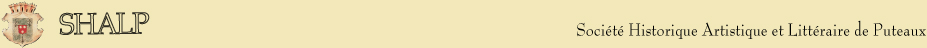
Littérature > Publications > Nouvelles > Témoignage
![]()
MIGRAINES
Par Marie-Louise ROUSSAUX dite MARYSE
Le milieu scientifique et une épidémie naissante tissent la toile de fond de ce roman presqu'autobiographique.
PREMIERE PARTIE
- I -
Une heure, deux heures, trois heures ont sonné au campanile de la chapelle de la Salpetrière. Frigorifiée, recroquevillée au fond de son lit, Evelyne grelotte de tous ses membres. Pourtant, le radiateur de la chambre diffuse une douce chaleur car, en cette fin de septembre où les soirées sont fraîches, l'appartement est chauffé. Insomniaque, la jeune femme s'agite, se tourne et se retourne, cherchant en vain une position qui soulagerait son corps meurtri. Sa tête prise en traître par une migraine épouvantable ne lui laisse aucun répit. La douleur s'amplifie jusqu'à atteindre son paroxysme quand, soudain, la maison apparaît.
Elle la voit surgir du néant. Issue du plus profond d'elle-même, comme inventée pour satisfaire son imagination débordante. C'est une grande maison blanche et carrée qui offre l'aspect massif et cossu des constructions de jadis. La toiture en ardoise et les murs envahis par le foisonnement d'une vigne vierge, d'un lierre ou d'une clématite lui confèrent un air de noblesse. Les quatre ou cinq marches du perron aux pierres descellées mènent à une porte dont le vantail supérieur s'orne d'une grille en fer forgé doublée d'un vitrage qui laisse pénétrer dans l'entrée une lumière tamisée.
Elle en connaît les larges fenêtres aux volets peints en vert bouteille, les rideaux de percale amidonnée d'une blancheur immaculée, la grosse lucarne du grenier, gros oil-de-bouf tout rond. Plus flou, le contour exact de la marquise, vestige des années trente, lui échappe.
Obsession des soirs de déprime. Combien de nuits, comme cette nuit, n'a-t-elle pas déjà accordées à cette demeure, la remodelant à l'infini, s'obstinant à tout visualiser, à tout inventorier dans les moindres recoins, dans les moindres détails, incapable de résister à cette manie obsédante. Elle ira jusqu'à l'épuisement. Les images, que son esprit malade lui impose, se répètent identiques d'une fois sur l'autre.
Voici l'entrée, vaste avec un large escalier. Ce soir, les marches en chêne ciré (aïe ! l'odeur de térébenthine est insupportable !) sont recouvertes au centre d'un épais tapis fixé par des tringles dorées. Le long du mur lambrissé, oscille une corde tressée maintenue par des anneaux en laiton comme dans les coursives des navires.
Soudain, Evelyne se sent mal. L'odeur trop violente de la cire lui donne envie de vomir. Elle doit se lever, c'est impératif ! Elle marche à tâtons dans l'obscurité car elle doit à tout prix éviter la lumière. Vite. Vite. L'état nauséeux la submerge, l'inonde. Ses tempes battent la chamade. Elle se libère, l'estomac révulsé. L'effort fourni l'épuise. Elle s'écroule sur la moquette de la salle de bains, ramassée sur elle-même comme une bête malade. Ce n'est que plus tard, qu'elle parviendra, encore titubante, à regagner son lit. Nuit sans sommeil. Une courte rémission lui est accordée. Incorrigible, elle la met à profit pour revenir à la charge avec ce petit bureau du rez-de-chaussée.
Ici, tous les morceaux du puzzle sont ancrés dans sa tête. Tout se déroule dans un ordre parfait, sans fatigue. Face à la fenêtre : la table de travail, fonctionnelle avec beaucoup de tiroirs, sobre avec des pieds droits, luxueuse avec un dessus incrusté de cuir. Près de la cheminée en marbre rose surmontée d'un trumeau rococo, deux petits fauteuils aux couleurs fanées. Les éclairages sont discrets : une lampe bouillotte sur le bureau, un lampadaire près des fauteuils, un plafonnier blafard et une fine opaline sur la bibliothèque qui, plus large que haute, occupe le panneau opposé à la fenêtre. Sur le parquet aux lames disjointes mais fleurant bon l'encaustique (attention la nausée revient ! Vite, penser à autre chose !), un tapis d'Orient, sans doute l'investissement onéreux d'une arrière-grand-mère au siècle dernier. Tout est en ordre. Elle n'a rien omis. Ultime faveur : elle allume un feu dans la cheminée.
Sous les couvertures, Evelyne retrouve un peu de chaleur. Son corps se détend. Le calme revient et la douleur qui envahissait son cerveau tend à disparaître. Mais la maison est encore présente. Elle en voit l'entrée qu'elle voudrait parfaite, accueillante, un endroit où l'on se sentirait tout de suite à l'aise. Elle voudrait. mais hélas ! trop épuisée, son imagination l'abandonne comme si meubles et bibelots refusaient obstinément de lui obéir. Echappée la grosse commode aux faces rebondies, aux angles arrondis, aux ferrures ciselées et au plateau patiné par l'abus ancillaire du chiffon à ménage. Envolés les sièges Louis XIII, les vases, le portemanteau et le porte-parapluies.
Ambiguïté désarmante ! Tous ces objets qui se télescopent dans sa tête, Evelyne ne les supporte qu'en rêve, immuables, incassables, inaltérables, toujours neufs dans leur éternelle fraîcheur.
Refus du temporel ? Phobie de l'usure du temps ? Cinq heures du matin. La maison sans âge disparaît enfin. Un sommeil lourd et peu réparateur finit par avoir raison de la jeune femme. Elle dort. mais au réveil aura-t-elle cette fois le courage d'avouer à Jacques cette nouvelle crise ?
- II -
Une Evelyne avait rencontré Jacques, quelques mois plus tôt, alors qu'elle suivait un stage d'informatique. Très vite, ils s'étaient sentis solidaires, face à un ordinateur toujours prêt à leur jouer des tours.
Peu à peu, ils avaient fini par prendre l'habitude de se retrouver après les cours pour échanger leurs impressions autour d'une tasse de café. Bref, le goût du verbe et le besoin de dialoguer les avaient rapprochés. En fait, c'était surtout Jacques qui parlait. Avocat, il avait pour habitude d'alimenter la conversation. Logorrhéique impénitent, il parlait haut sans reprendre son souffle laissant peu de chance de s'exprimer à son interlocuteur. De fait, Evelyne se contentait d'écouter, saoulée par son débit.
En vérité la vie d'Evelyne avait été bouleversée par sa rencontre avec Jacques. Lui si dynamique que pouvait-il trouver d'agréable en sa compagnie ? Elle si insignifiante ! Au début elle s'interrogea puis, sans bien savoir comment, elle avait accepté que leurs relations amicales débouchent sur des liens plus intimes.
La jeune femme qui avait toujours vécu seule et qui prétendait que l'approche de la quarantaine ne l'effrayait pas, avait enfin concédé à Jacques le droit de bousculer son train-train de célibataire. Elle reconnaissait volontiers qu'elle avait été séduite par son élégance décontractée, ses allures bon enfant et son optimisme résolu. Par une certaine gentillesse aussi. Et enfin par sa profession d'avocat qui avait beaucoup excitée sa curiosité. En réalité, chez Jacques, la pratique du barreau, n'avait fait qu'exacerber des caractéristiques inscrites dans son génome. Il fallait voir avec quelle verve et quelle assurance il défendait une cause ! L'entendre asséner avec aplomb des assertions péremptoires qui mettaient à chaque fois la partie adverse en difficulté était un régal. L'auditoire, plus au théâtre que dans un prétoire était sous le charme. Jacques gagnait souvent ses procès. Aussi, avait-il de plus en plus tendance à se montrer arrogant ce qui ne manquait pas d'irriter ses confrères.
Jacques était divorcé. Il parlait peu de sa vie conjugale. Les rares fois où il avait abordé le sujet devant Evelyne il s'était contenté, plutôt évasif, de mettre sa séparation sur le compte des aléas de la vie et de la routine qui, affirmait-il, finit toujours par s'installer un jour ou l'autre au sein d'un couple.
Depuis son divorce, Jacques louait rue Monge, à deux pas des Arènes de Lutèce, l'appartement d'un ami parti pour deux ans en Australie. Le hasard faisait qu'Evelyne habitait à proximité puisque, l'an passé, elle s'était décidée à acheter un studio dans un immeuble qui venait de se construire rue Buffon et qui bénéficiait d'une agréable vue sur le Jardin des Plantes. Mais si Jacques aimait s'entourer de beaucoup d'amis et faire la fête tard le soir, au grand dam de ses voisins auxquels il offrait régulièrement des fleurs ou des chocolats pour se faire pardonner, Evelyne ne recevait que bien rarement. En ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, ils étaient les deux extrêmes. Mais sans doute parce qu'il est bien connu que les extrêmes s'attirent, Jacques avait été séduit par le charme discret de la jeune femme. Elle avait une personnalité qui l'étonnait. Peu expansive et d'apparence plutôt timide elle avait cependant des audaces imprévisibles qui le surprenaient. D'une certaine manière, bien qu'il s'en défendit, il avait été intrigué par son statut de chercheur au CNRS. En l'écoutant, il avait pénétré dans un monde dont il ignorait tout jusque-là. Stupéfait, il découvrait l'univers feutré des laboratoires de recherche où des obstinés, pour des salaires peu attractifs, s'acharnent sans relâche, consacrant leur vie à une véritable quête du Graal. Biologiste, Evelyne avait tenté à maintes reprises de l'initier à la rigueur scientifique, se moquant volontiers de la soi-disant rigueur juridique dont il faisait grand cas. C'était devenu entre eux un sujet favori de discussion. Lui qui aimait la controverse la poussait dans ses retranchements. Alors, à son tour, elle se défendait avec vigueur. Alors il riait et acceptait le plaidoyer sans toutefois se laisser convaincre.
Depuis sa rencontre avec Jacques, Evelyne avait le sentiment d'aller mieux. Ses symptômes avaient tendance à s'estomper. Ce n'était plus comme avant où elle pouvait rester prostrée des nuits entières, sans pouvoir bouger, incapable de lutter contre la crise migraineuse qui la terrassait. Dans ces moments-là, aboulique, elle devenait amorphe, obsédée par toutes sortes de phobies, impuissante devant l'effort à fournir pour se sortir de là. Dans les cas extrêmes, elle se réfugiait dans un besoin maniaque, une sorte de pulsion créatrice, d'inventer des décors sophistiqués, angoissée à l'idée de ne pas trouver le détail qui convient, la tête pleine d'images qui se télescopaient à une vitesse folle.
Jacques ne l'avait jamais vue dans cet état de prostration. Elle avait tenté plusieurs fois de lui expliquer ce qu'elle ressentait mais lui, sceptique, avait du mal à la croire. Il avait plutôt tendance à minimiser ce qu'elle lui racontait, plus ou moins persuadé que la plupart du temps elle fabulait. Pour lui, c'était évident, une femme aussi pondérée et aussi calme ne pouvait pas être à ce point déséquilibrée. Une névrose chez Evelyne ? Jamais de la vie ! Juste un petit grésillement des neurones lorsqu'elle était fatiguée.
Et puis, un jour, Jacques se rendit à Lausanne pour affaires. Evelyne resta seule à Paris. Au début, elle trouva agréable de profiter de ce qu'elle appelait sa liberté retrouvée. Elle téléphona à quelques relations qu'elle avait perdues de vue, s'abreuva des films qu'elle s'était promis de voir et s'autorisa même à visiter deux ou trois expositions.
Jacques lui téléphonait tous les jours. Au début il lui proposa de venir le rejoindre à l'occasion d'un week-end. Mais, très vite repris par ses dossiers et par la préparation de ses plaidoiries, il lui fit comprendre que ce n'était pas une bonne idée. Au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, il lui paraissait de plus en plus lointain, toujours pressé, peu disposé à l'écouter. Au téléphone elle avait remarqué qu'il commençait toujours par se racler la gorge avant de lui parler. Ce tic avait fini par l'énerver. A chaque fois qu'elle entendait la sonnerie retentir elle hésitait, stressée à l'idée de décrocher. Jacques avait beau lui expliquer que ce n'était qu'un rhume récalcitrant, elle ne voulait pas le croire. Elle se montait la tête. Après la toux, elle n'entendait pas ce qu'il lui disait tellement elle était tendue, au bord des larmes.
- Allô ! Comment vas-tu aujourd'hui ?
- .
- Allô ! Je n'entends pas ce que tu dis. S'il te plait parle plus fort.
- .
- La ligne est mauvaise. Evelyne je crois bien que nous allons être coupés alors je t'embrasse et c'est promis je t'appelle sans faute demain soir.
Il raccrochait. Elle s'effondrait en pleurs. Il ne voulait plus d'elle, il la repoussait. Voilà pourquoi il toussotait.
Jacques ne se doutait de rien. Comment aurait-il pu, il est vrai, deviner à distance ce qui se passait dans la tête d'Evelyne ? D'autant que l'évolution de son état avait été des plus insidieuses. Les premières crises avaient été entrecoupées de périodes de rémission. Ensuite, elles s'étaient rapprochées au point de ne lui laisser que de rares moments de répit. Dans la journée, au laboratoire, les choses allaient à peu près. C'étaient peut-être les heures passées à son travail qui étaient les plus supportables. Sans doute parce que ses préoccupations professionnelles l'obligeaient, sur l'instant, à faire passer au second plan ses problèmes personnels. Mais, le soir, quand elle rentrait chez elle, Evelyne s'écroulait de douleur. Des maux de tête le plus souvent. Une oppression dans la poitrine, parfois. Et toujours cette obsession lancinante qui ne la lâchait plus. Enfermée dans son studio, refusant toute invitation, elle traquait le plus petit grain de poussière sur les meubles, passant et repassant le chiffon à ménage. Elle faisait la guerre aux sanitaires douteux, ternes ou entartrés. Elle frottait, lavait, relavait la plus petite tache aperçue sur la moquette. Elle vérifiait verres et couverts, à l'affût de la moindre trace de calcaire et les essuyait plusieurs fois avant de les ranger. Pour ne plus salir de vaisselle elle avait fini par acheter des plats cuisinés qu'elle mangeait, quand elle avait un peu d'appétit, à même l'emballage sans prendre la peine de sortir une assiette. Et ce sans parler des nuits blanches où l'imaginaire et l'état nauséeux la dominaient toute.
Jacques revint un mois plus tard. Silhouette menue dans une veste de fourrure, Evelyne l'attendait à l'aéroport. On était fin octobre, elle frissonnait de la tête aux pieds. Lui, tout à la joie de la revoir ne remarqua ni sa maigreur ni ses yeux cernés. Assis dans le taxi qui les conduisait vers Paris, il lui raconta son dernier procès, content de lui et parfaitement inconscient du drame qui couvait à ses côtés. Elle tint bon jusqu'à leur arrivée chez lui où, à bout de nerfs, elle s'écroula en sanglots dans ses bras.
- III -
Jacques avait tout comploté sans la prévenir.
- Juste pour me faire plaisir, avait-il dit au téléphone et, comme elle se montrait réticente, il avait ajouté avant de raccrocher : tu verras Clément est vraiment un type sympathique. Il te plaira !
A vrai dire, Evelyne ne cherchait pas à tout prix la compagnie des autres. Souvent, sans aucune fatuité, elle trouvait la plupart des gens ennuyeux.
Quant à Clément que Jacques voulait lui présenter, elle avait déjà, sans le connaître, un a priori défavorable à son égard. On le disait bizarre. Un psy bizarre et très en vogue. Un psy, homosexuel de longue date et quadragénaire. Un psy qui, installé dans le quartier branché du Marais, rue des Franc-Bourgeois, exerçait ses talents d'analyste sur cette clientèle parisienne très particulière que constituaient, dans le début des années 80, des intellectuels nostalgiques de mai 1968, des femmes faussement libérées et des fils à papa mal dans leur peau.
Clément n'avait jamais été un élément brillant. Après de médiocres études de médecine, son père, ancien ministre de la santé, n'avait pas hésité un instant, grâce à ses importantes relations, à le pistonner ce qui lui avait permis de réussir sans difficulté dans une spécialité en plein essor.
Myope au visage poupin - à l'hôpital où il avait traîné ses guêtres d'étudiant en psychiatrie, les infirmières l'avaient surnommé poupinate de valium - Clément se trouvait laid. Complexé par une taille modeste, il collectionnait les boots à talons et réclamait à son coiffeur des brushings vaporeux. Son seul atout, disait-il, était sa voix qui, il est vrai, était très mélodieuse.
Issu d'une famille aisée où les affaires et la politique nourrissaient toutes les conversations, Clément ne s'était jamais senti très attiré par la vie mondaine que menaient ses parents. Très tôt, il s'était tenu à l'écart, sans vraiment le renier, du milieu où il avait été élevé. On le voyait peu fréquenter les endroits « in », cafés, restaurants, théâtres, boîtes de nuit à la mode où écrivains, politiciens, peintres, cinéastes, journalistes. artistes en tout genre évoluaient à heure fixe dans l'espoir d'être aperçus, reconnus, salués. Pourtant, à sa manière, il ne dédaignait pas un certain exhibitionnisme puisque, passionné d'art dramatique il avait créé, avec son ami attitré Jean-Lou, un comédien pointant la majorité du temps à l'ANPE, une petite école de théâtre, rue Saint-Louis-en-l'Isle.
C'était là, au fond d'une cour, que Jacques avait décidé d'emmener Evelyne un soir de répétition.
Les deux hommes s'étaient connus deux ans plus tôt lors d'un procès qui avait fait grand bruit dans les journaux. Une affaire sordide. Une femme accusée d'avoir étranglé sa mère infirme. Jacques assurait la défense et Clément l'expertise psychiatrique.
Dès qu'il vit Jacques, Clément fut bouleversé. Séduit. Tout en lui l'attirait : sa prestance, son éloquence, sa démarche, sa manière de plisser les yeux lorsqu'il voulait convaincre son auditoire et aussi cette façon bien à lui de rejeter la tête en arrière comme pour chasser une hypothétique mèche rebelle.
Pendant tout le procès il ne le quitta plus des yeux. Chaque jour, il venait à l'audience et se repaissait de celui dont il venait de s'éprendre. Yeux bleus, cheveux bruns. Grand. Elancé. Splendide dans sa robe d'avocat. La perfection sur terre. Peu à peu Clément ne vécut plus qu'au travers de Jacques. Toute sa vie en fut perturbée. L'enfer pour un amour impossible.
Quant à Jacques, quel ne fut pas son étonnement quand il réalisa que Clément lui courait tout bonnement après. Un nabot, le poursuivre de ses ardeurs ! La découverte était de taille : voilà que maintenant il attirait les homosexuels ! Son premier réflexe fut d'envoyer promener Clément. De le mépriser. Et puis bizarrement, il en vint à se prendre de sympathie pour ce petit bonhomme qui ne cessait de se mettre en quatre pour lui plaire. N'était-ce pas grâce à lui qu'il avait obtenu une peine légère pour sa cliente ? Deux ans de prison avec sursis. La déposition de Clément avait été déterminante et Jacques en avait récolté tout le bénéfice.
Par ailleurs, être admiré n'avait rien de déplaisant. Jacques habitué aux compliments était flatté que quelqu'un ne tarisse pas d'éloges à son sujet. Le psychanalyste très en vue, ce qui n'était pas négligeable, se chargeait de lui faire une excellente publicité. A la réflexion, s'afficher avec Clément, pas trop mais juste ce qu'il fallait pour servir sa carrière d'avocat. Jacques reconnaissait même que par certains côtés il était plutôt plaisant. Une pointe d'humour par-ci par-là pouvait rendre sa conversation distrayante. Certes, ses idées étaient assez particulières et il les exprimait d'une manière si emphatique que le plus souvent cela prêtait à rire. Toutefois, dans l'ensemble, Jacques trouvait la compagnie de Clément très supportable.
Ce fut ainsi, qu'après le procès où ils avaient fait connaissance, les deux hommes continuèrent à se voir. Ils se donnaient rendez-vous pour déjeuner ou bien pour aller visiter une exposition. Et puis, de temps à autre, Clément conviait Jacques à venir assister à l'une des répétitions de sa fameuse troupe. C'était pour lui un moyen d'attirer Jacques. Celui-ci n'était pas dupe mais par amusement il acceptait.
Et ce fut ainsi qu'Evelyne découvrit, quelques jours plus tard, Clément à quatre pattes, mordant la poussière, grotesque mais sublime dans le rôle d'Ubu roi. Il était entouré de jeunes comédiens déclamant leur texte les yeux rivés sur Jean-Lou qui, transformé en metteur en scène, les guidait et leur montrait par des gestes précis ce qu'il attendait d'eux.
Evelyne qui n'aimait pas beaucoup l'art théâtral, les jugea d'emblée ridicules. Effarée, elle se tourna vers Jacques :
- Vraiment je plains les spectateurs des maisons de retraite, des hospices et autres établissements où, faute d'un autre public, ils se produisent. Ils sont mauvais et ton Clément encore plus que les autres !
- Tu es bien sévère. Clément a du talent. Bonne diction, geste sûr, domination du texte. que veux-tu de mieux ?
- Je ne sais pas, mais pour une fois je te trouve bien indulgent. As-tu soudain perdu tout sens critique ? Ce type ne casse pas trois pattes à un canard ! Ne me dis pas que tu ne t'en rends pas compte. Alors pourquoi le défends-tu ?
En vérité si Jacques défendait Clément ce n'était nullement par pure bonté d'âme. Si Evelyne avait un tant soit peu réfléchi, elle aurait compris où Jacques voulait en venir. Celui-ci, depuis son retour de Suisse, ne lui avait-il pas laissé entendre, à maintes reprises, qu'elle devrait entamer une analyse. et en lui faisant rencontrer Clément il espérait bien la décider. Mais, à première vue les choses se présentaient assez mal.
Après la répétition ils se retrouvèrent dans un café du quartier pour prendre un verre. Jacques présenta Evelyne à Clément. Tous deux se serrèrent la main sans aucun enthousiasme.
Clément qui ne souhaitait qu'une chose : se retrouver seul avec Jacques manifesta sa mauvaise humeur. Pas une seule fois il s'adressa à Evelyne, l'ignorant totalement. De son côté, celle-ci, assise en face de lui, avait du mal à se contenir. Un goujat voilà ce qu'il était ! S'il n'aimait pas les femmes il pouvait au moins se montrer poli avec elles ! Evelyne faisait fausse route. Car ignorante des sentiments que Clément éprouvait pour Jacques il lui était impossible de comprendre son attitude. Qu'aurait-elle pensé si elle avait su la vérité ?
De cette rencontre, seul Jacques se montra assez satisfait. Certes, il en espérait plus mais l'essentiel était quand même d'avoir posé les premiers jalons du projet qui lui tenait à coeur.
- IV -
Novembre frayait son chemin dans le square à l'ombre de Notre-Dame où seuls quelques pigeons et touristes égarés piétinaient les feuilles mortes éparpillées par le vent. Appuyé contre le parapet matelassé d'un lierre noueux, Jacques contemplait, en contre-bas, l'étroit bras de Seine où un bateau-mouche passait au ralenti devant les flancs majestueux du monstre sacré qui le dominait.
Jacques attendait Clément. Midi sonnait quand il aperçut sa courte silhouette se profiler au loin. Vêtu d'un ample loden sur lequel était jetée une longue écharpe en laine blanche, il avançait à pas rapides de peur d'être en retard. Clément venait du sauna de la rue de Pontoise qu'il fréquentait chaque dimanche matin. Les massages, disait-il, non sans un certain humour, le mettaient toujours en appétit !
Profitant d'un léger rayon de soleil, les deux hommes gagnèrent à pied le carrefour Saint-Michel puis allèrent par les rues Saint-André-des-Arts et de Buci qui, désertes comme tout le quartier en cette fin de matinée dominicale, incitaient les rares passants à flâner.
Ils étaient convenus de déjeuner chez Lipp, boulevard Saint-Germain. Clément, habitué de la maison, avait retenu une table au rez-de-chaussée. A cette heure, la brasserie ne comptait que quelques clients. Ce qui leur permit de s'installer sans courir le risque d'être dérangés.
La commande passée (pieds de cochon farcis pour Jacques et feuilleté aux pointes d'asperges pour Clément) ils abordèrent enfin la question pour laquelle, en réalité, ils s'étaient donnés rendez-vous.
Il s'agissait d'Evelyne. D'une éventuelle psychanalyse. Jacques alla droit au but. Clément devait prendre Evelyne en charge. Interloqué Clément se défendit :v
- Tu sais très bien que je suis obligé de respecter un minimum de règles. Pas d'.
- Oui, je sais, coupa Jacques qui ne connaissait que trop bien le refrain habituel :
« pas d'interférence entre la vie professionnelle et la vie privée »
Et d'ajouter :
- D'ailleurs Evelyne est pour toi une parfaite inconnue alors je ne vois pas où est le problème.
- Toi je te connais et.
- Je n'ai rien à voir avec la névrose ou la psychose d'Evelyne, appelle ça comme tu veux. Et ce n'est pas parce que j'ai une liaison avec elle.
- Tu as tort. Que tu le veuilles ou non, tu es impliqué dans cette affaire.
- N'exagérons rien veux-tu !
- Je n'exagère pas. Il existe souvent des situations qui se révèlent beaucoup plus complexes qu'on ne les imaginait au départ. On ne sait jamais à l'avance comment une analyse peut évoluer. J'essaie seulement de te mettre en garde voilà tout.
- Alors tu refuses de t'occuper d'elle ?
La discussion devenait tendue car chacun campait sur sa position.
D'un côté, Jacques, décidé à l'emporter, faisait pression sur Clément sans aucun état d'âme. En bon stratège il savait pertinemment que les sentiments que celui-ci éprouvait pour lui était son meilleur atout. Puisque Clément l'aimait qu'attendait-il pour lui rendre ce service ? De l'autre, Clément, mis au supplice : la vie d'Evelyne, le travail d'Evelyne, la maladie d'Evelyne. Jacques ne parlait plus que de cela. Et voilà que maintenant, en plus, il voulait qu'elle s'allongeât sur son divan. Etait-il devenu fou ou bien inconscient des conséquences qui pouvaient en découler ?
Ils finirent leur repas par une tarte aux myrtilles suivie d'un café et d'un cognac, presque en silence chacun dans sa bulle.
Les premiers promeneurs de l'après-midi faisaient leur apparition quand ils quittèrent le restaurant. Jacques, avant qu'ils ne se séparent, revint à la charge une fois encore :
- J'aurais aimé que tu la reçoives juste pour la conseiller. Tu sais elle est un peu paumée.
Qu'elle soit paumée Clément s'en moquait. Que cette fille aille au diable ! Cependant face à Jacques il se domina :
- Tu veux que j'aie une sorte de pré-entretien avec elle, c'est ça ?
- Oui.
- Et après ? Je l'envoie chez un de mes confrères ? Alors autant que je te donne tout de suite une ou deux adresses. Mais à propos elle n'a jamais consulté ?
- Je ne crois pas. Evelyne est très repliée sur elle-même, elle ne se livre pas facilement je peux te l'assurer. Permets-moi d'insister.
- Justement si en plus elle apprend que c'est toi qui as insisté pour que je la reçoive, le jour J elle ne sera pas très à l'aise et moi non plus.
- Juste une fois, je t'en prie. Fais-le pour moi.
L'insistance de Jacques devenait insupportable. Clément finit par céder :
- D'accord juste une fois. Mais ne t'attends pas à ce qu'il en sorte grand chose !
Jacques haussa les épaules. Il serait temps d'aviser par la suite. Dans l'immédiat il avait obtenu ce qu'il voulait.
Ils se séparèrent place de l'Odéon.
Clément s'en voulait d'avoir cédé. Il n'avait pas eu le courage de dire non. Jacques l'avait manouvré et maintenant il se reprochait de ne pas lui avoir tenu tête. Au fond de lui-même il savait très bien que les prétextes qu'il avait donnés étaient fallacieux. La vue d'Evelyne assise l'autre jour aux côtés de Jacques l'avait rendu fou. Fou de jalousie. S'il n'y avait pas eu cette jalousie qui le dévorait, rien n'aurait empêché qu'Evelyne devienne sa patiente. Mais Evelyne était sa rivale. Image intolérable qui le poussait au pire. La broyer, en faire une loque humaine que Jacques fuirait. Idée diabolique facile à réaliser. Il suffisait d'accepter d'être son analyste et de la manipuler. A la seule idée d'envisager un tel scénario Clément avait honte de lui. Son amour pour Jacques lui faisait perdre la tête. Il devait se reprendre.
De retour chez lui, Clément se heurta à Jean-Lou. Les deux hommes vivaient ensemble depuis quatre ans. Leur couple n'avait jamais été à l'abri d'infidélités passagères mais cahin-caha il perdurait. C'était surtout Jean-Lou qui entretenait des liaisons avec d'autres partenaires. Clément, plus réservé, se contentait le plus souvent de prendre les choses avec fatalisme. Jusqu'à sa rencontre avec Jacques. A partir de ce moment-là il devint odieux. Cherchant la moindre peccadille, il déclenchait des disputes à tout bout de champ. Désormais leur fréquentes scènes de ménage faisaient la risée de tous ceux qui les connaissaient. Jean-Lou qui n'en pouvait plus confiait son désarroi à qui voulait l'entendre tandis que de son côté Clément passait son temps à dénigrer haut et fort son ami.
Parfois, pris de remords Clément se calmait et, prenant Jean-Lou à témoin. Il lui confiait, sans aucune pudeur, son amour pour Jacques. Il pouvait en parler des heures entières. Jean-Lou acceptait de l'écouter espérant encore sauver leur couple. Puis, Clément pour se faire pardonner acceptait de s'abandonner aux caresses d'un partenaire qu'il ne désirait plus.
Une fois encore Clément rentrait de mauvaise humeur. La tête des mauvais jours.
- Jacques m'a demandé de psychanalyser sa greluche.
- La fille qui était avec lui l'autre jour ?
- Oui, Evelyne.
- Et tu as accepté ?
- Non
- Ah bon ! Pourquoi ?
- Tu demandes pourquoi ! Pauvre idiot.
C'était parti. Clément, devant le calme de son ami, ne se maîtrisait plus.
Une rage violente l'envahit :
- Tire-toi ! Fous le camp ! J'ai besoin d'avoir la paix comprends-tu ?
- Mais.
- Fous le camp je te dis. Reviens plus tard ! Je suis sûr que ça te fait jouir de me voir dans cet état. Avoue-le !
- Tu dis n'importe quoi. Bon je te laisse. Préviens-moi quand tu seras calmé. Entre nous cette histoire ne vaut pas la peine que tu te mettes dans tous ces états.
- Fous le camp !
Jean-Lou parti, Clément resta seul avec sa hargne.
- V -
Tandis que Jacques et Clément déjeunaient chez Lipp, Evelyne restée chez elle, faisait du rangement. Une façon de calmer ses nerfs. L'idée de Jacques ne lui plaisait pas et elle ne s'était pas cachée de le lui dire :
- Si je dois suivre une analyse ce ne sera pas avec Clément. Il est peut-être très bon thérapeute mais il me déplait.
- C'est ridicule. Je le connais alors autant que tu ailles chez lui. Moi je lui fais confiance ! Il te sortira de là.
Que répondre à de tels arguments ? Désormais sa seule chance était que Clément refusât de la prendre en charge.
Pour l'instant elle ne voulait plus y penser et mettait à profit ces quelques heures de tranquillité pour faire l'inventaire de sa penderie. Trier les vêtements dont elle n'avait plus l'usage était toujours un moment difficile. Garder ou jeter ? Garder ou donner ? Evelyne choisissait toujours sa garde-robe avec un soin méticuleux. Plutôt menue et de petite taille elle avait su trouver un style qui convenait à sa morphologie. Et puis ses cheveux blonds d'une finesse extrême et ses grands yeux verts l'incitaient à ne porter que des teintes pastel. Elle passait beaucoup de temps à les choisir et à les harmoniser, du foulard aux souliers, du bracelet au collier, du collant au chemisier. D'instinct, elle éliminait l'intrus qui enlaidit, alourdit, tasse et assassine la silhouette. Il lui fallait la bonne hauteur de talon, la juste longueur de jupe, l'exacte largeur de pantalon, le parfait équilibre à la taille. Trop court. Trop ample. Trop étriqué. Et vlan répudié !
Evelyne s'accordait le temps d'être une femme soignée. Coiffeur et esthéticienne avaient souvent sa visite. Quelle intransigeance pour sa chevelure qu'elle voulait toujours plus soyeuse. Quelle rigueur dans l'application des crèmes et des masques sur son visage. Son corps, elle le domptait : honte à la moindre surcharge pondérale ; gymnastique quotidienne.
La jeune femme était une maniaque de l'esthétique. Le résultat frisait la perfection ce qui suscitait bien des jalousies dans le microcosme où elle évoluait. Car le monde des laboratoires est souvent peuplé de femmes bien peu soucieuses de leur apparence. Il y a celles qui se complaisent à jouer les souillons : jeans crasseux, baskets usagés et blouse blanche d'un blanc douteux. C'est le style « je pense et ça me suffit ». Il y a celles qui croient se donner un genre décontracté en enfilant ce qui leur tombe sous la main le matin au réveil. Pas coiffées, fagotées, elles déboulent toujours en retard. C'est le style « je bosse et, désolée, je n'ai ni le temps d'aller chez le coiffeur me faire couper les cheveux ni celui de courir les magasins ». Tout dans la tête. Rien dans le look.
Il était évident qu'Evelyne détonnait. Une nouvelle robe, un nouvel ensemble lui attiraient des regards méchants et des remarques acerbes. Les femmes mariées et les mères de famille étaient les premières à la critiquer. Bien sûr, une célibataire a tout son temps pour s'occuper d'elle !
Les critiques formulées dans le dos d'Evelyne n'étaient pas toutes imméritées. Son narcissisme l'avait conduite à organiser sa vie autour d'elle-même, négligeant toute convivialité. Son studio, meublé d'une manière très dépouillée avec trois chaises et une table pliante, n'était pas conçu pour recevoir. Peu importait puisqu'elle ne recevait que très rarement.
Pas de plantes chez Evelyne. Trop encombrantes ! Exclus les philodendrons ou toutes autres espèces à la mode qui ont le mauvais goût de crever dès qu'on les a chez soi. Et, si par hasard certaines s'adaptent, alors quel travail pour les entretenir ! Gare aux cernes laissés sur les meubles, la moquette ou le parquet par des bacs poreux après un arrosage intempestif ! Sans parler des feuilles qui font grise mine, jaunissent, se recroquevillent et finissent par tomber les unes après les autres.
Pas d'animaux non plus. Une fois, elle s'était même empressée de se séparer d'un banal poisson rouge gagné à une loterie en le donnant à la gardienne de l'immeuble. Biologiste elle n'abordait le monde animal qu'au travers des expérimentations menées en laboratoire. La vie restait en éprouvette.
Jacques rentra en début d'après-midi. Ces dernières heures, Evelyne avait presque oublié ses préoccupations. Jacques se chargea de les lui rappeler :
- Clément te reçoit, quand tu veux, Il te suffit de prendre rendez-vous.
Elle le regarda atterrée. Très satisfait de lui, il n'arrêtait pas de gesticuler. Que pouvait-elle répondre ? Il avait obtenu ce qu'il voulait.
Elle se souvenait de sa toute première réaction quand il lui avait demandé de se soigner. Elle s'était rebiffée :
- Moi ! Suivre un traitement ? Pour quoi faire ? Je vais bien. Ce ne sont pas deux ou trois migraines qui doivent t'inquiéter. Je les gère très bien tu sais. Je suis née comme ça, voilà tout.
Mais il l'avait obligée à regarder la vérité en face :
- Tes maux de tête, soit, mais il y a tout le reste. Ne me soutiens pas qu'il soit normal d'avoir des crises comme celle que tu as eue pendant mon absence ! Tu es malade et tu dois te soigner. Sois lucide une bonne fois ! Si tu ne fais rien les symptômes risquent de s'amplifier et de t'empêcher de mener une vie normale.
Elle avait fini par se ranger à son avis. Seulement il n'aurait pas dû la bousculer ainsi. Elle aurait très bien pu trouver un psychanalyste sans qu'il s'en mêlât. Mais de grâce, pas Clément !
Jacques attendait sa réponse.
- Si je comprends bien je n'ai plus le choix.
- Clément t'attend. Au début il n'était pas très favorable.
- Et pourquoi donc ?
- Pour un tas de raisons idiotes. L'essentiel c'est qu'en fin de compte il ait accepté.
Fatiguée de lutter Evelyne céda :
- Je vais tâcher de trouver un moment pour lui téléphoner, demain dans la matinée. Tu es content ?
Oui, il était content d'avoir réussi et pour se faire pardonner de l'avoir brusquée il la prit dans ses bras. Elle était toute frêle à ses côtés. Elle était sa chose. une chose à laquelle il tenait sans trop bien savoir pourquoi.
- VI -
Evelyne se tait. Elle découvre les lieux. Peu d'objets captent son intérêt. Un vase chinois sur la cheminée, un pare-feu métallique dans l'âtre, une lampe dans l'angle gauche de la fenêtre. Les yeux levés, elle cherche ce qu'elle pourrait bien raconter et s'absorbe un instant dans le parcours sinueux des fissures qui sillonnent le plafond. La plus profonde le traverse de part en part. Les autres, moins marquées, dessinent comme une immense toile d'araignée tout autour de la grosse rosace centrale en stuff.
Evelyne cherche ses mots alors que son regard glisse maintenant le long des murs. Elle enregistre la banalité de la tapisserie en toile bise, la neutralité des rideaux de velours marron, la sobriété élégante des embrasses en soie beige.
Rien à voir avec ce qu'elle a connu chez ses grands-parents paternels qui, collectionneurs dans l'âme, amoncelaient au fil des ans sans jamais rien jeter. Evelyne se souvient des chambres où les armoires regorgeaient de linge neuf. Des trousseaux entiers qui n'avaient jamais servi, dormaient, pliés, les plus belles pièces emballées dans des papiers soyeux, au fond des tiroirs. Enfant, elle les avait souvent ouverts en cachette pour voir ce qu'ils dissimulaient. Alors s'en échappait une odeur très particulière, un mélange de lavande et de fleurs séchées dont elle garde encore aujourd'hui la nostalgie.
Elle se remémore tous les bibelots qui encombraient les marbres gris des tables de nuit, des dessus de cheminée, des consoles et des commodes et le bois lustré des guéridons. Lampes à huile en terre cuite, vases minuscules, potiches à motifs floraux polychromes, biscuits, encadrements photographiques, porte-plume en ivoire, encriers en cristal, tabatières peintes, cache-pot en cuivre, vide-poches, boîtes à dragées, coffrets de pacotille, oufs de Pâques décorés à la main, piluliers et taste-vin en argent, flacons en pâte de verre, bougeoirs en laiton se narguaient d'un meuble à l'autre. Sous globe, à l'abri de la poussière, des pendules, des maquettes de bateaux et des couronnes de fleurs d'oranger somnolaient, figées comme des momies égyptiennes.
Le regard envahi par trop d'objets avait tendance à fuir au loin. Hélas ! Il était vite repris par l'atrocité des papiers peints à rayures rouge ou vert foncé sur lesquels on avait accroché, sans aucun souci d'harmonie, des aquarelles palottes, des huiles empâtées, des eaux-fortes en deuil, des portraits charbonneux au fusain, des lithographies et des pastels criards. Aucune surface n'était épargnée.
Quel contraste avec la pièce où Evelyne se trouve aujourd'hui. Pièce dont la nudité finit par l'inquiéter. A force de tourner la tête dans tous les sens au risque d'attraper un torticolis, elle aperçoit sur sa gauche une série de petites estampes alignées très sagement les unes au-dessus des autres dans une verticalité parfaite. Elle s'amuse à les dénombrer. Elle en compte six. C'est trop. Il n'aurait pas dû en accrocher autant.
Soudain, une voix sèche la rappelle à l'ordre :
- Je vous en prie cessez de bouger sans arrêt. Faites un effort, détendez-vous !
Clément est là dans l'ombre. C'est sans doute la manière dont elle s'est allongée, les jambes croisées hautes, le buste bien calé par le rebord du divan qui l'exaspère. Elle le nargue :
- Je suis bien comme ça.
Et elle conserve la même position. Lui, ne répond pas. Elle lui tourne le dos mais elle n'a pas de peine à l'imaginer : un oil sur les estampes qui sont juste en face de lui, un oil sur elle.
Le silence devient insupportable. Elle se lance dans un discours qui n'a ni queue ni tête. Il tousse. Elle continue de parler. Et soudain elle le sent aux aguets. Elle en est certaine : les faits qu'elle relate ne le laisse pas indifférent. Impression fugitive qu'elle capte à peine car très vite Clément s'est repris ne voulant rien laisser paraître de son émotion. Alors elle lui raconte l'histoire de la chambre de la tante Félicie. Une histoire pour l'appâter, une histoire qu'elle a dans la tête depuis des années et dont la véracité est sans doute toute relative. Pendant qu'elle parle, elle surveille les réactions de Clément. Elle guette la moindre accélération de sa respiration.
Elle se souvient. C'était dans la maison au bord de l'eau. Un hiver. Elle avait cinq ans et la tante Félicie venait de mourir d'une pneumonie. Alors sa mère avait décidé qu'Evelyne occuperait désormais la chambre de la défunte. Etait-ce bien la chambre où était décédée la tante ? Aujourd'hui Evelyne ne peut plus vraiment l'affirmer mais quoi qu'il en soit cette chambre était laide. Elle revoit encore la tapisserie à fleurs et volutes rose bonbon ; l'armoire à glace à fronton ; le lit immense recouvert d'une courte-pointe violine sur lequel il était interdit de s'asseoir ; le fauteuil vert recouvert de son éternelle housse ; le lustre en albâtre ; la lampe de chevet bancale coiffée d'un abat-jour plissé et bordé de glands mordorés ; l'affreuse pendule, surmontée de deux magots ventrus, qui, encadrée de deux candélabres, occupait le dessus de cheminée.
La pendule était son obsession. Elle avait tenté d'en détraquer le mécanisme. La première fois elle avait réussi son coup et la pendule avait fait un séjour prolongé chez l'horloger. Mais la seconde fois, prise sur le fait, elle avait eu droit à une mémorable fessée.
Il y avait aussi un tableau qu'elle détestait, une huile grand format entourée d'un cadre épais, dont la dorure s'écaillait par endroits. C'était un mélange de verdures et de roches brunâtres sous un ciel mauve. Sans doute le reflet d'un pic alpin dans un lac un soir d'orage. A force de le regarder, Evelyne avait trouvé un truc marrant : il lui suffisait de plisser les yeux pour que la montagne, mue par un phénomène bizarre, s'enfonçât dans le lac. Sans le savoir, elle avait découvert l'art abstrait.
Evelyne s'arrête de parler. L'a-t-il écoutée ? L'histoire de la chambre n'a pas semblé l'intéresser. A aucun moment sa respiration ne s'est accélérée. Elle est déçue. Pire elle est furieuse. Il la ridiculise. Il se moque d'elle, de son enfance qu'il doit juger sans importance. A quel titre ? Après tout comment était-il quand il était un petit garçon ? Elle l'imagine bien, gros coq en pâte, plutôt lent, rangeant ses jouets, pliant son pyjama avec soin avant de le glisser sous l'oreiller. Elle le voit méticuleux, maniaque, taillant ses crayons de couleur avec minutie, classant ses livres dans un ordre immuable. Et son compas ! Elle jurerait qu'il n'osait jamais le sortir de son bel écrin de velours noir, de peur de l'abîmer.
Evelyne se retourne et regarde Clément. A travers l'adulte, elle cherche le garçonnet. Une envie de lui faire du mal l'envahit. Elle le méprise. N'est-il pas qu'un petit bourgeois suffisant ?
Il vérifie la date de son prochain rendez-vous :
- Vendredi, dix-huit heures. Cela vous convient-il ?
Elle acquiesce rageuse. Et si elle décidait de ne plus revenir ?
- VII -
Evelyne vient de partir. Assis à son bureau, Clément respire enfin. Il a ouvert toute grande la fenêtre pour chasser les traces de son parfum qui imprègne la pièce.
Après avoir tergiversé, il a finalement accepté d'aller au-delà de l'entretien préliminaire auquel il voulait se limiter. Par curiosité malsaine ou par désir de ne pas contrarier Jacques ? Il ne le sait pas encore lui-même mais il a cédé : désormais Evelyne vient le voir deux fois par semaine.
Dès la première séance, ils se sont affrontés. Si en apparence ils respectent les convenances : lui le praticien impassible, elle la patiente en difficulté, la réalité est toute autre. Fine mouche, elle cherche sans cesse à le provoquer. Et elle y parvient !
Comme elle peut l'agacer avec sa brocante ! Il a droit à tout : les lorgnons du grand-père, la timbale en argent de la petite sour, les cahiers de rhétorique du cousin Paul et le vase de nuit en faïence de la tante Félicie. Elle décrit chaque objet avec un luxe de détails qui n'en finit pas. Il est persuadé qu'elle en rajoute, exprès, pour l'exaspérer. Elle le teste et quand il perd patience et qu'il la rabroue d'un ton brusque, il la voit sourire, narquoise.
Difficile de trouver la parade. D'autant que Clément doit avouer qu'Evelyne possède un réel talent de narratrice. Les anecdotes qui touchent à son enfance sont loin d'être dénuées d'intérêt. Surtout lorsqu'elle veut bien omettre les pots de chambre et les potiches à fleurs. Plusieurs fois il s'est laissé prendre au jeu. Ce passé dont Evelyne se souvient avec tant de précision l'obsède. Que ne donnerait-il pas pour que ce fût le sien ! Enfant Evelyne a sans nul doute été heureuse car il faut avoir été heureux pour se souvenir à ce point de sa petite enfance. Une chance qu'il n'avait pas eue.
Parfois lorsqu'il l'écoute il lui arrive d'avoir les larmes aux yeux. Cette femme réveille en lui des souvenirs douloureux qu'il croyait enfouis pour toujours au plus profond de lui-même et que même son analyse personnelle n'était pas parvenue à exhumer. Très jeune, il avait décidé de vivre dans l'ignorance de ses racines, sans point de repère et, jusque-là, s'en était bien porté. Ironie du sort, lui qui fuyait son passé, occupait ses journées à faire revivre celui de ses patients. Que de fois n'avait-il pas eu envie le leur crier :
- Partez ! Ne voyez-vous pas que je ne vous suis d'aucune utilité ! Votre passé est mort tout comme le mien alors pourquoi essayer de le ressusciter ?
Seulement il était un psychiatre en vue et personne n'aurait compris.
Soudain, à cause d'Evelyne, son passé refait surface, sans crier gare. Tel un cadavre dont l'assassin pensait s'être débarrassé et qui, un jour, remonte des profondeurs de la rivière où il l'avait jeté.
Un meurtre ! L'assassinat de son passé ! Assassine-t-on un leurre ? Le passé de Clément. Celui d'un être dont on a gommé l'enfance. Gommée dans l'intérêt d'une famille. Dès qu'il avait su parler, on lui avait intimé l'ordre de se taire. Par sécurité. Partout où il allait, il récitait sa leçon en perroquet bien dressé. Un tissu de contrevérités qui, à force d'être répétées, finissaient par être crédibles. On lui enseignait la méfiance : « Notre vie ne regarde personne. En parlant tu pourrais nuire à ton père. Les gens sont jaloux comprends-tu ? » Il ne comprenait rien mais il obéissait. Imaginatif, il avait fini par s'inventer un ennemi invisible, un personnage mythique, contre lequel, lui preux chevalier, il allait lutter pour sauver ses parents.
Clément, sans doute par manque de curiosité plus que par stricte obéissance, n'avait jamais cherché à savoir. Pourtant, au travers de propos tenus devant lui par les domestiques, il aurait pu deviner certaines choses. La bonne affirmait lorsque l'occasion lui était donnée que le vieux (c'était son grand-père) portait un autre nom avant l'occupation allemande. Qu'il en avait monnayé un autre par mesure de sécurité. Puis baissant le ton elle avait coutume d'ajouter : « avant c'était un nom comme. Vous savez avec tout l'argent dont ils disposent, ils peuvent acheter bien des choses et bien des gens » Bribes de conversations dont il ne saisissait ou ne voulait pas saisir le sens.
A l'époque, il habitait avec sa mère, à Antibes, dans une villa prêtée par de lointains cousins qui vivaient en Algérie. Son père venait rarement les rejoindre. Pour compenser son absence, il écrivait à Clément des lettres sèches, sans chaleur et dont le prototype était : « Cher enfant. Sois sage avec ta mère. Obéis à tes professeurs. Travaille bien en classe. Ton père. » Il avait l'âge des culottes courtes, des genoux couronnés et n'en savait rien. Seules les lettres moralisatrices de son père lui tenaient lieu de référence. Partagée entre le désir d'obéir à son époux qui voulait que son fils soit élevé non comme une poule mouillée mais à la dure et le désir de le materner, sa mère l'avait maintenu dans une dépendance préjudiciable à son épanouissement.
De la maison où il avait vécu, Clément ne se rappelait que des murs blanchis à la chaux, des volets toujours clos à cause de la chaleur et d'un jardin rocailleux planté de lauriers-roses souffreteux et d'énormes agaves truffés de piquants. Il avait sans doute dormi dans l'une des chambres du rez-de-chaussée plus fraîches que celles de l'étage mais il n'en était pas certain.
Vague, très vague le souvenir de cette rue en pente qu'il prenait pour se rendre à l'école. Il y avait aussi ce magasin, à l'angle d'une rue étroite, où sa mère allait, la démarche hésitante, vendre des bijoux ou de l'argenterie. Voilà quels étaient ses seuls souvenirs. Aucun camarade n'avait marqué cette période. Le plus souvent, il restait à l'écart des autres pour ne pas avoir à répondre à d'éventuelles questions embarrassantes. Marginal, anxieux, il avait passé ses premières années à trembler de peur. Peur d'être puni pour avoir trop parlé, peur d'être la cause involontaire de la perte de ses parents. Et cette peur il avait voulu l'oublier.
Maintenant, par la fenêtre entrouverte, pénètre un air frais. La nuit est tombée. Assis face à lui, grâce à la magie d'un reflet dans la vitre, Clément aperçoit l'image d'un homme au passé tronqué.
- VIII -
En pénétrant pour la première fois dans le cabinet de Clément, Evelyne avait éprouvé une réelle angoisse : mains glacées, palpitations et légers tremblements. Alors que par pudeur elle avait toujours refusé d'ennuyer son entourage avec ses problèmes, le seul fait d'être aujourd'hui obligée de se confier à un tiers la perturbait. Qu'allait-elle pouvoir lui raconter ?
A trente-huit ans, malgré des qualités intellectuelles incontestables, Evelyne conservait une certaine candeur. Dans son travail où elle était appréciée cette candeur aurait pu la rendre vulnérable. Que de fois, des collaborateurs peu scrupuleux n'avaient-ils pas tenté d'exploiter ses compétences à des fins toutes personnelles ! Mais là, fort curieusement, elle savait déjouer leurs manouvres et éviter le piratage de ses résultats.
En fait, c'était dans sa vie sentimentale que sa naïveté lui jouait des tours. Sans le vouloir, elle attirait les hommes à la recherche d'une aventure sans lendemain. Ainsi ce directeur de recherches qui l'avait fréquentée quelque temps puis qui, un beau jour, sans aucune explication, ne lui avait plus donné signe de vie. Histoire qui l'avait meurtrie et qui portait sans doute une lourde responsabilité dans le déclenchement des crises migraineuses. Ainsi ce chercheur anglais venu en année sabbatique avec qui elle eut une liaison tout aussi décevante que la précédente. Lorsqu'il retourna en Angleterre, Evelyne fut soulagée de le voir partir car, entre temps, son état avait empiré, les crises étant devenues de plus en plus fréquentes. Inquiète, elle avait fini par consulter un médecin qui lui avait prescrit des comprimés pour calmer les maux de tête et des gélules pour la faire dormir. Résultat : les premiers lui donnaient des haut-le-cour et elle vomissait les seconds. Elle avait jeté les médicaments dans les toilettes et continué à souffrir en silence.
En silence et. seule. Car Evelyne n'avait pas d'amie véritable. Des relations tout au plus. Si son acharnement au travail et sa disponibilité de célibataire lui avaient permis d'accéder à un poste important, en contre partie cela suscitait beaucoup de jalousie. Notamment chez les femmes qui enviaient tout à la fois sa réussite et son élégance vestimentaire. Prudente, Evelyne se tenait à l'écart. La solitude ne lui pesait pas, elle s'en accommodait.
Maintenant qu'elle avait entamé cette analyse, elle s'étonnait de la facilité avec laquelle elle avait surmonté l'appréhension du départ. Allongée sur le divan elle se sentait déterminée. Etait-ce l'hostilité flagrante de Clément qui stimulait sa volonté et l'incitait à le provoquer, à le pousser dans ses retranchements ? Si d'instinct Evelyne avait très vite deviné que Clément ne restait pas indifférent à ses propos, elle ne mesurait pas à quel point il était perturbé.
Elle se gardait bien d'en parler à Jacques quand celui-ci l'interrogeait :
- Alors ? disait-il d'un air inquisiteur.
- Alors rien répondait-elle en souriant.
- Comment rien ?
- Rien d'intéressant. Je suis allongée. Il est assis et il m'écoute. Voilà.
- Tu arrives à parler ?
- J'essaie. J'y vais pour cela non ?
Jacques, malgré sa curiosité, avait la sagesse de ne pas insister. Il s'estimait déjà heureux d'avoir obtenu qu'Evelyne consulte. Et puis Clément avait bonne réputation. Ses réticences du début étaient stupides. Enfin tout cela était rentré dans l'ordre et Evelyne allait s'en sortir. C'était une gentille fille. Très réservée, un peu trop à son goût, mais intelligente. Dès qu'il l'avait aperçue au stage d'informatique, il avait eu envie de s'occuper d'elle. A n'en pas douter elle était fragile et la protéger convenait bien à ses tendances machistes. Evelyne le changeait d'Anne, son ex épouse, et de toutes ses copines qui n'avaient que le sacro-saint mot indépendance à la bouche. Difficile à supporter ! Jacques qui entendait tout régenter au sein de son couple déclara vite forfait et Anne l'avait quitté sans regret.
Avec Evelyne, il était le maître. Pas de discussions. Docile, elle s'en remettait à lui. Les seuls différends qu'ils pouvaient avoir étaient d'ordre intellectuel. Mais là ce n'était qu'un jeu où Jacques acceptait volontiers de lui laisser la part belle. Après tout, malgré son côté tyrannique, il savait parfois jeter du lest.
- IX -
Depuis hier, Evelyne se sent tendue. Sur les nerfs. L'atmosphère lourde qui règne en ce moment au laboratoire contribue pour beaucoup à accentuer son malaise. Le « Grand Yaka », alias « Mon chauffeur m'attend », les a convoqués dans la bibliothèque. Une réunion impromptue qui ne présage rien de bon.
« Grand Yaka » dirige le laboratoire. Son second surnom remonte à l'époque où il avait été nommé président du C.N.R.S. A ce titre, il bénéficiait d'une voiture de fonction et. d'un chauffeur. A tout bout de champ on l'entendait claironner, alors qu'il arpentait au pas de charge les couloirs du laboratoire, les bras chargés de dossiers :
- Excusez-moi, mais mon chauffeur m'attend.
Ou encore :
- Plus tard. voulez-vous ? Mon chauffeur m'attend. On en reparle. Je ne peux rien pour vous dans l'immédiat. Excusez-moi, je dois partir. mon chauffeur m'attend !
Excellent prétexte pour éconduire un interlocuteur ennuyeux. Cela dura trois ans. Puis, à l'occasion d'un remaniement ministériel, « Grand Yaka » avait donné sa démission. Plus de voiture, plus de chauffeur. Seul le surnom lui était resté.
Evelyne qui craignait les allures faussement bon enfant et les réactions mandarinales du grand « Yaka » essayait tant que possible de maintenir avec lui des relations courtoises. Lui, estimait son travail. Sans plus. Il ne l'aimait pas car il la devinait insoumise ce qui ne lui plaisait pas. Il savait que, lors de réunions orageuses, elle était capable d'intervenir et de le mettre en difficulté. Toujours très polie, ne se départant jamais de son calme et n'élevant jamais le ton, Evelyne l'agaçait par son habileté à le contrer sans pour autant lui faire perdre la face. Impossible de contre-attaquer sans paraître de mauvaise foi ! Il préférait de beaucoup tous ceux, hommes ou femmes qui, de peur de nuire à leur carrière, courbaient l'échine et se taisaient. Il préférait ceux qui se ralliaient sans condition à ses idées, ceux qui acceptaient de le suivre dans ses projets les plus irréalistes. Car il ne manquait pas d'idées casse-gueule le « Grand Yaka » ! Du sur mesure pour élèves trop disciplinés. On ne comptait plus les malheureux qui, par sa faute, s'étaient fourvoyés dans des thématiques improductives. Jusque-là, Evelyne avait échappé au massacre mais il n'était pas dit qu'un jour prochain il finirait par la mettre sur la touche.
Aujourd'hui, tous les chercheurs du laboratoire sont réunis, assis autour de la grande table de la bibliothèque. Evelyne regarde et écoute « Grand Yaka » lire une lettre à haute voix. Pendant qu'il lit elle le détaille. L'homme est laid. Un visage simiesque, sans charme. Il est grand. Trop grand, le dos voûté. Il est maigre. Trop maigre, décharné. Une calvitie auréolée d'une couronne de rares cheveux blancs livre au regard, côté pile, un crâne ridé dont le plissement de la peau s'accentue au fur et à mesure que son propriétaire éprouve une contrariété.
La lettre vient du directoire du C.N.R.S. Un prototype de la phraséologie habituelle. En clair, le ministère de la Recherche définit les grands thèmes porteurs pour les années à venir et incite les équipes à se regrouper pour ne travailler que sur ces thèmes.
« Grand Yaka » a terminé sa lecture. Il enchaîne aussitôt :
- Mon point de vue est le suivant et je pense que c'est le bon.
Allez donc après ce préambule, essayer de dire le contraire !
Et de continuer :
- Il faut absolument recentrer notre thématique actuelle sur un sujet pointu et novateur. Nous sommes trop diffluents ! Le temps presse car je vous rappelle que notre contrat quadriennal s'arrête à la fin de l'année et que, si nous voulons continuer à être financés, il faut dès aujourd'hui préparer une demande de renouvellement. Les imprimés à remplir vont nous être envoyés. D'ici-là nous devons impérativement trouver un créneau porteur qui ne sera pas contesté par les experts du ministère. J'attends vos suggestions.
Tout le monde se tait. Maintenant le « Grand Yaka » qui se veut démocrate va les solliciter pour connaître leur point de vue. A tour de rôle, le nez baissé, mal à l'aise, ils vont s'exprimer. Ce n'est pas facile car ils savent déjà que, dans l'intérêt du groupe, certains vont devoir abandonner leur thématique. Egoïstement, ils espèrent être parmi les rescapés. Suffit-il de faire des propositions juste pour amadouer le « Grand Yaka » ? La tentation est forte.
Pendant que les chercheurs donnent leur avis, « Grand Yaka » prend des notes sur un calepin. C'est au tour d'Evelyne de parler :
- Evelyne, c'est à vous.
« Grand Yaka » a la coutume d'appeler les femmes par leur prénom et même parfois par leur diminutif. Sympathique non ? Familiarité dont Evelyne se passerait bien.
Décharge d'adrénaline, insuffisance cardiaque, souffle court et mains moites. Syndrome classique du stress. Evelyne surmonte son angoisse et c'est très pondérée qu'elle prend la parole :
- Personnellement (« Mon chauffeur » fronce les sourcils, il déteste les opinions trop individualisées même s'il les sollicite !) je tiens à poursuivre l'étude de la puberté chez les Primates, travail que vous m'avez confié et dont vous avez été l'instigateur (une façon de lui rappeler son entière responsabilité dans l'affaire). Il serait dommage de s'arrêter là car les résultats de ces derniers mois sont très encourageants. L'achat et l'entretien des animaux, j'en conviens, coûtent très cher mais je tiens à souligner que nous sommes très bien équipés en matériel de chirurgie et que nous possédons toute la logistique nécessaire aux dosages biochimiques. Il reste en suspens le problème de la microscopie électronique. L'unique appareil que nous partageons avec d'autres services commence à manifester des signes de fatigue. L'achat d'un second appareil doit donc être envisagé dans un délai assez bref.
« Grand Yaka » se donne le temps de la réflexion. Il continue de gribouiller sur son calepin. La puberté chez le singe ? Il est vrai que ce thème lui tenait à cour. Evelyne ne s'était pas privée de le lui faire remarquer. Une fois de plus, elle l'avait piégée. Mais aujourd'hui il devait rester lucide. Etait-ce encore un thème porteur ? Pouvait-il espérer séduire les experts avec un sujet aussi physiologique ? Trop physiologique pour des instances qui ne juraient plus que par la Biologie moléculaire. Ah ! Parlez-nous Hybridation Moléculaire et nous vous répondrons Génie Génétique !
« Grand Yaka » reprend enfin la parole :
- J'ai téléphoné à. (Suit le nom d'un conseiller au ministère de la Recherche), il m'a confirmé ce que je subodorais depuis un certain temps : si nous nous obstinons à faire de l'endocrinologie de grand-papa nous serons balayés du paysage scientifique. Evelyne à vous de réfléchir ! Si vous ne voulez pas renoncer à votre thématique alors proposez-moi une nouvelle approche beaucoup plus moléculaire et nous sauverons la situation. C'est tout ce que je peux faire pour vous.
C'était déjà beaucoup. Evelyne qui n'en espérait pas tant se sentit soulagée. Il n'en fut pas de même pour tous. Des six thèmes de recherche qui existaient encore le matin, après restructuration, il n'en resta que deux. Et encore, remodelés pour faire neuf ! Par nécessité, on venait de tirer un trait sur des travaux qui avaient été portés à bout de bras par des chercheurs qualifiés mais qui aujourd'hui étaient considérés sans intérêt et trop onéreux par les bailleurs de fonds.
Après une telle réunion, chacun s'en va, découragé. « Grand Yaka » est conscient de son despotisme mais peut-il faire autrement s'il veut garder son groupe et. prétendre briguer un siège à l'Académie des Sciences ?
Evelyne est fatiguée. A peine a-t-elle quitté le laboratoire que les prémices d'une forte migraine commencent à se manifester ce qui ne présage rien de bon pour la nuit à venir.
- X -
La crise est violente. Pendant tout le trajet, du laboratoire à son appartement, l'état migraineux s'est encore amplifié. A ce stade, aucun médicament ne peut venir à son secours. Toute la nuit son esprit endolori se laissera envahir par les fantasmes habituels.
Dans la grande maison blanche, la porte au fond du hall débouche sur la cuisine claire et spacieuse. Tout de suite, à droite en entrant, une porte ouvre sur la grande salle. En face, une large fenêtre et une porte vitrée donnent sur le jardin, laissant pénétrer, surtout le matin, une forte luminosité dans toute la pièce. A gauche, une autre porte conduit à l'office. A sa droite, contre le dernier panneau, s'adosse l'immense hotte, qu'au cours des remaniements successifs, personne n'a jamais osé déplacer.
Au sol des tommettes rouges et lustrées.
Au centre, une table rectangulaire décorée de carreaux en vieux Delft avec des bonshommes bleus sur fond blanc.
Au plafond, une suspension en opaline vert pâle, solidement accrochée par trois chaînes en fer forgé, éclaire la table.
Les détails affluent. Tout arrive pêle-mêle et Evelyne lutte pour mettre en place son décor.
L'évier, elle l'installe sous la fenêtre et le lave-vaisselle sous l'évier. L'évier en céramique émaillée bleu roi comporte deux bacs. Les robinets à oreilles en laiton, finition vieux bronze, copie d'un ancien modèle revenu à la mode, sont actionnés par deux pédales fixées au sol l'une pour l'eau froide, l'autre pour l'eau chaude.
Elle a oublié la couleur des murs. Et celle du plafond ? Que doit-elle choisir ? Elle hésite puis se décide enfin. Elle peint tout en blanc coquille d'ouf cassé par une pointe de bleu. Ne faut-il pas ajouter des carreaux au-dessus de l'évier et sous la hotte ? Elle opte pour des carreaux en faïence, cousins hollandais de ceux qui recouvrent la table. Carreaux qui protègeront le mur des éclaboussures et seront faciles à nettoyer.
La grosse bête qui ronronne dans un coin, à droite de l'évier, c'est le réfrigérateur. Une splendeur. Un article haut de gamme, fabriqué en France avec des pièces venues du monde entier. En prime, il a le look américain avec sa lourde porte bombée qui s'ouvre comme celle d'un sas de sous-marin.
Elle réfléchit à la hotte. La nouvelle, très moderne, installée à l'intérieur de l'ancienne. Un système d'aspiration compliqué à variateur électronique, branché en direct sur le conduit de la cheminée, capte toutes les vapeurs et odeurs qui s'échappent des marmites.
Un instant, Evelyne reprend son souffle. Puis, elle continue son inventaire sans rien omettre.
Elle voit les plaques de cuisson. L'une majestueuse (quatre feux sur une vitrocéramique translucide) régule avec précision tous les modes de cuisson. L'autre modeste et au gaz est réservée à la réussite des crêpes et du caramel qui nécessitent un feu très vif.
Les fours. Des monstres à cuisson électrique, chaleur tournante et micro-ondes combinés. Des modèles récents choisis par une maîtresse de maison excellente cuisinière.
Evelyne ne s'adonne jamais à la cuisine. Il n'y a que dans ses crises les plus violentes qu'elle invente des cuisines somptueuses et rêve d'appareils ménagers très sophistiqués. Son imagination est sans limite. Le plus souvent, elle s'inspire des catalogues publicitaires qu'elle reçoit et qu'elle aime bien feuilleter.
Cette fois, les images défilent en accéléré. Elle ne sait plus ou elle en est quand, soudain, un étonnant meuble prend forme. Elle le connaît déjà. Il fait songer à ces meubles aux tiroirs multiples que l'on trouvait autrefois dans les graineteries. Celui-ci a peut-être été construit sur mesure pour la cuisine ou bien acheté chez un brocanteur. Elle le voit en érable.
En sa partie supérieure : trois étagères.
La plus haute est garnie de bocaux colorés, en verre soufflé. De toutes les tailles. Remplis d'olives vertes et noires, de cornichons à l'estragon, d'oignons et de cerises au vinaigre, de câpres et de poivre vert.
Celle du milieu croule sous les pots en grès. Etiquetés. Ce sont les moutardes. Moutarde de Meaux en grains, moutardes de Dijon à la ravigote, au vin blanc, au champagne, aux anchois, au citron. Il y a aussi l'anglaise insipide, l'allemande de Düsseldorf douceâtre et la danoise vite écourante.
La plus basse s'encombre de tous les pots de confiture en cours d'utilisation pour les petits déjeuners et les goûters. Des pots de miel aux arômes mêlés, des bouteilles de sirop d'érable et de sirops de sucre. Des boîtes à sucre, à thé, à café et à cacao, toutes métalliques et hautes en couleur.
Evelyne imagine, imagine. A perdre haleine ! Maintenant elle se lance dans l'inventaire de la partie centrale du meuble. Trois compartiments bourrés de trésors.
Le compartiment de gauche est fermé par une porte vitrée. Derrière : de ravissants flacons d'épices en poudre. Des épices à profusion. Elle y trouve le cumin jaunâtre, le carvi gris des amateurs de Münster, la coriandre des marinades de poisson, le curry indou, le gingembre aphrodisiaque, le poivre de Cayenne qui arrache, le paprika flamboyant, le quatre-épices, l'origan des pizzas moelleuses, le safran au prix d'or, le raifort d'Europe centrale, la muscade brune des gratins de pomme de terre, sans oublier la cannelle chère aux cousins québécois.
Le compartiment de droite : cinq rangées de minuscules tiroirs. Dans chacun d'autres richesses : le poivre en grains (gris et blanc), le thym, le laurier, le romarin, la sauge duveteuse, le gros sel, les amandes en poudre, les noisettes pilées, les raisins secs, la vanille en gousse, les levures boulangère et alsacienne, le sucre vanillé en sachets, les feuilles de gélatine.
Evelyne fatigue, mais ce meuble l'obsède. Elle ira jusqu'au bout de ses forces. Il reste encore à inventorier les trois grands casiers du bas. Derrière trois portes pleines, se cachent les bidons et les bouteilles d'huile. Huile d'arachide, de tournesol, d'olive, de maïs et de noix. Ils côtoient les bocaux de fruits au sirop et la réserve de confitures emmagasinés au fil des cueillettes du jardin : fraises, groseilles, framboises, cassis, mirabelles, quetsches et coings.
Ah ! L'odeur des confitures lorsqu'elles mijotent dans la grosse bassine en cuivre. Réminiscence violente de ce parfum qui embaumait toute la maison quand sa grand-mère écumait le sirop bouillant et commençait à remplir les pots alignés à la queue leu leu sur la table de la cuisine. Incompatible avec son estomac de nouveau en révolution !
Elle a dû somnoler un peu. Sans doute car les chiffres lumineux du radioréveil indiquent onze heures. Dormir. Ne plus penser.
Et voici qu'apparaît l'énorme buffet vendéen. Rempli de vaisselle, de couverts et de verres.
Des générations d'assiettes plates, creuses ou à dessert, en faïence ou en porcelaine, unies à bords dorés ou argentés, discrètes à fleurs, excentriques à camaïeu rouge et bleu, s'empilent à côté des saucières oblongues, des soupières ventrues, des légumiers ronds et ovales, des jattes à entremets, des saladiers côtelés, des bols géants, des raviers tous encastrés les uns dans les autres comme des poupées russes.
Dans les tiroirs, les couverts en argent pèsent lourd. Achetés au gré des modes, ils varient par la forme et les motifs décoratifs. Le tarabiscoté avec fioritures, coquilles et rubans croisés snobe le sobre « vieux Paris », les classiques « perle » et « filet » et les modernes très dépouillés.
D'année en année, les cuillers à soupe se sont enrichies de leurs petites sours : à dessert, à entremets, à sauce, à café, à moka, à glace, à soda. Les fourchettes ont vu aussi leur famille s'agrandir avec la venue de leurs cousines : à poisson, à huîtres, à escargots, à salade, à gâteaux.
Tout un tiroir est réservé aux louches, aux pelles à tarte.
Les couteaux, à eux seuls résument l'importance attribuée, dans cette maison, au plaisir de la table. Excepté ceux qui servent tous les jours et qu'on aime bien même si leurs lames sont usées, les autres sont rangés dans des écrins. Les couteaux à dessert sont les plus nombreux et les plus beaux : en ébène, en corne, en ivoire, en vermeil. Les plus impressionnants sont les couteaux à découper (de véritables coutelas !) et les plus inoffensifs, aux bouts ronds, sont les couteaux à fromage et à fruits.
Chose curieuse, les verres, dans l'ensemble sont assez quelconques. Souvent dépareillés. Seules, quelques pièces en cristal ayant échappées à la casse attirent l'attention. Mais rien de spectaculaire pour un collectionneur de baccarat. Cependant, si les verres ne sont pas d'une finesse extrême, ils ont des formes élégantes et leur transparence permet d'apprécier la robe des vins.
Evelyne relâche son attention. Son cerveau s'embrouille et ne voit plus soudain que le quotidien grisâtre : poussière, miettes, moutons, épluchures, déchets, éclaboussures d'eau sale et de graisse, éviers encrassés, plaques à gaz caramélisées, assiettes ébréchées, verres fêlés, couverts tachés. Inévitable contre-partie de l'utilisation journalière des objets !
Malgré sa fatigue, elle astique les cuivres qu'elle trouve ternes. Elle frotte l'immense bassine à confiture qui, trop lourde, lui échappe des mains. Elle frotte le cul-de-poule rondouillard et les moules à kouglof. Elle s'acharne avec le chiffon imbibé de Miror sur les moules à pudding aux formes amusantes (poisson, rosace, cour). Cuivre rouge, cuivre jaune. Quel plaisir de les voir briller les uns après les autres. Mais soudain, l'odeur du Miror l'emporte sur ce besoin maniaque d'astiquage. La nausée vert-de-gris l'oblige à tout laisser. Elle tremble de la tête aux pieds. Les vomissements se font violents. Elle éclabousse l'émail des toilettes d'une mousse jaunâtre qui révulse son estomac plus encore. Sa tête va exploser. Tout bascule autour d'elle. Elle fixe, sans le voir, le carrelage vert des toilettes. Elle perd la notion du temps et reste debout appuyée contre le mur, les yeux dans le vague. Impossible de dompter la douleur devenue intolérable. Jacques a raison : elle ne peut plus vivre ainsi.
- XI -
Noël illuminait Paris de mille scintillements. A la dernière minute Jacques avait décidé d'inviter des amis pour le réveillon. La décision prise, l'intendance devait suivre sans discussion. C'est-à-dire : les amis disponibles, la table retenue et le repas commandé dans les plus brefs délais.
Comme à son habitude, persuadé que son entourage était prêt à épouser son idée, il fonça. Bernard son plus proche collaborateur ainsi que Jeanne sa secrétaire furent mis d'emblée à contribution.
Bernard était l'opposé de Jacques. Flegme olympien, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un mouvement d'humeur, jamais de gesticulation inutile. Ce contraste était saisissant mais bénéfique à leur association car Bernard était le seul que Jacques écoutait. Dans les moments d'extrême fébrilité, il était le seul à le calmer ou pour le moins à modérer ses élans intempestifs.
Quant à Jeanne, il y avait belle lurette qu'elle avait renoncé à lui faire entendre raison. D'autant que Jacques avait une fâcheuse tendance à la prendre à témoin quand Bernard venait contrecarrer son point de vue sur telle ou telle affaire en cours :
- Jeanne ! Vous qui me comprenez, dites-lui que cette fois j'ai raison. Je vous en prie Jeanne, expliquez-lui s'il vous plaît !
Cette idée de réveillon qui venait de germer dans sa tête, donnait à Jacques une nouvelle occasion de se surpasser. En quelques heures, il parvint à mettre le cabinet en révolution. Jeanne dut abandonner courrier et dossiers pour se consacrer uniquement à l'organisation du réveillon.
Les invitations ?
- Téléphonez, faxez. mais faites qu'elles arrivent ce soir au plus tard ! Voici la liste. Comptabilisez les réponses positives dès maintenant. Je dois savoir pour retenir une table.
Le restaurant ?
- Appelez immédiatement ceux que j'ai sélectionnés. Vous entendez Jeanne !
Inutile d'insister cher maître. Il n'y a plus une table de libre. Même pour vous. De banale l'affaire prenait une tournure imprévue. Jacques qui ne supportait pas qu'on lui résistât s'énervait. Jeanne et Bernard le regardaient arpenter son bureau à grandes enjambées, de long en large, en diagonale et en dépit du bon sens. Furieux d'être mis en échec par la corporation des maîtres queux, lui un grand maître du barreau de Paris, il passait ses nerfs sur le combiné téléphonique qu'il empoignait d'un geste brusque puis raccrochait violemment pour le reprendre quelques instants plus tard. Jusque-là Bernard avait gardé le silence. Soudain, l'oil malicieux, il s'adressa à Jacques :
- Je pense avoir ce qu'il te faut. Enfin si cela te convient.
- Tu ne pouvais pas le dire plus tôt !
Bernard qui prit un air suave continua :
- Voilà ! Je te prête mon nouvel appartement, boulevard Saint-Michel. Il est actuellement en réfection mais il y a du chauffage et de l'électricité. Nous pourrions y camper. Il te suffit de faire appel à un traiteur et le tour est joué. A toi de décider !
Ce fut tout décidé. Jeanne reçut de nouvelles directives. Ordres et contre-ordres se succédèrent toute la journée. Pêle-mêle, Jeanne commanda des nappes, du foie gras, des sorbets, des chaises, des tréteaux, des jus de fruits, du champagne, des assiettes, des flûtes, des guirlandes, des couverts, un sapin, du gui et du houx, des huîtres, des fromages, de la dinde farcie, une bûche glacée et une sono pour l'ambiance.
Jeanne qui avait vu son patron tournicoter sous son nez, sauter d'un pied sur l'autre, changer sans cesse d'avis, hésiter sur le choix des fournisseurs, mélanger les adresses et les numéros de téléphone, ne demanda pas son reste quand l'heure de quitter son travail arriva. Peu importe, Jacques avait obtenu ce qu'il voulait : quarante-huit heures avant Noël, tout était réglé.
Dans toute cette agitation, Jacques n'avait pas un seul instant songé à prévenir Evelyne. Lorsque le soir il l'informa enfin de son initiative, elle s'étonna. Son avis comptait-il si peu ? Surpris par sa réaction il contre-attaqua :
- Mais je croyais te faire plaisir ! Tu ne peux pas imaginer le travail que cela à demander pour tout organiser en si peu de temps. Je suis épuisé. Heureusement que Jeanne était là !
Quoi qu'il en dise, il n'avait pas l'air fatigué. Plutôt excité. Il continua :
- Rassure-toi ! Je n'ai invité que des amis proches, certains que tu connais déjà. Tu verras nous allons bien nous amuser. D'accord ?
Evelyne qui n'avait pas envie de lui confier que dans ce genre de réunions elle ne s'amusait jamais, se contenta d'approuver :
- Mais oui puisque cela te fait plaisir ! Je suis soulagée de savoir que Jeanne t'a aidé car, tu sais, je suis une piètre organisatrice. Je n'entends rien à ce genre de choses. Les réceptions et moi.
Jacques la rassura :
- Je sais ! Ne t'inquiète pas. Contente-toi d'être toi-même. Et fais-toi jolie c'est tout ce que je te demande.
Jacques ne se doutait pas de l'effort qu'il lui demandait. Surmonter ses appréhensions ? Se mêler aux autres ? Participer à des conversations banales avec des inconnus ? Difficile quand on a vécu replié sur soi-même pendant des années. Evelyne se souvenait d'une période encore récente où elle était incapable d'accepter la moindre invitation. Sourire, papoter un verre de champagne ou un petit four à la main, lui était alors intolérable. Depuis, elle avait un peu progressé. Pas assez toutefois car il lui arrivait encore d'être mal à l'aise dans certaines réunions.
Si Jacques lui avait demandé de choisir, elle aurait opté pour un réveillon en tête-à-tête. Peu ou prou elle avait la nostalgie des Noëls de son enfance. En famille. Aujourd'hui, elle n'espérait plus rien de la sienne. ou de ce qu'il en restait. Sa sour ? Mariée et mère de trois enfants habitait en Savoie et ne l'invitait jamais. Sa mère ? Retirée en Auvergne préférait, à la visite de sa fille, la solitude devant son poste de télévision. Et puis, il y avait en filigrane, quelque part dans son subconscient, cet affreux Noël auquel elle ne voulait plus penser, où, petite fille, elle avait dû surmonter son chagrin pour faire bonne figure.
Elle devait se rendre à l'évidence : si elle avait eu à inviter des amis qui aurait-elle pu inviter ? Personne. Jacques qui l'entraînait dans son sillage lui montrait à quel point elle vivait à l'écart des autres. En revanche, elle avait beaucoup de mal à comprendre qu'il acceptât de se laisser envahir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, par des amis qui, de passage entre deux trains ou deux avions, venaient à l'improviste tambouriner à sa porte.
Le soir du réveillon de Noël, Evelyne soigna sa tenue. Elle choisit de mettre une robe de chez Anastasia. Coupée dans un tissu à gros ramages rouges et verts, elle évoquait par sa forme (encolure carrée, manches bouffantes s'arrêtant aux coudes, corselet serré à la taille) les robes que portaient les paysannes russes au siècle dernier. Virevoltant devant la grande glace de la salle de bains, Evelyne se trouva à son avantage. Cette robe lui allait vraiment bien. Elle choisit de la porter avec des bottes à talons, en cuir fauve, ce qui était une excellente idée. D'apercevoir dans le miroir une image aussi parfaite de sa personne lui insufflait presque la force d'aller rejoindre les autres.
Jacques qui vint la chercher aux environs de neuf heures la félicita :
- Bravo ! Tu es d'une élégance folle ! Sincèrement ! Tu vas faire des jalouses.
- J'ai hélas l'habitude ! Je voudrais tant que pour une fois les choses se passent bien ! Tu sais je ne suis pas très détendue à l'idée de rencontrer tous ces gens qui doivent se demander ce qu'une fille comme moi fait avec un homme comme toi. Du reste je me le demande aussi. Nous sommes si différents !
Jacques qui la sentait inquiète la prit par les épaules :
- Allons viens ! Arrête de te torturer et profite de cette soirée sans arrière-pensée.
Lorsqu'ils arrivèrent chez Bernard, une grande activité régnait dans l'appartement. Jeanne était là, véritable intendante en chef. Aidée de sa fille Nathalie, une charmante adolescente pleine de vie comme sa mère, elle vérifiait les livraisons, déballait verres et assiettes, mettait le champagne et le foie gras au frais, contrôlait l'état des sorbets et de la bûche glacée dans la glacière portative.
Jeanne aimait se rendre indispensable. Entreprendre et payer de sa personne était sa manière, très nombriliste en réalité, de se valoriser aux yeux des autres. Forcer l'admiration lui plaisait.
Evelyne qui connaissait Jeanne la craignait. Certes, elle lui enviait son dynamisme et son sens de l'organisation mais elle n'aimait pas sa façon de tout régenter comme si elle était la seule à détenir la solution de tous les problèmes. En vérité, sous le regard scrutateur de Jeanne, Evelyne ne faisait pas le poids. Elle se sentait vite reléguée dans le clan des bonnes à rien, des gourdes, des godiches, des potiches.
Ce soir-là, elle ne put échapper à son sort. A peine arrivée, Jeanne la réquisitionna pour tartiner des mini-sandwichs. Corvée dont Evelyne avait horreur. Les oufs de cabillaud et de lump lui levaient le cour. Le beurre de crevette risquait de tâcher sa robe et le tarama grumeleux éprouvait un malin plaisir à ne pas s'étaler. Mais pouvait-elle refuser de participer quand elle voyait tous les autres mettre la main à la pâte. Et tous avaient l'air ravis. Des vrais boys-scouts ! Les uns accrochant une guirlande, allumant des bougies, ouvrant une bouteille récalcitrante ou bien encore découpant la dinde, les autres partant à la recherche d'un tire-bouchon, d'un couteau ou d'un plat que réclamait Jeanne. Tous, qui chez eux auraient rechigné à faire la même chose, se mettaient en quatre pour ne pas déplaire à Jeanne. Evelyne, ayant bien volontiers abandonné les sandwichs à une stakhanoviste enragée, les regardait se bousculer, réclamer leur part de travail, et ne pouvait, assise à l'écart, s'empêcher de sourire. Elle le savait : quoi qu'elle fît, elle ne serait jamais des leurs. Feindre d'accorder de l'importance à des choses aussi puériles était au-dessus de ses forces. La soirée s'annonçait difficile. Jacques qui l'observait du coin de l'oil s'approcha d'elle.
-Allez viens ! Laisse-les s'agiter ! Si tu veux, nous allons tester la sono. Ça te va ?
Elle se leva soulagée. Il la serra fort dans ses bras le temps d'un slow et lui murmura à l'oreille :
- Ils sont tous sympas mais un peu cons c'est bien ce que tu penses ?
- Non pas vraiment mais je les trouve assez superficiels. Désolée car ce sont tes amis.
- Ne soit pas désolée. Ils sont snobs c'est tout. Victimes du parisianisme ambiant. Mais à part ça, ils sont braves, tu verras.
Pour voir, elle allait voir !
Peu à peu, ils étaient tous arrivés. Les bras chargés de fleurs et de paquets multicolores. Bernard leur avait présenté sa dernière conquête : une ravissante personne qui, perchée sur des talons aiguilles, n'arrêtait pas de se trémousser. Assez grande, très brune, le buste saillant dans une robe en satin garance, elle portait un collant fantaisie, noir qui attirait le regard sur des jambes au galbe parfait. Bernard avait découvert Christine, six mois plus tôt, juchée sur un grand escabeau alors qu'il était de passage dans l'entreprise où elle travaillait. Les jambes avaient dû faire de l'effet car depuis, ils vivaient ensemble. Bruyante, elle jacassait telle une pie borgne. Cela n'empêchait pas Bernard et les autres de rire au moindre de ses propos. Evelyne qui n'aimait pas ce genre de femme la jugea vulgaire. Comment Bernard faisait-il pour la supporter ?
Après Bernard et Christine, deux autres couples attirèrent son attention. A regarder les visages renfrognés et les sourires figés du premier on devinait aisément qu'il y avait de la dispute dans l'air. A l'opposé, le second couple se faisait remarquer par son exubérance. Un petit côté foufou qui sur le moment pouvait distraire mais qui très vite fatiguait. Depuis qu'ils étaient arrivés, ils ne cessaient de répéter à qui voulait bien les écouter qu'ils s'étaient trompés deux fois d'immeuble et une fois d'étage avant de sonner à la bonne porte. Et de s'esclaffer comme si leur mésaventure était un exploit.
Evelyne qui ne parvenait pas à se mêler aux conversations, fut soudain abordée par Christine.
- Vous êtes l'amie de Jacques ?
- Oui c'est cela. Vous avez l'air de vous amuser ?
- Pas vous ?
- Pas vraiment.
- Mais pourquoi ? L'ambiance est bonne. Venez, nous allons boire un verre de vin. Jeanne a bien fait les choses ne trouvez-vous pas ? Une perle ! Heureusement qu'ils l'ont ! Sans elle, nos pauvres chéris seraient vite perdus vous savez !
Christine l'avait entreprise et ne la lâchait plus. Evelyne cherchait à se sortir de ce mauvais pas quand la fofolle qui s'était trompée de porte les interrompit :
- Connaissez-vous le Kenya ? Avec Bob nous avons l'intention d'y aller au printemps prochain mais je ne sais pas si c'est la bonne saison pour partir.
Christine s'intéressa :
- Ah bon ! C'est génial ! Vous prévoyez un safari ? Et vous Evelyne ça vous dirait le Kenya ? Si vous en parlez à Jacques je suis certaine qu'il vous y emmène.
Evelyne hocha la tête :
- Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de voyager. Je ne sais pas.
A côté des deux autres, elle avait le sentiment de n'avoir jamais rien fait et de n'avoir aucun projet.
Christine bonne fille temporisa :
- Il n'est jamais trop tard ! N'est-ce pas Monique ?
Apparemment les deux femmes se connaissaient. Après les voyages, il fut question des soldes qui avaient commencé. Un domaine où Evelyne se sentant un peu plus à l'aise put donner son point de vue :
- Il faut aller chez Scherrer. L'an passé j'ai trouvé un ensemble en soie pour trois fois rien ! Mais il y a un monde !
Voilà, qu'à son tour elle se lançait aussi dans les papotages mondains !
L'atmosphère guindée des débuts de fête commençait à faire place à une ambiance plus détendue. Ils avaient tous franchi le pas qui mène à cet état bienheureux où, sans être ivre, on ressent une légère euphorie qui rend résolument optimiste et fait oublier le mauvais côté des choses. Ils papotaient tous la bouche pleine et le verre à la main quand, ultime coup de sonnette, deux retardataires firent leur apparition : Clément et Jean-Lou. Ils s'excusaient. Jean-Lou revenait de San Francisco. L'avion avait atterri à Roissy avec deux heures de retard et ensuite il avait fallu patienter dans les embouteillages sur le périphérique.
Evelyne n'en revenait pas. Il y avait bien une chose à laquelle elle n'avait pas songé en se rendant ici c'était bien de rencontrer Clément. Mais où Jacques avait-il la tête ! Elle n'avait nullement envie de croiser son psy un soir de réveillon et surtout pas Clément. Refoulant son agacement, elle fut bien obligée de saluer les deux hommes. Elle sentait que Clément l'observait à la dérobée. Rageuse, elle lui tourna le dos.
Maintenant les conversations prenaient une tournure plus intime. Jeanne écoutait patiemment l'une des invitées lui raconter, sans omettre le moindre détail, ses deux accouchements. Et d'enchaîner :
- Quel talent Jeanne ! Toutes ces excellentes choses si bien présentées. Vous êtes une fée !
Jeanne se contenta de hocher la tête sans répondre. Ayant une haute estime d'elle-même, elle se moquait éperdument de toutes les flatteries mielleuses qui lui étaient distillées depuis le début de la soirée. Surtout lorsqu'elles venaient de femmes qui, à l'évidence, n'en pensaient pas un traître mot.
Evelyne malgré toute sa bonne volonté trouvait le temps long. Peu habituée aux repas plantureux, elle avait à peine touché aux plats quand Jacques l'entraîna vers le buffet.
- Allons ! Goûte cette farce. Elle est divine. Et ce vin ? Sublime !
- Pourquoi as-tu invité Clément ?
- Par amitié voyons ! Où est le problème ?
- Tu ne vois pas ? Ça me suffit de le voir chez lui sans le rencontrer ailleurs ! Tu aurais quand même pu m'en parler !
- Mais j'ignorais que tu serais fâchée. Excuse-moi. Je ne savais pas.
Jacques savait très bien. En invitant Clément, il avait tout simplement refusé de prendre en compte la psychologie fragile d'Evelyne. Certes, il s'attendait bien à des reproches mais il ne pensait pas l'avoir autant peinée. Il s'excusa à nouveau :
- Pardonne-moi, je suis un idiot. Allons viens danser !
Le temps d'un tango Evelyne oublia tout.
A côté d'eux, Nathalie dansait avec Jean-Lou. La jeune fille riait à gorge déployée se moquant de son partenaire qui venait de lui proposer de se joindre à sa troupe de théâtre ! Que Dieu l'en préserve, elle n'avait aucune envie de jouer la comédie ! Tout en dansant elle observait Clément qui était assis seul à l'écart des autres convives. Il avait l'air triste. Nathalie faillit en toucher deux mots à Jean-Lou puis elle se ravisa. Après tout, leurs histoires de couple ne la regardaient pas.
En réalité, Clément n'était pas malheureux. Son amour pour Jacques prenait une dimension nouvelle. Il n'espérait rien et pourtant il espérait tout. Si la venue d'Evelyne avait tout modifié, il ne le regrettait plus. Sans le savoir, elle l'avait contraint à un terrifiant retour en arrière dont, curieusement, il lui savait gré. Ce soir, il s'en voulait d'être venu. Voir Evelyne, qui à l'évidence n'avait pas apprécié qu'il fût là, dans les bras de Jacques était difficile à supporter mais se priver de voir Jacques était au-dessus de ses forces !
La soirée avançait au rythme des verres qui s'emplissaient et se vidaient. Les humeurs changeaient. Ils en étaient à la bûche glacée et aux histoires salaces que tout le monde connaît mais que l'on ne peut s'empêcher de répéter par habitude. Ils riaient, ils gloussaient, repus de petits fours et de caviar, légèrement nauséeux, le ventre ballonné, la tête bourdonnante. Mus par un soudain besoin de se retrouver, les couples se reformaient le temps d'une danse.
L'aube les trouva blafards. Les conversations languissaient. Seul, Jean-Lou qui n'avait pas sommeil à cause du décalage horaire, tenait le coup. Affalé par terre, les pieds repliés sous lui, il racontait avec un luxe de détails d'une navrante vulgarité (sans doute pour rendre Clément jaloux) la vie qu'il avait menée à Frisco. Sans pudeur, il décrivait les rencontres qu'il avait eu l'occasion de faire dans plusieurs boîtes branchées réservées aux homosexuels.
Il aurait continué longtemps à parler de la vie là-bas si Jeanne ne l'avait pas interrompu. Préoccupée par tout ce qu'il y avait à ranger, elle réclamait de l'aide. Son intervention les réveilla tous. Un dernier besoin d'activité les gagna et, ravis de se rendre à nouveau utiles, ils se mirent au travail.
Une heure plus tard, la fête se résumait à quatre gros sacs-poubelle entassés dans un coin, du matériel d'hôtellerie prêt à repartir et le reste des agapes qu'ils s'étaient partagés.
Leur dernière B.A. accomplie, ils se quittèrent, les yeux cernés, la bouche pâteuse, la démarche hasardeuse, pressés d'aller se coucher.
- XII -
Début janvier, Evelyne retourna chez Clément. Celui-ci était un bon praticien. Par nature, il savait écouter. Son enfance solitaire qui lui avait appris à se taire, à observer et à s'abstraire, l'avait mieux formé à l'exercice de sa profession que les années passées à l'université. En règle générale, il s'écartait peu des règles déontologiques qu'on lui avait enseignées. Cependant, son expérience l'ayant conforté dans l'idée qu'une exploration abusive du passé chez des personnes très fragilisées n'est pas forcément la meilleure solution, il restait favorable, dans la majorité des cas, à une thérapie d'une trentaine de séances tout au plus.
Le cas d'Evelyne lui semblait assez simple. Toutefois, il n'avait pas encore tranché sur le traitement à suivre. La jeune femme n'était pas facile à cerner et l'attitude agressive qu'elle manifestait à chaque séance n'arrangeait rien. A maintes reprises, Clément avait essayé de gagner sa confiance mais elle, méfiante, avait refusé d'entrer dans son jeu.
Que cherchait-il ? Voulait-il tout simplement gagner sa sympathie ? Dans quel but ? Evelyne ne voulait pas de sa sympathie. Elle le payait pour qu'il l'écoutât, un point, c'est tout. Que cela l'amusât ou non, il allait devoir la supporter.
Clément l'écoutait. l'écoutait et souffrait.
Très tôt, Evelyne fut une petite personne curieuse. Toute gamine, rentrant de l'école, à la nuit tombante, en automne ou en hiver, elle aimait inventer des histoires sur la vie des gens qu'elle apercevait à la faveur d'un éclairage indiscret ou d'un rideau mal tiré. Trottinant aux côtés de sa mère qui marchait vite, elle imaginait l'intérieur des maisons qu'elles longeaient.
La maison familiale où elle vivait avec ses parents et ses grands-parents maternels ne lui plaisait pas. Déjà, à cette époque, elle rêvait de demeures somptueuses.
Pourtant, maintenant qu'elle y repensait, cette vieille demeure avait un certain charme. Située au bord d'une rivière aux rives verdoyantes et encore sauvages, elle avait été construite au siècle précédent. Le toit dissymétrique était recouvert, on ne savait pourquoi, moitié de tuiles rouges moitié de plaques de zinc. La façade, avec ses nombreuses fenêtres réparties sans aucune symétrie n'avait rien d'esthétique. Mais la maison était vaste et donnait une impression de confort qu'en réalité elle ne possédait pas.
Toutes les baies vitrées étaient habillées de brise-brise brodés et démodés, de doubles rideaux en taffetas épais et passé.
Au rez-de-chaussée, les pièces de réception restaient fermées pour ne pas salir. Elles étaient froides et austères, meublées sans goût. Au premier étage, les chambres étaient banales, sans intérêt. Seul, l'immense grenier attirait Evelyne. Elle fouillait pour trouver des vieux vêtements. Elle se déguisait et restait des heures à se contempler dans une psyché dont, malheureusement, le tain piqueté lui renvoyait une image floue. Il y avait aussi une grande armoire bourrée de merveilles. Draps et nappes brodés, taies d'oreillers ajourées, serviettes de table damassées, torchons aux monogrammes au point de croix, mouchoirs immenses de Cholet à carreaux mauves, serviettes de toilette en éponge épaisse, roses et bleues, blanches à nids d'abeilles serrés, nappes à thé, essuie-verres, napperons, voilages, dentelles, soieries, cotonnades s'entassaient sur les rayonnages. L'héritage des générations précédentes.
Malgré une certaine austérité, toute la famille vivait dans le luxe des matelas en laine, des édredons volumineux, des traversins replets, des oreillers moelleux. Ils ne dormaient que dans des draps en lin, refusant le coton trop rêche.
Le linge occupait une place primordiale. Evelyne avait vécu au rythme des lessives du lundi, du raccommodage le mercredi, du repassage le jeudi, du rangement dans les armoires le vendredi, du ramassage et du tri du linge sale le samedi.
A côté de la cuisine, une grande pièce servait de lingerie. Evelyne y voyait sa mère et sa grand-mère s'employer à de curieux travaux. Il était souvent question de bleuissage pour mieux blanchir, de rinçage à l'eau de Javel pour décolorer, d'infusion de thé pour biser les étoffes trop blanches, de terre de Sienne pour dégraisser. Elle avait encore en mémoire l'immense table à repasser avec son molleton jauni et sa toile fine. Des pattemouilles humides. Des jeannettes de toutes les tailles. Des fers plats en fonte noire, alignés les uns à côté des autres sur des supports métalliques. Du fer électrique utilisé avec parcimonie (seulement l'été quand la cuisinière à charbon était éteinte). Du bol d'eau amidonnée qui servait pour l'empesage des cols et des poignets. Des brosses. Aujourd'hui, il lui restait la nostalgie du parfum qui se dégageait des piles de linge frais repassé.
Ils avaient aussi l'exigence d'une literie en parfait état. Tous les ans, aux beaux jours, une matelassière réputée pour son savoir-faire, venait à domicile. Elle installait sa cardeuse sous un marronnier, derrière la maison, et travaillait toute la journée à la réfection des matelas. Evelyne était médusée par le chevalet sur lequel était fixée la carde aux pointes acérées. Actionné à la main, cet outil rejetait la laine qui tombait par touffes aériennes dans un grand panier en osier. Dans l'après-midi, les matelas reprenaient forme, habillés de housses rayées toutes neuves. La nuit suivante, dans les chambres où les matelas avaient été refaits, les occupants dormaient mal à cause de ces énormes monstres qui refusaient d'épouser la forme de leurs corps.
A la maison, Evelyne préférait les abords et les dépendances. Elle aimait beaucoup, côté rue, la petite terrasse qui, flanquée d'une tonnelle et de trois massifs de fleurs, égayait la façade. D'une année à l'autre, les motifs floraux ne changeaient guère. On restait fidèle aux dahlias, aux géraniums et aux bégonias qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. C'était sur cette terrasse que, les soirs d'été, toute la famille se réunissait après le dîner. Ils prenaient le frais face à la rivière malgré les moustiques qui les attaquaient et la rudesse des fauteuils de jardin à lattes de bois qui laissaient le dos et les fesses endoloris. Parfois, des voisins se joignaient à eux. Tandis que les grandes personnes parlaient entre elles, Evelyne en profitait pour s'échapper au bord de l'eau et jouer avec d'autres enfants de son âge aux Indiens dans les bosquets et les roseaux. Escapades qui se soldaient par des retours sanglants et terreux sévèrement sanctionnés par sa mère.
Elle se souvenait du portail en fer forgé qui commençait à rouiller. Du passage au sol pavé de grosses pierres disjointes et bosselées qui, à droite de la maison, menait à une vaste cour ombragée par deux plantureux tilleuls à la boule au carré et trois marronniers centenaires dont les racines saillaient au point de soulever le sol par endroits. Dans la cour : un joli petit pavillon. Elégant avec de grandes baies vitrées et un toit très pointu recouvert d'ardoises, il servait de serre. Evelyne y venait souvent jouer à la poupée.
Au fond de la cour : d'autres bâtiments plus imposants. C'étaient les remises, les anciennes écuries, l'atelier de tonnellerie et, creusés dans le coteau, les chais. En grandissant, Evelyne avait découvert là un royaume merveilleux : celui de Dionysos. Car son grand-père était pinardier. Après avoir quitté l'école à douze ans, nanti de son certificat d'études, il avait fait son apprentissage à la Halle aux vins. Puis, dans les années 1920, après la Grande Guerre, il s'était installé dans cette ville au bord de la rivière.
Parmi les ouvriers qui travaillaient chez son grand-père, le préféré d'Evelyne était le tonnelier. Elle passait des heures à le regarder fabriquer des fûts. Les pieds dans les copeaux, elle suivait avec grand intérêt toutes les étapes de leur confection. Raboter et cercler les douves, faire gonfler le bois avant d'ajuster les fonds, assembler les pièces, raboter encore, percer le petit trou pour y placer la bonde. Tous ces gestes, elle les connaissait par cour pour le reste de sa vie.
Parfois, Evelyne était autorisée à assister au nettoyage des chais. Alors, elle descendait par une échelle dans les profondeurs des citernes vides et criait fort pour entendre retentir l'écho de sa voix.
Elle se souvient aussi de cette grande enseigne qui faisait de la publicité pour une bière : la bière du Lion. Un gros lion rigolard à l'air satisfait plongeait son museau dans une énorme chope d'où débordait une abondante mousse. Elle se souvient. de toutes les belles étiquettes multicolores classées par catégorie (bordeaux, bourgogne, vins de Loire, apéritifs, digestifs.) qui occupaient plusieurs tiroirs d'un petit meuble conçu à cet effet.
Evelyne allongée sur le divan dévide ses souvenirs. Clément devine une petite fille heureuse qui, malgré une imagination débordante, ne posait pas de problèmes particuliers.
On lui a raconté : tu as fait tes premiers pas le jour de la libération de Paris. La guerre ? Elle ne s'en souvient pas, elle était trop petite.
Elle revoit. Elle revoit sa grand-mère maternelle. Une for jolie femme, au teint clair, aux yeux gris malicieux et au nez camus. Le buste sanglé dans un corset rigide, qui lui remontait la poitrine à la hauteur des aisselles, elle était imposante. Ses cheveux blonds parsemés de fils blancs étaient relevés sur le dessus du crâne en un chignon maintenu par de grosses épingles. Elégante et habile de ses mains, elle confectionnait toutes ses toilettes. Et Dieu sait combien elle aimait suivre la mode ! Les chapeaux étaient sa passion. Les visites chez la modiste étaient extraordinaires. Evelyne pourrait encore décrire le petit salon où, en attendant son tour, sa grand-mère papotait avec les autres clientes. Elle se rappelle qu'à la vue de toutes les formes en bois qui lui faisaient penser à des têtes de guillotinés embrochées sur des piques par des révolutionnaires sanguinaires, elle était mal à l'aise. En revanche, elle raffolait des essayages. Le choix du modèle, celui de la couleur, du tissu, des garnitures (rubans, plumes ou fleurs) et aussi de la voilette demandaient beaucoup de réflexion. Mais le résultat était merveilleux. Sa grand-mère avait bon goût et la modiste du talent.
Chez le corsetier, le choix d'une gaine était encore plus laborieux que celui d'un chapeau. Les essayages, cette fois, avaient lieu, à l'abri des regards indiscrets, dans une cabine fermée par un rideau. A l'intérieur, un triptyque permettait aux clientes de contempler sans complaisance, de face, de dos et de profil leur silhouette bardée de satinette baleinée. On disait que le corsetier était un filou et qu'il se passait de drôles de choses dans son arrière-boutique mais, comme les lacets étaient solides, le satin de bonne qualité et la facture honnête, la grand-mère d'Evelyne, faisant abstraction du qu'en-dira-t-on, continuait à se fournir chez lui.
C'est à cette femme qu'Evelyne doit de savoir choisir ses toilettes. Tout enfant déjà, elle essayait de lui ressembler en se costumant avec les vieux habits qu'elle trouvait au grenier. Depuis, son goût très marqué pour les vêtements, les accessoires de mode et les bijoux n'avait jamais faibli.
Cette séance-là, Clément a droit au défilé de toute la famille. ou presque. Après la grand-mère chapeautée et corsetée voici le grand-père. Un monsieur sérieux. Très digne avec une petite moustache teinte, une sorte de tapis brosse miniature. On le disait courtois, calme, discret, pondéré, raisonnable et terriblement têtu. Un berrichon ! Quand ses affaires lui laissaient un peu de répit, il aimait lire. Parfois, il emmenait Evelyne se promener au bord de la rivière ou bien en ville. Elle était fière d'être saluée en sa compagnie. Il connaissait une foule de gens et s'arrêtait souvent pour leur parler. Dans ces moments là, il serrait très fort la petite main d'Evelyne dans la sienne de peur que l'enfant ne lui échappât et ne se fît renverser par une voiture. Il était surprenant de voir cet homme strict, vêtu d'un pardessus et d'un pantalon gris, ganté et chapeauté, jouer les nurses attentives. Souvent ils allaient chez le libraire. Là, Evelyne en petite bonne femme volontaire parvenait toujours à lui extorquer l'achat d'un coloriage ou d'une boîte de crayons de couleurs. Puis rentrée à la maison, elle s'installait pour dessiner ou bien réclamait une histoire. De bonne composition, son grand-père la prenait sur ses genoux. Alors, il lui lisait et lui relisait les aventures de Bécassine, de Nane ou de Zig et Puce. C'était un moment béni. Elle restait, pelotonnée bien au chaud, tandis qu'elle écoutait. Elle serait restée ainsi des heures. Mais hélas, trop souvent, le charme était rompu par sa mère qui venait la chercher pour passer à table ou pour ranger ses jouets qui traînaient épars dans sa chambre.
Evelyne craignait sa mère. Elle la trouvait sévère et ennuyeuse.
La dernière personne qui habitait avec eux était son papa. Mais lui. elle le voyait peu car il n'était pas souvent à la maison.
La séance est terminée. Clément note deux ou trois réflexions sur son carnet. Comme le « Grand Yaka » pense Evelyne.
Resté seul, Clément réfléchit.
- XIII -
Il gèle en cette soirée de janvier. Place des Vosges le vent qui souffle fort oblige les rares passants à s'abriter sous les arcades. Clément, après sa dernière consultation, est descendu flâner. Malgré l'heure tardive, les galeries d'art sont encore ouvertes. Transi, Clément s'engouffre dans la galerie Médicis qui expose de très belles aquarelles. Voici peu de temps encore, il aurait discuté avec le gérant, se serait intéressé au peintre et aurait peut-être acheté l'une de ses ouvres. Mais aujourd'hui il se contente de faire un passage rapide, plus pour se réchauffer que pour admirer les tableaux. Le cour n'y est plus.
Depuis la semaine précédente Jean-Lou l'a quitté ou plutôt il l'a mis à la porte de chez lui. A cette occasion, il avait fait preuve d'une parfaite mauvaise foi. Violent, il n'avait pas mâché ses mots :
- Allez fiche le camp ! Tu as assez profité de mes largesses. Cherche-toi une chambre et ne remet plus jamais les pieds ici compris ?
Jean-Lou, pris à froid, tenta de résister :
- Alors tu me vires du jour au lendemain comme un malpropre ! Fumier !
- Si tu veux.
- Et l'école de théâtre que devient-elle dans tout ça ?
- Je continuerai à la subventionner comme par le passé. Ça te va ?
Jean-Lou avait haussé les épaules. Découragé il avait seulement ajouté :
- Jacques ne t'apportera jamais ce que je t'ai apporté. Je paie la note bien injustement !
- Sans doute. Allons ! Tu es jeune, tu t'en remettras. Comprend que j'ai besoin d'être seul. Je n'oublie rien des moments que nous avons passés ensemble. Nous avons eu notre temps et aujourd'hui ce temps est révolu. Il faut en prendre ton parti.
Jean-Lou avait fait ses bagages. Clément s'était retrouvé seul comme il l'avait souhaité mais le soulagement qu'il en attendait ne s'était pas produit. Pire, il éprouvait de plus en plus de la difficulté à assumer ses consultations. Rester des heures entières à écouter ses patients était devenu insupportable. Lui qui avait toujours fait preuve d'une patience infinie s'énervait. Les jours où Evelyne venait consulter étaient les plus terribles. Mais, au lieu d'y mettre un terme en confiant la jeune femme à un confrère, il continuait à la recevoir comme si, pris d'un soudain besoin de comprendre, il ne pouvait plus revenir en arrière.
Il dormait peu. Durant ses insomnies il se promettait d'arrêter, conscient qu'il jouait avec le feu. A force de raconter son enfance idyllique, réelle ou inventée, Evelyne avait fini par déclencher en lui un contre-transfert d'une violence inouïe. Un véritable électrochoc dont il ne se remettait pas. Il avait honte. Comment en était-il arrivé là ? Lui si maître de ses émotions ne contrôlait plus rien. En très peu de temps, sa passion pour Jacques, une passion qui relevait de l'impossible, et la venue d'Evelyne dans son cabinet avaient eu raison de son équilibre.
Après une nuit peuplée de cauchemars, il se réveillait le visage en feu, les membres glacés. Alors, les remords l'assaillaient. Pourquoi avoir cédé à Jacques ? Il le voyait encore, charmeur avec ce sourire narquois qui découvrait ses canines et lui donnait un air si conquérant, l'implorer de s'occuper d'Evelyne. Quelle superbe, quelle insolence ! Il avait plaidé et, comme dans le prétoire de Versailles, il avait gagné.
Si Clément renouait dans la souffrance avec un passé oublié, ses sentiments évoluaient. Epris d'une soudaine soif d'absolu il désirait de toute son âme que l'homme qu'il chérissait ne le repousse pas. Il voulait une place privilégiée où il serait accepté, écouté, compris. Il voulait seulement trouver ce qu'il n'avait jamais eu dans son enfance : un peu d'affection. Alors comment, dans ces conditions, renoncer à soigner Evelyne, unique maillon qui le reliait à Jacques.
Le passé de Clément n'avait rien de glorieux. Lorsqu'il regardait les choses en face il se rendait compte qu'il avait été floué. Parce que son père l'avait ignoré, sa mère l'avait pris en otage. Une mère abusive qui voyait en son fils unique un être exceptionnel. Seules les gouvernantes béni-oui-oui avaient été tolérées car il n'était pas question de contrarier le moindre de ses désirs. Bébé, enfant et adolescent il vécut adulé. D'un naturel docile, il acceptait sans rechigner de se plier à toutes les exigences de sa mère. Dominatrice, elle surveillait ses fréquentations. Dès la maternelle elle lui imposa ses compagnons de jeu qu'elle choisissait parmi les plus falots, écartant d'emblée les fortes têtes et les petites pisseuses insolentes. Comment dans ces conditions pouvait-il, trente ans plus tard, garder un bon souvenir de ses camarades de classe ?
Brave petit bonhomme haut comme trois pommes à genoux, elle l'avait dorloté telle une poupée fragile. Extravagante, elle l'habillait avec des vêtements bien trop élégants pour son âge. Timide, effarouché et totalement introverti, il avait fini par ressembler à une marionnette. Lorsqu'il accompagnait sa mère dans ses visites, les femmes n'avaient de cesse de le câliner, de lui offrir des bonbons, de le prendre sur leurs genoux. Elles n'avaient de cesse de caresser ses grandes boucles brunes que sa mère lui conservait contre la volonté de son père de les voir coupées. Ces caresses lui laissaient une étrange impression mais il trouvait agréable d'être ainsi choyé.
Il se sentait moins à l'aise dans les goûters d'enfants. Il osait à peine bouger, affublé d'un costume grenat orné d'une lavallière ou d'un jabot en dentelle qui lui donnait un air vieillot. Il jouait peu avec les autres enfants. Le plus souvent, il restait seul dans son coin et s'ennuyait. Pour le distraire, des grands-mères bien intentionnées se croyaient obligées de le gaver de sucreries et de lui raconter des histoires mièvres dont il n'avait que faire.
Clément voyait peu son père. Toujours en voyage, celui-ci n'avait pas le temps de s'occuper de lui. A son retour, il exigeait de voir les bulletins scolaires. Les mauvaises notes (et elles pleuvaient ! car Clément était un élève médiocre) engendraient de fortes réprimandes. Il fut question de le mettre en pension mais sa mère plaida sa cause. On se rabattit sur des cours particuliers qui étaient censés le faire progresser. Mais lorsqu'un répétiteur se plaignait de sa mauvaise volonté voire de sa paresse, sa mère le défendait. Comment pouvait-on parler ainsi de son fils ! Un enfant doué, incompris de ses professeurs. Elle n'hésitait pas à les accuser de parti pris et ne manquait pas de les renvoyer. Il en défila quelques-uns sans que Clément devienne pour autant un élève studieux.
A l'école, Clément passait inaperçu. On le disait gentil. Sans problème. S'il était puni, il supportait la punition sans broncher mais il était rarement puni. Par couardise il évitait tout conflit avec ses camarades. Un coup de poing le faisait fuir sans riposter. Combien de fois ne s'était-il pas fait traiter de poule mouillée ou de fifille à sa maman ?
Son enfance à Antibes puis son adolescence à Paris s'écoulèrent sans faits marquants. Il ne pratiquait aucun sport et n'en avait pas le goût. Fatigué à la seule idée de déchiffrer des notes sur des partitions, il avait refusé de prendre des leçons de piano. Il lisait peu. Curieusement il avait appris très tôt à jouer aux échecs et au bridge. C'était bien le seul domaine où il excellait.
En classe de troisième, Clément fut inscrit au lycée Charlemagne. Son dossier était pitoyable mais son père avait fait ce qu'il fallait pour qu'il soit accepté. Au lycée, il ne fit aucune étincelle. Perdu au sein d'une population d'élèves venus d'horizons très différents, habitués à remuer, à parler fort et à ricaner pour un rien, il ne s'était jamais adapté. Habitué au douillet cocon familial il se sentit vite exclu. S'il se méfiait des garçons pour leur brutalité, les filles qui depuis peu avaient envahi les établissements du secondaire lui faisaient peur. Il craignait par-dessus tout leurs sarcasmes.
Pour échapper à ses camarades il avait pris l'habitude, lui qui n'aimait pas lire, de se réfugier dans la bibliothèque du lycée. A cette occasion il découvrit les ouvres des grands auteurs romantiques inscrits au programme. Ce fut une expérience à laquelle il n'avait pas été préparé. Imprégné de toutes ces lectures il se mit à rêver d'amours idéalisées, de sentiments nobles et de déchirements sublimes.
C'est ainsi qu'il se fit piéger sans comprendre ce qui lui arrivait. Il était alors en classe de seconde. Furetant, un après-midi, à la recherche d'un livre sur les rayonnages de la bibliothèque, il fut interrompu par un jeune élève de quatrième qui lui demandait de l'aider à traduire sa version latine. Clément, malgré ses faiblesses notoires en cette matière, s'appliqua à lui rendre service. L'histoire se renouvela plusieurs fois et dépassa bien vite les limites autorisées entre adolescents. Des attitudes jugées ambiguës dénoncèrent très vite les deux lycéens. Convoqués chez le surveillant général, ils furent accusés des pires maux. Sans l'intervention de son père, Clément aurait été renvoyé. Son petit camarade le fut.
Cette malencontreuse aventure qui fit le tour du lycée marqua un tournant dans la vie de Clément. Meurtri par tant d'injustice il devint la cible des autres. Quolibets et paroles vexatoires fusèrent. Les filles surtout s'en prenaient à lui. Certaines n'hésitaient pas à lui tenir des propos orduriers (alors pédé ! ton éphèbe tu lui suçais le bout. et lui il t'enfilait.). Devant tant de malveillance il tentait de fuir mais elles le rattrapaient et tout recommençait.
Les vacances qui arrivèrent mirent enfin un terme à son supplice.
Clément garda en mémoire les moments heureux passés avec son jeune camarade et oublia la méchanceté dont il avait fait l'objet. L'année d'après il délaissa les romantiques et prépara mollement son baccalauréat. Reçu de justesse il s'inscrivit à la faculté de Médecine. Sans conviction !
Comme il ne montra aucun talent pour les dissections, comme il n'avait aucun atome crochu pour la physique et la chimie, il tripla son P.C.B. Ensuite, bon an mal an, il obtint son diplôme de médecin.
Ce fut sa mère qui, horrifiée à l'idée que son fils puisse désormais passer son temps à palper des ventres voire même à les ouvrir, l'incita à se diriger vers la psychanalyse. Il venait, sans le savoir, de trouver sa voie.
Adulte, Clément était devenu laid. Avec les années il avait fini par s'en accommoder. Seule sa petite taille le complexait encore. Autrefois timoré, il s'était affirmé. Son métier l'avait beaucoup aidé à forger son caractère. L'analyse qu'il avait été tenu de faire avant d'exercer lui avait permis de trouver un certain équilibre. Equilibre précaire qui ne demandait qu'à se rompre !
Malgré sa laideur, Clément remportait un succès fou auprès des femmes. Alors qu'il travaillait à l'hôpital, pendant son stage d'internat, il était devenu la coqueluche des infirmières. Baptisé poupinate de valium, un soir d'orgie en salle de garde, il avait découvert, à sa grande stupeur, que tout le personnel féminin raffolait de lui. N'importe quel prétexte servait pour l'accaparer. Quelles étaient loin les années où il était la risée des petites péronnelles de son lycée.
Malheureusement les femmes le laissaient indifférent. Homosexuel qui avait appris, en dépit des préjugés, à s'assumer, il les repoussait toutes sans exception. Car les rares fois où, par compassion, il avait cédé, il l'avait amèrement regretté.
- XIV -
A feu doux, au fond de la cocotte en fonte qu'elle vient d'acheter, les petits oignons grelots rissolent dans un mélange de beurre fondu et d'huile d'olive parfumé de thym et de romarin émiettés.
Un exploit ! Evelyne a accepté de s'y mettre. Après tout, elle n'est pas plus maladroite qu'une autre ! Cuisiner ne nécessite tout de même pas des talents hors du commun ! Enfin elle l'espère sinon l'exploit risque de se transformer en un échec. cuisant !
Bien sûr c'est Jacques qui l'a incitée à se lancer dans une telle entreprise.
- Pourquoi pas ? avait-il dit en riant.
Elle s'était faite un peu tirer l'oreille :
- Je ne sais plus rien faire. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas ouvert un livre de cuisine !
- Ça te reviendra j'en suis certain.
Elle avait cherché d'autres prétextes
:
- Tu trouves rentable de salir une foule de vaisselle et de passer un temps fou à remuer des casseroles quand, au bout du compte, tout sera avalé en quelques minutes ?
- Certes mais tu oublies le plaisir que l'on éprouve à réaliser soi-même un plat. Sais-tu que si j'avais du temps j'aurais plaisir à cuisiner.
Argument spécieux qui n'avait pas convaincu Evelyne mais qui avait eu le mérite de la faire sourire. Car à la seule idée de voir Jacques officier dans sa cuisine et d'y mettre le chantier, elle préférait encore se sacrifier.
Cuisiner n'avait jamais été l'une de ses préoccupations majeures. Célibataire, elle avait choisi de donner la priorité à sa vie professionnelle. Ce choix l'avait éloigné des tâches ménagères traditionnelles par trop souvent réservées aux femmes. Sans mari, sans enfant, elle ne s'était jamais trouvée dans l'obligation de préparer des repas. Aussi avait-elle pris l'habitude de se nourrir très simplement. Le soir, lorsqu'elle rentrait de son travail, elle se contentait le plus souvent d'un morceau de fromage, d'un yaourt et d'un fruit.
Après les oignons, les lardons. Elle a pris soin de les blanchir quelques minutes à l'eau bouillante comme elle avait vu faire sa grand-mère . voici bien longtemps.
Des gourmets et des gourmands ses grands-parents paternels ! Lorsque Evelyne allait chez eux elle était choyée. Elle se souvenait. Alors qu'elle n'avait que quatre à cinq ans, on l'asseyait devant une assiette (décorée d'un coq en son centre) remplie d'une purée crémeuse dans laquelle on creusait un cratère pour y mettre la viande, une tranche de rôti de veau coupé en petits morceaux, que l'on arrosait d'un jus onctueux. Pour le goûter, il n'était pas rare qu'elle eût à choisir entre une épaisse tranche de biscuit de Savoie, des madeleines ou des dents-de-loup.
Après les lardons : faire revenir les morceaux de lapin (à l'exception du foie).
Une bonne odeur commence à envahir la cuisine. Ne rien oublier. Dès que la viande est bien dorée, arroser d'une louche de bouillon de volaille et d'un décilitre de vin blanc. Saler. Poivrer (poivre du moulin : trois tours bien tassés). Couvrir. Laisser mijoter une bonne heure à petit feu. Les dix dernières minutes de cuisson : ajouter le foie.
Evelyne entasse la vaisselle dans l'évier. Maniaque, elle s'applique sur l'heure à tout nettoyer et à tout ranger. Soudain, l'odeur qui se dégage de la cocotte lui rappelle à temps de baisser le feu. Il ne s'agit pas de tout gâcher au dernier moment !
A l'heure du dîner la recette est prête et réussie. Jacques triomphe :
- Tu vois bien que tu te débrouilles comme un chef !
- N'exagère pas. Et puis, une fois n'est pas coutume ! Ne t'imagine pas que je vais me mettre aux fourneaux tous les soirs.
Evelyne se garde bien de montrer à Jacques que cette petite expérience culinaire ne lui a pas déplu. Aujourd'hui, c'est avec une certaine nostalgie quelle réalise à quel point elle a tout sacrifié à sa carrière. Repliée sur elle-même, elle est passée à côté de tant de choses importantes. Sincère, elle tente d'expliquer à Jacques ce qu'elle ressent. Mais lui moqueur se contente de s'esclaffer :
- Encore heureux que tu aies pris le temps de te faire draguer une fois ou deux !
Evelyne le regarde atterrée. Au lieu de l'aider il éprouve un malin plaisir à mettre l'accent sur une période encore récente qu'elle aimerait bien oublier. Soudain, la gibelotte de lapin n'a plus aucun goût.
Jacques la voyant les larmes aux yeux, regrette ses paroles. Alors il la prend dans ses bras. Doucement. Tendrement. Et il trouve les mots et les gestes qui effacent ses propos maladroits. Aujourd'hui elle a droit à un très gros câlin qui incite à tout pardonner.
Les premières fois qu'ils avaient fait l'amour, Evelyne avait été surprise par sa façon d'être à son écoute, contrôlant ses élans fougueux, respectueux de son rythme et ne se séparant d'elle que certain de l'avoir rendue pleinement heureuse. Jusque-là, elle n'avait jamais connu cette complicité où les corps sont à l'unisson et où tout bascule dans un univers merveilleux. Une histoire à fleur de peau qui ne demandait qu'à se répéter au fil des jours.
Des soirs comme celui-ci lui donnent l'impression de progresser, de sortir de son isolement. Serait-ce déjà les bienfaits de la cure analytique ? Et pourtant, elle souffre encore de violentes migraines comme celle qui l'a tenue éveillée la nuit précédente.
En ce samedi matin, elle était allée acheter le lapin et tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette. Découvrant qu'elle ne trouvait pas tout ce qu'il fallait chez les commerçants de son quartier, elle s'était énervée. Seul le marché de la rue Mouffetard, plus éloigné, lui avait donné satisfaction. Et encore ! Peu habituée à se faire servir elle avait perdu beaucoup de temps à chaque étal. Au volailler qui lui vendait un énorme lapin, bien trop gros pour deux personnes, elle n'avait pas osé en demander un plus petit. Dénicher des petits oignons grelots alors que la saison était passée, n'avait pas été simple. Le calvaire terminé, elle était rentrée chez elle, épuisée.
La nuit, elle avait somnolé quelques heures avant de se réveiller en transe. Tout de suite son esprit avait été accaparé par cette pièce voisine de la cuisine et qu'on appelait pompeusement l'office. Une vraie caverne d'Ali Baba !
Du sol au plafond : des placards, des placards et encore des placards. Au centre : un immense congélateur.
Son placard préféré : celui des bocaux. Elle le connaît par cour. Tous les bocaux sont là, alignés, ventrus, hermétiquement coiffés de leur caoutchouc rouge, classés par ordre de taille et d'importance. D'un côté : les haricots verts vert tendre, les tomates rubicondes, les prunes jaunes et noires, les pêches pulpeuses, les poires fondantes dans leur sirop, les framboises et les cassis rougeoyants, les compotes et les purées se tiennent gentiment compagnie. De l'autre : les cornichons, les oignons et les petits légumes au vinaigre, les cassoulets, les confits d'oie, les daubes de canard, les civets de lièvre, les pâtés, les rillettes représentent tout le stock de condiments et de charcuterie familiale accumulés au gré des cueillettes et des abattages.
Un second placard lui plaît bien. Il est vaste, profond. Il contient toutes les réserves de pâtes, de riz et de légumes secs.
De gauche à droite voici les spaghettis géants, les cheveux d'ange, les macaronis longs ou coupés, les papillons, les coquillettes, les torsettes, les cannellonis et les rigatonis prêts à farcir, les gnocchis sardes, les feuilles de lasagnes et les tagliatelles colorées en vert, orange ou jaune.
A Plus bas, ce sont les différentes sortes de riz : poli à grain long, blanc rond, brun ; les semoules et les farines de blé, de maïs, de sarrasin, d'avoine.
A Son imagination s'épuise. Elle ne retrouve plus la mosaïque de légumes secs. Au fond peut-être, derrière les pâtes à l'abri de la lumière ? Elle cherche désespérément les lentilles vertes et blondes, les pois cassés et les pois chiches, les haricots blancs, roses, rouges et noirs, les flageolets tendres et les Soissons moelleux. Malgré tous ses efforts elle ne les retrouve pas. Ont-ils seulement existé ? Elle réfléchit. Elle n'a jamais aimé les haricots et les lentilles. Alors pourquoi en aurait-elle acheté ?
L'inventaire s'achève par la réserve à sucre. Quinze kilos de sucre en morceaux. Dix de sucre cristallisé et autant de sucre en poudre. Deux de sucre de canne et deux de sucre brun.
Elle s'était enfin endormie en rêvant de caramel, de coulis de framboise, de charlotte aux fraises et d'une foule de desserts que lui préparait sa grand-mère quand elle était enfant. Le sucre ne lui donne jamais mal au cour et cette nuit-là les nausées ne furent pas au rendez-vous.
A son réveil, Evelyne avait éprouvé un sentiment nouveau. Comme si cette dernière crise n'avait plus rien à voir avec les précédentes. Elle avait moins souffert. Son imagination débordante lâcherait-elle enfin prise ?
- XV -
Evelyne avait prévenu Clément : elle s'absentait une semaine. Un congrès à Londres. Un congrès international organisé par la société anglaise « Fertility & Sterility ».
Elle n'était point mécontente d'interrompre son analyse. Depuis le début de l'année, on était déjà fin février, elle n'avait pas manqué une seule séance. Et malgré cet effort elle avait l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé. Certes, elle avait exhumé, non sans un certain plaisir, beaucoup d'événements qui s'étaient déroulés pendant sa petite enfance et qu'elle avait ensuite oubliés pendant des années. Certes, elle s'était laissée emporter par le plaisir de voir défiler sous ses yeux ces images anciennes, comme celles d'un vieux film retrouvé par hasard et qu'elle aurait visionné. Mais où toute cette chasse aux souvenirs allait-elle la conduire ?
La jeune femme était tombée amoureuse de la petite fille qu'elle avait été. Cet amour ne l'aidait guère à progresser mais l'aidait pour le moins à piéger Clément. En parlant sans cesse de cette gamine insouciante, heureuse de vivre, elle avait très vite compris qu'elle le mettait mal à l'aise. Plus encore, elle le faisait souffrir et cela la réjouissait. Il avait beau lui tourner le dos, elle devinait sans peine quand elle faisait mouche. Alors quelle jubilation !
Si on lui avait demandé les raisons de son comportement, elle aurait été bien en peine de les donner. Elle ne pouvait même pas accuser Clément de la recevoir mal ou de manifester quelque impatience à son égard. Non, c'était l'homme qu'elle détestait. Sa manière de l'accueillir, de l'écouter, de tousser, de prendre des notes sur son calepin, de l'interroger, enfin de la reconduire jusqu'à la porte après chaque séance. Toujours circonspect, toujours obséquieux.
Dans le rapide qui roule vers Calais, Evelyne s'accorde un moment de répit. Elle laisse ses compagnons de voyage deviser entre eux et se réfugie dans son passé, ce passé qui, désormais pour un rien, resurgit à la surface.
Le wagon où elle se trouve aujourd'hui est bien différent de ceux qu'elle a connus quand elle allait en vacances d'été, dans le Morvan, chez ses grands-parents paternels. A l'époque, elle voyageait avec sa mère car son père était déjà en sanatorium où il soignait une tuberculose contractée pendant la guerre alors qu'il était prisonnier dans un camp.
Pour éviter la promiscuité déplaisante des troisièmes classes toujours bondées, sa mère achetait des billets de seconde classe. Le voyage était long. Le train s'arrêtait souvent en rase campagne puis repartait à petite vitesse pour s'arrêter de nouveau quelques kilomètres plus loin. Dans les gares, il était fréquent d'attendre de longues minutes le signal du départ. Il faisait chaud. Par les fenêtres laissées entrouvertes, pour aérer, pénétrait une poussière noirâtre faite d'un mélange de suie et de débris végétaux que le convoi soulevait sur son passage le long des talus. Les escarbilles piquaient les yeux et faisaient toussoter.
Evelyne raffolait des bons vieux compartiments. Elle se souvenait des banquettes moelleuses dont les hauts dossiers étaient décorés du sigle de la Compagnie des Chemins de Fer. Elle revoyait les têtières en coton blanc, les énormes accoudoirs qui se coinçaient à tout bout de champ et que l'on avait bien du mal à relever. Elle avait en mémoire les photos en noir et blanc du Mont-Saint-Michel, du Pont du Gard ou des arènes de Nîmes encadrées d'acajou, au-dessous des filets à bagages.
Parce que la voie était interrompue en raison de travaux de réfection consécutifs aux bombardements, le train s'arrêtait aux Laumes. La suite du parcours se faisait dans un vieux car bringuebalant qui attendait les voyageurs sur la place de la gare. Tout le monde s'entassait comme il pouvait et l'on partait. Le chauffeur, d'un naturel musard, acceptait volontiers, moyennant quelques victuailles ou quelques billets, de faire un détour pour déposer paquets et passagers, jusque dans les hameaux les plus reculés. A chaque halte, il en profitait pour glaner ou colporter les dernières nouvelles.
Les routes étaient pour la plupart en très mauvais état. A chaque nid-de-poule, il fallait s'agripper solidement à son siège pour ne pas être projeté en l'air ou tombé sur son voisin. Parfois, le car, pris soudain d'un élan intempestif, déboulait à toute vitesse affolant les poules qui picoraient insouciantes sur le bord de la route ou bien réveillant les grands-pères qui somnolaient devant leur maison, assis au soleil,
Au terme du voyage, en fin d'après midi, tous les occupants du car étaient épuisés. Avec plus de deux heures de retard, le car se garait enfin sur la place du marché. A peine arrivée, le chauffeur se faisait apostropher violemment par un petit bonhomme qui gesticulait tel un diable sorti de sa boîte. C'était le grand-père d'Evelyne. Chef de gare à la retraite très à cheval sur les horaires, il refusait tout retard et le faisait savoir haut et fort. Mais le chauffeur qui n'était pas ému par cette agitation riait de bon cour. De fait, quelques instants plus tard, sous le regard ébahi des voyageurs, les deux hommes déchargeaient ensemble les bagages entassés sur le toit du véhicule. Quand tout était déchargé, le grand-père s'occupait enfin d'Evelyne et de sa mère. Il empoignait leurs valises et partait à grandes enjambées sans se soucier de savoir si elles suivaient.
Evelyne redescend sur terre. Le grincement des essieux indique que le train entre en gare de Calais. Le ferry-boat est à quai prêt à partir pour Douvres.
Evelyne rejoint les autres. Tout le laboratoire est là. C'est un déplacement en force. L'importance du congrès qui débute demain explique la venue de l'équipe au grand complet. D'autres équipes françaises seront également présentes. Et tout ceci à cause de Louise Brown, le premier bébé-éprouvette né en Angleterre, deux ans plus tôt.
Depuis la réussite spectaculaire des Anglais, la France est atteinte du syndrome de « l'in vitro ». L'honneur du pays est en jeu. Beaucoup de laboratoires sont concernés par le projet. Ainsi, le laboratoire dirigé par le « Grand Yaka » expérimente sur l'animal et contribue à préciser les mécanismes essentiels de la fécondation. Les résultats obtenus servent alors aux équipes médicales françaises qui travaillent d'arrache-pied pour parvenir enfin à mettre au point une technique fiable.
Entre les différentes équipes, la compétition est acharnée. Les secrets de fabrication sont bien gardés. Les échanges scientifiques se font rares et glaner des informations utiles reste du domaine de l'utopie. L'enjeu est trop important pour prendre le risque de se faire voler la recette du succès !
En revanche, dans un congrès, on peut apprendre bien des choses. Les chercheurs sont des gens bizarres. S'ils peuvent dissimuler leurs résultats, ils peuvent tout aussi bien, par besoin de se valoriser, devenir prolixes et livrer des renseignements confidentiels qui dès lors profiteront aux équipes concurrentes.
Evelyne n'aime pas l'atmosphère des congrès. Il y règne trop souvent une atmosphère détestable. Beaucoup partagent ce point de vue. Pris indépendamment le congressiste lambda le reconnaît volontiers. Mais devant ses confrères l'esprit de caste l'obligera à dire le contraire. Car il ne faut pas s'y tromper : sorti de son microcosme habituel le scientifique est un individu fragile qui pour se préserver devient vite agressif. On peut alors le comparer à un loup dont la férocité sera fonction de son rang.
C'est ainsi que dans la meute on distingue les Petits, les Moyens et les Grands Loups. Grand Loup fait autorité. C'est le conférencier de renom chaudement invité par les organisateurs du congrès. On a besoin de lui. Il est le seul (c'est ce qu'il pense en tout cas) capable d'aborder avec toute l'emphase nécessaire chacun des grands thèmes programmés. Il est le spécialiste confirmé. The best of the best! Grand Loup a l'habitude d'être écouté, d'être congratulé. A chaque interruption de séance, il se pavane, serre quelques mains (flattées d'être serrées) méprisant le reste de l'assemblée qui n'a d'yeux que pour lui. Grand Loup, dans ces moments-là, est presque devenu inoffensif : couvert de gloire et d'honneurs, il ne songe plus à mordre. Mais que quelqu'un vienne à lui déplaire et il retrouvera toute sa férocité.
Le loup le plus agressif c'est Moyen Loup. Il est le stéréotype du scientifique en cours d'ascension qui ne reculera devant rien pour parvenir à ses fins. Faim de loup ! Affable avec les uns, il cultive le don d'ignorer les autres et surtout ceux qui pourraient l'importuner par des questions sans intérêt pour lui. En cela, il imite Grand Loup. Mais son amnésie à une toute autre signification. Moyen Loup est à l'affût, le museau tendu, humant l'air ambiant, espérant seulement croiser un Grand Loup condescendant qui daignerait ne serait-ce que quelques secondes lui adresser la parole devant tout le monde. Car Moyen Loup aime se montrer. Pendant les sessions, ses interventions ne passent pas inaperçues. Il réclame le micro. Il gesticule. Tous les prétextes sont bons pour prendre la parole. Après chaque communication, il bombarde le conférencier de questions, non pas pour faire avancer le problème mais pour se mettre en avant. On le voit monopoliser l'attention à son profit obligeant les modérateurs à intervenir pour le faire taire. Pourtant un tel comportement n'est pas exempt de risques. En effet, lorsqu' à son tour, Moyen Loup exposera ses travaux, il y aura au moins dans l'assemblée un autre Moyen Loup qui, tout aussi rusé et aussi carriériste que lui, se chargera de lui rendre la monnaie de sa pièce en lui posant moult questions embarrassantes.
Quant à Petit Loup, il débute dans la carrière. Il se contente d'observer ses aînés et de les copier. Assis sagement à l'écart et assidu, il assiste à toutes les séances. Si, audacieux, il ose prendre la parole son intervention n'obtient pas toujours l'approbation de ses supérieurs. Car le Petit Loup qui se croit malin en voulant jouer les trouble-fête est condamné d'avance. L'imprudent apprendra très vite à ses dépens que la communauté scientifique privilégie toujours la langue de bois à un discours véridique qui dérange. Le meilleur Petit Loup c'est celui qui a l'échine souple et qui sait, en toutes circonstances, trouver le mot juste. Dans ce cas, il peut se permettre d'intervenir pour appuyer, tout en gardant modestement son rang, l'argumentation d'un Grand Loup et s'attirer ainsi la considération de l'assemblée. Et derrière le tendre pelage du louveteau à peine sevré on devine déjà l'épaisse fourrure du loup madré qu'il deviendra.
Une exception chez les Petits Loups : le kamikaze. C'est l'inconscient qui se lance à corps perdu, irrespectueux de toute hiérarchie. De deux choses l'une, ou il franchit toutes les étapes à pas de géant prenant tout le monde au dépourvu ou il ruine sa carrière en quelques minutes.
A côtés des loups, les louves. Leur nombre s'accroît d'année en année. Les Grandes Louves sont encore rares. Mais beaucoup de Moyennes Louves sont prêtes à payer le prix (célibat, pas de progéniture, douze à quatorze heures de travail par jour et très peu de vacances) pour y parvenir. Et aussi pour rivaliser avec les Moyens Loups.
Moyenne Louve a le handicap de son sexe. Elle ne doit rien négliger pour réussir. Elle doit être tout à la fois compétente et faire en sorte de ne jamais prêter le flanc à la critique. Où le loup, à niveau égal, peut se permettre l'à-peu-près, la louve doit être parfaite. Le respect de ses pairs elle ne l'obtient qu'à force de travail et d'acharnement. Alors seulement ses performances forcent l'admiration. Sûre d'elle, elle communique avec aisance, parlant le plus souvent sans note, et finit par faire autorité malgré la vigilance ombrageuse des Grands Loups. Mais la partie n'est jamais gagnée. Tout dépendra de sa pugnacité et de sa vigilance à éviter les crocs-en-jambe d'un loup embusqué au coin du bois.
Evelyne a l'étoffe d'une future Grande Louve. Malgré un caractère inquiet, elle sait très bien dominer ses appréhensions devant un public composé de sommités scientifiques. Loin de se laisser décontenancer, elle fait preuve d'une assurance étonnante, répondant calmement aux diverses questions qui lui sont posées. Un seul handicap : son anglais médiocre. Malgré de louables efforts Evelyne ne s'est jamais familiarisée avec cette langue. Et pourtant, en ce début des années 80, la majorité des congrès se déroulent désormais en anglais. Bien rares sont ceux qui acceptent encore le français comme langue officielle.
En fait, les chercheurs français n'ont rien fait pour sauvegarder leur autonomie linguistique. Bien au contraire, ils s'empressèrent pour la plupart de pactiser avec les chercheurs anglo-saxons. Quelques nostalgiques tentèrent bien d'engager un combat d'arrière garde mais, trop peu nombreux, ils ne furent pas entendus. Le processus d'élimination de la langue française dans le monde scientifique était engagé et rien ne pouvait plus l'arrêter. On vit alors des organisateurs de congrès nationaux où le français aurait pu encore trouver sa place, exiger l'anglais comme unique mode d'expression. On vit, peu à peu, l'ensemble des journaux scientifiques français ne publier que des articles rédigés en anglais. Même l'immuable Académie des Sciences a trouvé utile d'inclure des textes mi-français mi-anglais dans les Comptes Rendus qu'elle édite.
En un mot, le franglais se porte bien. Une telle compromission serait admissible si les revues françaises étaient largement diffusées à l'étranger, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps. S'il veut être lu, le chercheur français n'a qu'une possibilité : publier ses travaux dans des revues étrangères, de préférence américaines. La tâche ne lui sera pas facile car il va se livrer pieds et poings liés à des comités de lecture féroces.
La seule trace de résistance encore perceptible sont les cinq commandements qu'un jour, un chercheur facétieux composa pour se défouler. On peut encore en voir quelques exemplaires affichés dans certains laboratoires. Ils prêtent sans doute à sourire mais ils ont le mérite de dire la vérité.
1 - Article scientifique, dit de qualité,
En français ne publieras pas.
2 - Le titre de tes revues françaises
En franglais uniquement composeras.
3 - Acte d'allégeance toujours signeras.
Si tes articles, aux revues anglo-saxonnes présenteras,
4 - Tous tes textes amputeras
Comme le grand Sam te dictera.
5 - Si congrès de France ou de Navarre organiseras
Langue anglaise exclusivement exigeras.
La traversée de la Manche est mauvaise. L'hydroglisseur résiste mal à l'assaut des vagues. Evelyne a horreur du bateau. Rien ne vaut le plancher des vaches et des « viaux » comme aurait dit avec son accent morvandiau, la vieille paysanne qui venait faire le ménage chez ses grands-parents.
Cramponnée à son siège Evelyne évite de regarder l'horizon qui tangue. Elle ferme les yeux et pour oublier le moment présent se replonge dans le passé.
Les vacances là-bas c'était chouette ! La maison de ses grands-parents paternels était très différente de celle qu'elle habitait au bord de la rivière. Elle était construite en plein bourg. Elle était imposante. On l'avait bâtie autour d'une cour intérieure ce qui lui donnait un peu l'aspect d'une petite forteresse. Dans la cour, quelques arbustes. Evelyne se souvient du kerria constellé de fleurs jaunes qui poussait dru à proximité du vieux puits, du grand escalier de pierre qui conduisait au grenier et dont chaque marche était garnie d'un pot de géranium.
Le matin, elle était réveillée par les bruits qui montaient de la rue. Pelotonnée bien au chaud sous les édredons elle écoutait sans bouger les sons qui parvenaient atténués jusqu'à elle. Le plus matinal et le plus aigu venait de la fabrique de sabots quand on mettait la scie à bois en marche. Plus tard, venait le bruit des charrettes dont les roues résonnaient sur les pavés de granit. C'était alors qu'elle se levait. Encore vêtue d'une grande chemise de nuit blanche qui lui tombait jusqu'aux pieds, elle observait par la fenêtre les paysannes qui se rendaient à la laiterie. En général la camionnette, partie depuis l'aube faire le ramassage du lait dans les fermes avoisinantes, n'arrivait jamais avant dix heures. Deux ou trois coups de klaxon annonçaient sa venue. Le temps de décharger les bidons et la distribution commençait. On entendait alors le tintement caractéristique des laitières en aluminium que les femmes tendaient pour les faire remplir. Lorsque Evelyne apercevait sa grand-mère sur le point d'être servie, elle quittait sa chambre et se rendait à la cuisine.
La cuisine était très claire. Une large baie qui permettait au soleil d'y pénétrer dès le matin, en faisait une pièce très agréable. Et comme la cuisinière à bois était allumée en permanence, hiver comme été, il y faisait toujours chaud. Parfois même trop chaud, surtout l'été, quand le soleil était au zénith. Alors on éteignait pour quelques heures le fourneau et l'on baissait le grand store à rayures blanches et orange qui plongeait la cuisine dans une douce pénombre.
Pendant qu'Evelyne trempait ses tartines dans son bol rempli d'un chocolat mousseux, sa grand-mère, toute rouge, le chignon en bataille, les manches retroussées jusqu'aux coudes et sa robe protégée par un large tablier bleu noué serré autour de la taille se consacrait déjà à la préparation du repas de midi.
Si Evelyne avait une grand-mère maternelle très élégante, à l'inverse, sa grand-mère paternelle attachait peu d'importance à sa tenue vestimentaire. Menue et tout de gris-vêtue, elle faisait penser à une petite souris. Une petite souris qui passait son temps à cuisiner. Sa passion : mijoter de bons petits plats et tester de nouvelles recettes qu'elle transcrivait dans un gros calepin de moleskine noire.
Les recettes devaient beaucoup au jardin du grand-père. A la fois potager et verger, il se situait aux confins du bourg, à un petit quart d'heure de marche de la maison. Pour Evelyne se rendre là-bas était une joie. Munie d'un petit panier en osier que lui confiait sa grand-mère, elle allait, trottinant tant bien que mal derrière son grand-père. Celui-ci gâchait un peu sa joie car il la rudoyait volontiers. Dans le jardin, elle était priée de se tenir tranquille et d'obéir au doigt et à l'oil. Qu'elle écrase par inadvertance un pied de fraisier ou de haricots verts et il se fâchait. Inutile de finasser il voyait tout. Mais l'orage passé, il cueillait délicatement, malgré ses grosses mains déformées par les rhumatismes, les fruits qu'il destinait à son petit panier.
L'arrivée à Douvres est une délivrance. Demain matin le congrès commence.
- XVI -
Contre-sens. Sens interdit. Interdiction de stationner. Procès-verbal. Jacques perd patience devant la petite boulotte qui vient de l'arrêter au volant de sa voiture. Mais pourquoi avoir pris cette rue à rebrousse poil ? Il n'en récolte qu'ennui et contre-temps. Il a beau plaider l'inattention, les impératifs de l'heure et la distraction d'un homme harassé par son travail, l'affreux petit pot à tabac reste de marbre. Bien campée sur ses deux jambes (de véritables boudins !), le regard impénétrable, elle sort son carnet à souches et s'applique (pour un peu, elle tirerait la langue) à dresser contravention. Jacques, impuissant devant tant de zèle cesse de discuter. Sans un mot, alors que rase-bitume lui tend la feuille, il se contente de hausser les épaules d'un air désabusé. Toutefois, pour montrer sa mauvaise humeur, il démarre rageusement au grand dam de la voiture dont les pneus crissent d'une façon épouvantable.
Maintenant, dans la grisaille de février doublée d'une bruine glacée qui tombe depuis midi, Jacques cherche une place pour se garer. Une gageure, dans un quartier aussi encombré que l'est celui de la Bourse en ce début d'après-midi. Jacques soliloque. Pas exactement. En fait, il a pris l'habitude de parler à sa voiture et chose curieuse, celle-ci lui répond.
Lui : J'aurais dû prendre le métro.
Elle : Exact. Quelle idée de m'avoir conduite jusqu'ici ! Et par ce temps de chien !
Lui : Il faut bien que tu prennes l'air !
Elle : Parlons-en de ton air ! Pollué qu'il est ! Il faut que tu sois un sacré égoïste pour me traîner sous la pluie. Je suis tout de même mieux au garage ! Regarde ces encombrements, on n'est pas prêt d'en sortir !
Lui : Tais-toi Ernestine !
Elle : Cesse donc de m'appeler Ernestine !
Lui : Toutes mes voitures se sont appelées Ernestine. Tu ne déroges pas à l'usage. D'ailleurs tu sais très bien que c'est en souvenir de.
Elle : La barbe avec tes histoires anciennes ! Tout ce que je vois c'est que tu es en retard et qu'une fois de plus tu vas me laisser n'importe où au risque d'abîmer ma carrosserie ou pire de me retrouver en fourrière.
Lui : Je te promets que je vais faire attention.
Elle : Tu as intérêt car autrement je cale et refuse de redémarrer.
Jacques tourne en rond une bonne demi-heure avant de trouver une place digne de son Austin Morris. Au moment où il ferme les portes, la voix moqueuse d'Ernestine se fait entendre :
- Encore heureux que tu ne conduises pas une américaine, il te faudrait la journée pour te garer !
Mieux vaut ne rien répondre !
Arrivé chez son client, Jacques essoufflé s'excuse de son retard. Mais le petit homme chauve qui le reçoit, très compréhensif, le met tout de suite à l'aise :
- Un calvaire le stationnement par ici ! Et quel temps affreux ! Depuis deux jours mes rhumatismes me font souffrir. Avec toute cette humidité ! mais que diriez-vous d'un café et d'un petit verre de fine-champagne pour vous remettre de vos émotions ?
Sous l'effet de la caféine et de l'alcool Jacques se sent revivre. En un clin d'oil, il retrouve toute son énergie et se plonge aussitôt dans le dossier qu'il est venu consulter. Une affaire financière plutôt embrouillée. Cependant, sous l'oil ébahi de son client, il examine un à un tous les points litigieux en suspens et trouve très vite la parade pour chacun d'eux. Une heure plus tard, il possède assez d'éléments pour asseoir sa plaidoirie et gagner.
Fatigué, la tête vide mais fier de lui, Jacques retrouve le brouhaha de la rue. Ernestine l'attend ruisselante d'une pluie qui maintenant tombe drue. Un bruit assourdissant monte de la ville qui s'ébroue dans une eau boueuse que des voitures, lancées à toute allure, projettent sur les trottoirs, éclaboussant les piétons imprudents qui s'aventurent trop près de la chaussée.
Soudain Jacques a envie de fuir cette grisaille. Il se raisonne. Sa journée est loin d'être finie. De retour au cabinet, il doit encore recevoir une cliente en mal de baux impayés, lire et signer le courrier de l'après-midi préparé par Jeanne et enfin prendre connaissance des derniers appels téléphoniques. Assis dans sa voiture, il s'accorde quelques minutes de répit.
Ce soir, comme les soirs précédents, il sera seul. Evelyne est à Londres, à un congrès. Son absence l'a laissé tout désorienté. Au fil des mois, il a renoué avec la vie à deux et aujourd'hui il réalise à quel point il a besoin d'Evelyne, besoin de lui parler, de la toucher, de la voir s'appliquer à ne pas lui déplaire. En un mot il découvre qu'il l'aime et s'en étonne.
Jusqu'alors, Jacques s'était toujours enorgueilli d'être un homme indépendant, que rien n'atteignait et dont la force tenait à un caractère autoritaire et batailleur. Et voilà Evelyne avait tout changé. Cette petite femme fragile, plutôt timide et sans prétention avait réussi là où d'autres avaient échoué. Tout en douceur, sans jamais le prendre de front, elle l'avait transformé. Certes, la métamorphose était loin d'être complète. Habitué à trancher, son premier réflexe était encore de foncer sans réfléchir. Mais Evelyne l'avait placé dans l'obligation de moduler. A ses côtés, il apprenait à être moins catégorique et à refreiner son besoin de domination. Il acceptait de faire l'apprentissage des concessions réciproques. Ce qui pour lui était nouveau car il n'avait que trop en mémoire, les bagarres qui pour des broutilles éclataient si souvent entre sa femme et lui. Tandis qu'il s'entêtait, elle campait sur ses positions. Il revenait à la charge, certain d'avoir raison mais elle le contrait et ils cassaient de la vaisselle. Evelyne ne lui donnait pas envie de casser des assiettes. Bien au contraire, en sa présence il s'amadouait et devenait un adepte du dialogue partagé ce qui l'obligeait à contrôler son impétuosité naturelle.
Jacques qui n'a pas l'habitude des introspections se trouve soudain ridicule avec ses états d'âme. Agacé, il met le contact. Ernestine qui ne lui pardonne pas de l'avoir laissée sous la pluie se fait prier pour démarrer. Les essuie-glaces grincent et de la buée opacifie le pare-brise. La circulation est toujours aussi dense. A chaque feu, malgré la gesticulation des agents de la circulation, les voitures stagnent agglutinées à perte de vue. Gigantesque embouteillage qui fait oublier à Jacques le courrier à signer et la cliente qui l'attend. Ernestine à moitié asphyxiée hoquète mécontente :
- Nous ne sommes pas dans la bonne direction !
- Tais-toi et roule ! C'est moi qui décide jusqu'à preuve du contraire !
- Comme tu voudras.
Elle comprend quand elle aperçoit l'avenue du Bois. Il a l'intention de fuguer. C'est dans ses habitudes quand il est fatigué. Il peut rouler ainsi des heures entières sans desserrer les dents. Ernestine se fait à l'idée de passer une soirée mouvementée.
Par la porte Dauphine il la conduit vers ce qu'elle exècre le plus : la traversée du tunnel de Saint-Cloud. Elle doit affronter l'éclairage blafard, jaune pisseux, qui la déprime tant. Mécontente, elle hésite sur la chaussée glissante et luisante d'huile, elle s'imprègne de l'odeur âcre des émanations des pots d'échappement et, coléreuse, pétarade quand, contrainte et forcée, elle aspire le brouillard polluant qui monte du sol par nappes successives.
Coincée dans le flot de ses copines banlieusardes qui rentrent chez elles pare-chocs contre pare-chocs, elle émerge non sans peine. Après Versailles, elle reprend son souffle. La sachant avide de vitesse, Jacques lui donne les pleins pouvoirs. La pluie a cessé. La forêt de Marly, malgré sa tenue d'hiver, a fière allure. La crête des arbres perce un ciel plombé où, seules, quelques stries bleutées mettent un espoir d'éclaircie. Les lieux prennent soudain un aspect majestueux dont l'unique splendeur vient peut-être de ces bruns et de ces mauves entremêlés où se glissent parfois des ocres et des verts.
Grisée par la vitesse, Jacques s'enfonce dans une sorte de torpeur qui l'apaise et lui fait oublier sa solitude. Ce voyage impromptu où rien n'est programmé, où tout peut arriver d'un moment à l'autre, calme ses nerfs mis à vifs depuis le début de l'après-midi.
Après le péage de Mantes, il roule plus serein et abandonne Ernestine à la vindicte des grosses cylindrées rouennaises qui la doublent en trombe et imposent leur loi à grand renfort d'appels de phares. Ils voguent déjà entre chien et loup quand le soleil, prêt à se coucher, apparaît narquois et rougeoyant entre deux nuages, au ras de l'horizon.
Une subite envie d'aventure pousse Jacques à continuer sa folle escapade vespérale. Il quitte l'autoroute à Chaufour. Il effleure Evreux, traverse Lisieux la pieuse déjà endormie et rejoint, par-delà les collines, la route qui conduit à Honfleur.
Il fait doux. Le paysage a basculé dans l'ombre. Seuls les hameaux, éclairés par de pâles réverbères, laissent percevoir, tapies les unes à côté des autres ou bien accroupies dans les prés, les maisons en torchis au toit de chaume qui sont la fierté de la région.
Maintenant l'homme et la machine sont de connivence. Ils se pénètrent de la quiétude qui gagne les campagnes dès la tombée de la nuit. Dans l'obscurité, le ronronnement d'Ernestine fait figure de trouble-fête. Sur son passage, des insectes virevoltent affolés par la lumière des phares tandis que dans les fourrés se cache une faune apeurée par le bruit du moteur. Ils filent à vive allure entre des haies de pommiers noueux et hument à pleins poumons un air qui se veut de plus en plus marin au fur et à mesure qu'ils avancent.
Honfleur les attend dans la brume. Autour du vieux bassin, quelques acharnés de la balade postprandiale, emmitouflés dans d'énormes pull-overs et bien protégés par des cirés aux couleurs criardes, défient les violentes rafales de vent qui balayent la darse.
Après l'excitation du voyage qui l'a maintenu en éveil, Jacques se sent épuisé. Rentrer sur Paris est au-dessus de ses forces. Ernestine se tait. Une bonne nuit passée au chaud dans le garage d'un hôtel lui conviendrait à merveille. Son vou est exaucé quand, quelques minutes plus tard elle pénètre dans celui de l'Hostellerie du Cheval Blanc, ouverte malgré la morte saison.
Tandis qu'Ernestine entame sa nuit, Jacques se délasse. La chambre qu'on lui a attribuée au premier étage donne sur le port. Après un bain rapide, tout ragaillardi, il songe enfin à se restaurer. Au rez-de-chaussée, la salle à manger est accueillante. A cette heure tardive, les quelques clients présents achèvent de dîner. Le calme qui règne dans le restaurant permet à Jacques de goûter pleinement ce moment de détente.
Le plateau de fruits de mer est géant. Le vin blanc qui l'accompagne est sublime. Jacques s'applique à décortiquer, à suçoter, à aspirer sans rien laisser au fond des coquilles et des carapaces. Gavé de palourdes et de bigorneaux, repu d'huîtres et de moules, écouré par la mayonnaise qui accompagnait langoustines et crabe, il quitte la table.
Le lendemain matin, un soleil mesquin que les rideaux laissent à peine filtrer, le réveille. Jacques a repris ses esprits. Il pense à Jeanne et à Bernard qui doivent le chercher. Confus de s'être comporté d'une manière aussi inconséquente, il remet à plus tard son petit-déjeuner et se préoccupe de téléphoner au cabinet. Une fois. Deux fois. La sonnerie résonne dans le vide. Jacques commence à s'énerver. Où sont-ils tous ce matin ? Perplexe, il finit par raccrocher le combiné puis il tente d'appeler au domicile de Bernard. Là encore personne. Bizarre. En désespoir de cause il compose cette fois le numéro personnel de Jeanne. Serait-elle malade ? Jeanne décroche.
- Allô ! Jeanne ?
- Oui.
- C'est Jacques. Je voulais vous dire pour aujourd'hui.
- Aujourd'hui ? Mais nous sommes samedi ! Qu'avez-vous fait hier ? Bernard a dû s'occuper des affaires en cours.
Jacques bredouille de vagues excuses et raccroche. Ainsi il a oublié jusqu'au jour de la semaine ! Son insane aventure s'inscrit dans les normes d'un banal départ en week-end. Il n'a fait que ce que font des milliers de parisiens chaque vendredi soir : s'évader coûte que coûte. Plus stupide encore, il a atterri sur la côte normande où, dès l'arrivée des beaux jours, une multitude envahit les plages.
La journée s'annonce, sinon ensoleillée du moins dégagée et seule une légère brume matinale empêche d'apercevoir au loin le complexe industriel du Havre. La marée est haute. Les chalutiers partis la nuit dernière pêcher dans l'estuaire de la Seine rentrent au port avec leur cargaison. Chaque abordage est le signal d'une grande activité. Tant que tous les casiers ne sont pas déchargés ce sont des cris, des discussions et de nombreuses allées et venues entre le bateau et le quai. Ensuite, les marins se retrouvent tous au bar de la capitainerie.
Après avoir assisté à l'arrivée de la pêche, Jacques flâne quelque peu désouvré. Il s'aventure jusqu'à l'église puis revient sur ses pas. Que va-t-il faire de sa journée ? Une idée lui vient. Pourquoi n'irait-il pas faire une grande balade à pied au bord de la mer ? Il commence par s'équiper. Dans la seule boutique pour touristes ouverte, il fait l'acquisition d'un T-shirt, d'une casquette en toile bleue et d'une paire d'espadrilles noires. Puis, son paquet sous le bras il s'enquiert d'Ernestine. Celle-ci, un peu sensible à l'humidité mais de bonne composition accepte de démarrer sans problème.
Les voilà partis. Ils longent la côte jusqu'à Deauville. Jacques a retrouvé sa bonne humeur. Toutefois, lui qui déteste être seul, s'inquiète des heures à venir. La première euphorie passée il risque très vite de s'ennuyer.
Le bord de mer est désert. Jacques gare Ernestine à l'abri du vent, enfile le T-shirt sur sa chemise, chausse les espadrilles et retrousse son pantalon jusqu'aux genoux. Enfin, la casquette solidement ancrée sur le crâne, il s'avance sur la plage et marche face au vent et aux embruns. Sa dégaine pour qui le croise est plutôt cocasse. Des enfants se retournent sur ce grand escogriffe dont les pieds, à chaque enjambée, s'enfoncent dans le sable humide l'obligeant à se courber et à plier haut le genou comme un gorille à la poursuite de son ombre. Il souffre mais il tient bon. Il s'entête à patauger. Mais très vite ses espadrilles qui s'emplissent de débris de coquillages lui blessent la plante des pieds. Alors il finit par les ôter. Au contact de l'eau glacée, il frémit plus d'une fois quand une vague plus violente que les autres vient le surprendre. L'envie de faire demi-tour lui traverse l'esprit mais il résiste. Lui qui se dit sportif n'est-il plus capable d'endurer une simple marche juste un peu difficultueuse ?
De retour auprès d'Ernestine, il peine pour enfiler chaussettes et chaussures tant ses pieds sont gonflés et endoloris. Avec bien du mal il rectifie sa tenue vestimentaire : il secoue son pantalon plein de sable et humide et défripe sa chemise qui s'est toute chiffonnée sous le T-shirt. La marche lui a donné faim et lui rappelle qu'il n'a pas petit-déjeuner. Il se souvient d'une petite auberge qu'il a déjà maintes fois fréquentée avec des amis, de l'autre côté des bords de la Touque, à Trouville.
Rien n'est plus décevant que de trouver porte close quand on s'est réjoui de revoir des lieux dont on a gardé un bon souvenir et où l'on espère être reçu sinon en ami du moins en client fidèle, même si le patron a oublié votre visage depuis votre dernier passage. Devant l'affiche à peine visible tant la pluie l'a délavée, Jacques se trouve tout bête. Fermeture annuelle. Il aurait dû y penser : à cette époque de l'année beaucoup de commerces n'ont pas encore ouvert leurs portes. Que faire ? Dépité, il s'apprête à rebrousser chemin quand de gros nuages assombrissent le ciel et que quelques gouttes de pluie commencent à tomber. A deux pas un banal restaurant attire les clients par une carte aguicheuse. Jacques s'y installe sans beaucoup d'illusions. De fait, le service est lent, le personnel morose et surtout la nourriture des plus quelconques. Assis devant son assiette vide que la serveuse a oublié d'ôter alors qu'il en est au café, il se demande comment meubler les heures à venir. Maintenant il pleut averse et un vent fort s'est levé. La solitude reprend ses droits. Jacques se sent abandonné. L'idée de regagner Paris ne lui vient même pas ! Ernestine l'attend dans une rue voisine. Stoïque elle se tait. En désespoir de cause, la voyant toute trempée il décide de la mettre à l'abri dans le parking du grand complexe cinématographique de Deauville et d'aller voir un film pour tuer le temps.
La séance de quinze heures le sauve. On projette l'Arbre aux Sabots. Le film dure trois heures : de quoi occuper son esprit le reste de l'après-midi. Il se laisse porter par l'histoire des paysans de Bergame et finit par oublier sa solitude.
A la sortie du cinéma, Jacques retrouve la pluie, les bourrasques de vent et la nuit qui tombe déjà. Ernestine fatiguée de l'avoir attendu le reconduit jusqu'à Honfleur. La pluie est si violente, que les essuie-glaces parviennent à peine à chasser l'eau qui ruisselle sur le pare-brise.
Le petit port est désert. A l'hôtel, Jacques est heureux de retrouver sa chambre et de se doucher. Il était temps de rentrer car maintenant la tempête fait rage. Dehors, les plus endurcis ont déclaré forfait et il n'y a plus âme qui vive autour du vieux bassin.
Jacques dîne à peine. Il n'est plus question de fruits de mer et de petit vin blanc. Cette pluie qui tombe sans discontinuer a fini par le déprimer. Que faire ici de sa soirée ? A Paris, même par mauvais temps, il y a toujours possibilité de retrouver des amis du côté de Saint-Germain-des-Prés pour y prendre un verre ensemble. Mais ici, que peut-il espérer un samedi soir ?
Cloîtré dans sa chambre Jacques se réfugie dans la lecture du Monde puis s'attaque sans beaucoup de succès à la grille des mots croisés. Très vite le silence environnant lui pèse. Incapable de rester seul plus longtemps il descend au bar de l'hôtel où il se fait servir un whisky. Et c'est affalé dans un fauteuil qu'il termine la soirée en regardant la télévision qui diffuse une mauvaise série policière.
Dimanche matin, Jacques a retrouvé sa bonne humeur. Il quitte Honfleur sans regret et conduit Ernestine à vive allure jusqu'aux portes de Paris. Tout repart du bon pied. demain Evelyne est de retour.
- XVII -
Clément qui n'avait pas revu Jacques depuis le réveillon de Noël n'avait rien fait pour le rencontrer et ce malgré l'intense désir qu'il en avait. Depuis qu'il soignait Evelyne, la donne avait changé. Désormais, une seule chose importait : sa guérison. Jacques ne voulait rien d'autre et en cas d'échec, Clément était certain qu'il lui en ferait porter la responsabilité et cesserait toute relation avec lui. Du reste depuis qu'Evelyne venait chez lui, Jacques ne l'avait contacté qu'une seule fois, et encore par l'intermédiaire de Jeanne, pour l'inviter à Noël. Il n'était plus question d'un dîner en ville ou de la visite d'une exposition. Jacques le délaissait. Clément en souffrait beaucoup. Pour se consoler lorsque son moral baissait, il se raccrochait à l'idée que si Jacques gardait ses distances c'était peut-être pour me pas s'immiscer entre le psychanalyste et sa patiente. Mais, au fond de lui-même, il n'y croyait pas. Jacques n'avait pas l'habitude de s'encombrer de scrupules et s'il avait voulu se manifester rien ne l'aurait retenu.
Peu à peu, Clément perdait pied. Autour de lui tout s'effondrait. Même dans son travail, il ne voyait plus les choses comme avant. Il lui avait fallu plus de dix ans pour se faire un nom au sein d'une profession très fermée qui, au début, connaissant les appuis dont il avait bénéficié à plusieurs reprises ne lui avait pas fait de cadeau. Cependant, grâce à sa ténacité, il avait fini par acquérir une réputation non usurpée. Mais loin d'en tirer gloriole, il préférait se considérer comme le simple petit coup de pouce qui aidait les patients à repartir du bon pied. Sa clientèle chantait ses louanges. Il faisait des envieux parmi ses confrères. Et voilà qu'aujourd'hui le bel équilibre qui faisait de lui un homme serein était réduit à néant. Désormais, assis des heures entières à écouter ses patients, à les écouter encore, à les écouter jusqu'à ne plus pouvoir les supporter, il doutait de ses capacités au point de sombrer dans un complet reniement de lui-même.
Depuis sa rupture avec Jean-Lou, il regrettait amèrement les planches poussiéreuses du hangar de la rue Saint-Louis-en-l'Isle. Tous les comédiens qui faisaient partie de la troupe n'étaient pas très talentueux mais Jean-Lou savait les motiver. Clément avait déjà la nostalgie des bons moments passés en leur compagnie. A leur contact, il avait découvert ce que pouvait être les joies d'une franche camaraderie. De son côté, Jean-Lou par sa gentillesse spontanée et sa générosité toujours renouvelée, lui avait apporté beaucoup. En particulier, c'était grâce à lui, qu'il avait enfin assumé son homosexualité. Même si parfois Jean-Lou lui avait été infidèle, il restait, à ce jour, la seule et unique personne qui lui avait manifesté une affection sans condition, ce qu'il n'avait jamais connu auparavant.
Aujourd'hui, il avait tout détruit, tout sacrifié pour donner libre cours à une passion dévorante qui le minait et l'avait conduit à se comporter comme un parfait salaud. S'il n'y prenait pas garde, il risquait de se laisser entraîner dans une spirale infernale dont il ne sortirait plus. Evelyne, Jacques et Jean-Lou les trois protagonistes de cette histoire s'étaient, à leur corps défendant, ligués contre lui, le fragilisant à un point qu'ils ne pouvaient pas imaginer.
Evelyne d'abord dont les visites régulières et les souvenirs d'enfance l'avaient conduit à s'interroger sur lui-même, ce qu'il s'était toujours interdit de peur de revivre un passé douloureux dont il voulait à tout prix se détacher.
Jacques ensuite qui, parfaitement conscient de ses sentiments à son égard, avait profité de sa faiblesse pour l'obliger à soigner Evelyne.
Enfin Jean-Lou qu'il avait renvoyé comme un malpropre.
Un soir que les remords l'assaillaient plus que de coutume, Clément se rendit à l'école de théâtre. Il arriva en pleine répétition. Un jeune comédien le remplaçait dans le rôle d'Ubu. Jean-Lou s'évertuait à le convaincre de se laisser aller à plus d'extravagances comme le demande le personnage.
Clément assis en retrait, observait les acteurs. Jean-Lou lui parut très amaigri. A le voir ainsi, toujours aimable et sans rancune (il lui avait souri et fait un signe amical lorsqu'il l'avait aperçu) il se traita d'égoïste et des larmes lui montèrent aux yeux.
Emu, Clément assista à toute la répétition sans intervenir. Conscient d'avoir déserté le groupe, même s'il participait encore à son entretien, il considérait qu'il n'avait plus son mot à dire sur le jeu des acteurs. Du reste, il reconnaissait qu'ils se débrouillaient très bien sans lui. Jean-Lou malgré son air fatigué les menait rondement mais sans pour autant leur asséner des remarques désobligeantes qui auraient pu les décourager.
Depuis le début de la saison, la troupe commençait à faire parler d'elle. Quelques critiques élogieuses formulées à l'occasion de représentations données dans un petit café-théâtre de la rive droite l'avaient sortie de l'anonymat. Maintenant c'était aux comédiens de donner le meilleur d'eux-mêmes.
La répétition terminée, Jean-Lou vint rejoindre Clément :
- Quel bon vent t'amène ?
- Je passais juste et. je voulais savoir comment tu allais.
- Ça va, je te remercie.
- Tu as l'air fatigué.
- Un peu. J'ai galéré ces derniers temps, c'est sans doute pour cela.
- Où loges-tu ?
- Chez des potes à Montmartre. J'y reste jusqu'à fin mars. Après ils doivent déménager et moi aussi.
- Et côté travail ?
- J'ai décroché un rôle dans un café-théâtre trois soirs par semaine ; le reste du temps je fais des petits boulots. Dans l'ensemble je me débrouille. Toujours pareil quoi ! La sécurité ce n'est pas pour moi tu le sais bien.
- Je sais Jean-Lou. Je regrette qu'on se soit séparé ainsi.
- Ne regrette rien. Cela devait arriver un jour ou l'autre. Nous n'allions pas ensemble. Je suis trop minable pour un type comme toi.
- Ne dis pas ça ! Tout à l'heure en te regardant je me disais : il est bon. Tu as du talent. Seulement tu n'as pas assez confiance en toi.
- Tu dis ça pour me faire plaisir mais au fond de moi-même je sais bien que je suis un raté.
- Moi aussi je suis un raté ou plutôt j'ai raté beaucoup de choses, crois-moi.
Ils discutèrent longtemps. Jean-Lou qui, depuis leur séparation, s'était résigné à tourner la page ne voyait plus en Clément qu'un passé encore un peu douloureux, mais un passé déjà lointain. En revanche Clément éprouvait encore un fort sentiment de culpabilité. D'avoir pu parler l'avait un peu soulagé. Ne sachant comment faire pour se donner bonne conscience, il crut y parvenir en proposant à Jean-Lou d'emménager dans la chambre de bonne dont il disposait au-dessus de son appartement. Tentative maladroite que Jean-Lou déclina ;
- Merci Clément mais je préfère m'en sortir seul. Tu comprends ?
Clément n'insista pas. Cette rencontre atténuait quelque peu les remords qu'il pouvait avoir mais il n'en demeurait pas moins qu'il restait bien seul face à lui-même.
- XVIII -
Mars les surprit fatigués. Jacques aurait volontiers pris une semaine de vacances pour aller skier à Val d'Isère. Mais, entre Evelyne qui ne trouvait jamais le moyen de quitter son laboratoire (sauf pour partir en congrès !) et Bernard qui accumulait les dossiers en retard et qui réclamait de l'aide, il dut y renoncer.
Loin de lui avoir changé les idées, son week-end normand sous la pluie l'avait irrité. Evelyne, qui à son retour de Londres, avait eu le malheur d'en rire s'était aussitôt fait rabrouer :
- Ça ne t'arrive jamais de te tromper ?
- Mais.
- Oh ! Ça suffit ! Tout le monde ne peut pas se réfugier derrière une migraine n'est-ce pas ?
- Tu es injuste !
Jacques était injuste et le savait très bien. Seulement voilà Evelyne l'avait agacé avec son congrès. Elle était rentrée avec plein d'anecdotes et ravie d'avoir appris une foule de choses. Maintenant elle était certaine, bien qu'aucun chercheur français ne soit revenu avec la recette exacte du bébé-éprouvette dans ses bagages, elle était certaine que la réussite était proche. Jacques à force de l'écouter en avait par-dessus la tête de la fécondation en bouteille. Evelyne ne pouvait-elle pas s'abstenir d'en parler quand il était là ?
Cette jalousie injustifiée avait failli gâcher leurs retrouvailles. Et pourtant, la veille encore, chacun d'eux se réjouissait de revoir l'autre. Mais ce qu'ils avaient oublié c'est que, une fois éloignés l'un de l'autre, ils avaient retrouvé leurs vieux réflexes de célibataire. Elle : celui de tout sacrifier à son travail. Lui : celui de dominer quelle que soit la situation. Qu'Evelyne puisse exister ailleurs à part entière le gênait. Il avait beau faire des efforts pour s'améliorer, il ne supportait pas qu'elle mette en avant sa vie professionnelle lorsqu'ils étaient ensemble.
La réaction de Jacques n'avait nullement surpris Evelyne. Très réservée sur le sujet, elle ne l'avait pas habitué à s'étendre sur ses activités de chercheur. Pour la première fois, parce que le congrès avait été passionnant, elle n'avait pas résisté à l'envie de lui en donner un compte rendu détaillé. Elle avait espéré que, sans montrer un grand enthousiasme, il lui aurait pour le moins accordé un peu d'attention. Eh bien c'était raté !
La jeune femme accusa le coup mais eut l'intelligence de ne pas insister. Il y a peu de temps encore, elle aurait été bouleversée par tant d'indifférence. Et pour ne pas souffrir elle aurait choisi de couper les ponts. Mais aujourd'hui, le jeu en valait-il la chandelle ? Voulait-elle se retrouver seule et reprendre une vie solitaire comme celle qu'elle avait menée toutes ces dernières années ? La réponse était non. Dès le début de leur liaison, Jacques ne lui avait rien caché, il avait eu l'honnêteté de se montrer tel qu'il était : autoritaire et enfant gâté. Alors pourquoi tout gâcher à cause d'un banal incident ? Du reste si cet incident n'avait pas atteint son amour-propre de chercheur elle n'y aurait sans doute pas attaché autant d'importance. Quand ils s'étaient rencontrés Jacques avait paru intrigué par le microcosme des laboratoires où elle évoluait mais très vite il avait cessé de l'interroger sur un monde si différent du sien et qui, sans qu'il veuille le reconnaître, l'intimidait. Ne lui avait-il pas souvent répété que pour lui, les chercheurs étaient des gens à part, des gens en marge des réalités quotidiennes et des contingences matérielles. Tous des sortes de professeur Nimbus obnubilés par leurs travaux et incapables de s'intégrer dans la vie ! D'ailleurs n'en était-elle pas le parfait prototype avec cette névrose qui lui pourrissait la vie ?
Evelyne prenait peu à peu conscience de l'ambiguïté de la situation. D'un côté il y avait le Jacques généreux prêt à tout pour la voir guérir et de l'autre, le Jacques dominateur qui ne voulait voir en elle que la femme fragile qu'il entendait protéger. Jusque-là elle avait accepté qu'il menât le jeu car elle devait bien l'admettre, elle y avait trouvé son compte. Avoir été remarquée par un homme dont le charisme n'était plus à démontrer l'avait flattée. Qu'il veuille tout régenter était sans doute excessif mais elle devait reconnaître que le laisser décider à sa place était reposant. A elle, maintenant, de savoir le modérer quand vraiment il dépassait les bornes. En douceur sans jamais le prendre de front. Ce qu'elle avait déjà tenté à maintes reprises et avec succès, ce qui lui avait fait découvrir, à sa grande surprise, qu'elle exerçait sur lui un certain ascendant.
Leur différend s'évanouit sur l'oreiller. Evelyne retrouva le corps puissant de Jacques. Elle n'eut qu'à blottir sa tête au creux de son épaule pour se sentir bien. Réfrénant le désir violent qu'il avait d'elle, Jacques s'appliqua à prolonger des prémices, la caressant longuement, tendrement. Peu à peu, il sentit monter en elle un désir tout aussi violent que le sien et lorsque, enfin parvenus tous les deux au bord de l'orgasme, il la pénétra, leurs deux corps s'unirent dans une infinie plénitude.
Moments privilégiés qui se renouvelaient à chaque étreinte et dont ils étaient les premiers surpris. Car ni l'un ni l'autre aussi surprenant que cela puisse être n'avaient jamais rien connu d'aussi intense jusqu'à ce jour. Si Jacques plus instinctif qu'Evelyne, faisait l'apprentissage d'un plaisir à chaque fois décuplé mais ne cherchait pas à en faire l'analyse, elle, plus émotive s'inquiétait de cette connivence sexuelle poussée à l'extrême. Ne risquait-elle pas de les entraîner dans une dépendance qu'ils pourraient bien un jour, l'un et l'autre regretter ?
Quelques jours après son retour, Evelyne se rendit chez Clément. Elle le trouva changé. Encore plus bizarre que d'habitude. Mais elle n'eut pas le temps de s'en préoccuper davantage car, emportée par son passé, elle plongea, tête baissée, dans les profondeurs de ses souvenirs.
Clément n'essayait même plus de l'orienter. Il espérait seulement qu'à un moment donné la machine allait enfin gripper et qu'Evelyne perdrait pied. Mais hélas, au rythme où elle avançait dans le déballage de son histoire, ce n'était pas encore pour cette fois. Aujourd'hui elle avait éprouvé le besoin de parler de sa mère. Sa mère ? Au dernier moment elle avait quelque peu hésité puis elle s'était lancée mais au lieu d'aller droit au but, elle procéda par circonlocutions successives ce que bien évidemment Clément s'empressa de noter.
Elle revint sur cette année où, après les vacances, de retour dans la maison au bord de la rivière, elle jouait des heures entières, toute seule dans son coin, avec une boîte de cubes ou des coloriages. Elle s'ennuyait et devenait, au dire des grandes personnes, insupportable. On décida d'un commun accord (à l'exception de son papa qui la trouvait encore bien petite, mais son papa n'était pas souvent là pour donner son avis et encore moins écouté) de l'envoyer à l'école.
Elle avait quatre ans, un tablier noir à parements rouges, un cartable en cuir usagé et un gros chagrin. Inscrite au cours Sainte-Anne, elle s'adapta tant bien que mal à l'ambiance guindée qui y régnait. Très vite, elle ânonna « papa a vu toto » et « je vous salue Marie » avec la même ardeur. L'histoire de Jésus et des Apôtres lui plaisait bien. Elle trouvait drôle que, dans le pays où ils vivaient, les gens dorment sur le toit de leur maison et marchent à la surface de l'eau.
Le dimanche, elle accompagnait sa mère à l'église. Dans la famille on pratiquait peu mais on allait à la messe. C'était l'occasion de mettre les vêtements du dimanche. L'hiver, sa mère revêtait le plus souvent une redingote beige en gabardine de laine avec, au col et aux poignets, une parure en mouton doré. Aux beaux jours, elle portait un tailleur en flanelle bleu-marine qu'elle avait confectionné elle-même et un chemisier en crêpe de Chine blanc. Quant-à Evelyne, elle était autorisée à mettre une jolie jupe plissée bleu foncé bien maintenue à la taille par de larges bretelles, un corsage à col Claudine et à manches bouffantes et un petit manteau en lainage blanc.
Pendant l'office, elle s'en donnait à cour joie. Elle s'amusait à détailler tous les galurins qui, sortis de la naphtaline pour s'imprégner des odeurs mêlées d'encens et de bougies consumées, écoutaient religieusement (!) le prêtre faire son sermon du haut de la chaire. Kyrie Eleison : une kyrielle de têtes chapeautées fleurissaient à la sainte table pour communier. Agnus Dei : défilé des têtes courbées sous le regard satisfait de la modiste qui, assises en retrait sur son prie-Dieu, comme pour assister à un défilé de mode, jugeait ses ouvres d'un oil critique. Ite missa est. Ils chantaient tous en chour « chez nous soyez reine, régnez en souveraine » puis sortaient de la pénombre en clignant des yeux. Sur le parvis de l'église, le bedeau bedonnant coiffé d'un tricorne et chaussé de bas blancs et de richelieus à boucles argentées les regardait passer tout en frappant sa hallebarde contre le sol pavé, au rythme des cloches qui sonnaient à toute volée.
Sur le chemin du retour, sa mère s'arrêtait pour s'entretenir quelques instants avec des gens qu'elles croisaient. Evelyne en profitait pour observer toutes ces personnes qui rentraient chez elles les bras chargés de provisions achetées à la dernière minute : du pain, des gâteaux (ceux du pâtissier en face de l'église étaient extra !) ou bien encore des fleurs. Elle aimait savoir où ils habitaient et imaginait la manière dont leur intérieur était meublé. Toujours à l'affût d'une porte entrouverte sur un corridor, une cuisine ou une salle à manger, elle donnait alors libre cours à son imagination débordante.
Le dimanche, ils déjeunaient dans la salle à manger où, l'hiver, un gros poêle Godin maintenait une douce chaleur. Le menu, malgré tous les efforts culinaires de sa grand-mère (aucune comparaison avec l'autre !) qui l'avait préparé pendant qu'elles assistaient à la messe, n'était jamais très réussi. Evelyne qui en gardait un souvenir mitigé se rappelait un traditionnel bouf bourguignon trop sec, une purée trop aqueuse et un gâteau aux pommes qui tenait au ventre pour le reste de la journée.
Parfois, son oncle venait leur rendre visite. Evelyne raffolait de son oncle. Les privations de la guerre ne l'avaient pas fait maigrir. Il était resté gros, gras, véritable cochon de lait à l'oil vif. C'était un homme qui avait l'esprit frondeur et une passion pour l'Empereur Napoléon. Il connaissait toutes ses campagnes, les dates exactes de ses batailles et pouvait ainsi discourir des heures sur le sujet. Son caractère facétieux le poussait souvent à dire et à faire beaucoup de bêtises. On gardait encore en mémoire une anecdote qui résumait bien à quel point il pouvait se montrer désinvolte et inconséquent dans ses propos. C'était au sujet du vin de messe qui était fourni par la maison. Un jour, voyant arriver un très jeune et nouveau vicaire envoyé par la cure pour prendre livraison du vin blanc prévu à cet effet, son oncle ne put s'empêcher de l'interpeller :
- Votre hiérarchie n'a pas honte de commander un vin aussi quelconque ? Il s'agit pourtant du sang du Christ nom de Dieu ! Si les grognards de l'Empereur avaient bu une aussi mauvaise piquette avant de partir au combat, il est certain qu'ils seraient tous morts d'un ulcère avant d'engager la bataille !
Et d'ajouter devant l'air effaré du petit curé qui se demandait bien ce que Napoléon venait faire dans tout ça :
- Le Christ mérite mieux ! Servez-lui un Sancerre. Vous verrez, il sera ravi.
Il fallut toute la diplomatie du grand-père d'Evelyne pour que l'incident n'ait pas de retombées fâcheuses sur la réputation de la maison qui, de surcroît, avait toujours mis un point d'honneur à approvisionner la cure, à titre gracieux, avec un excellent Aligoté.
Lorsque son oncle venait à la maison, Evelyne lui demandait de lui parler de Joséphine de Beauharnais du temps où elle habitait à la Malmaison. Elle voulait tout savoir sur cette grande et belle demeure. Elle voulait les moindres détails sur les salons, l'immense salle à manger, les cabinets particuliers, les chambres, les écuries, le parc. Elle ne cessait de poser des questions :
- Dis, c'était une grande maison blanche ?
- Oui, une très grande maison, toute blanche. Mais tu sais elle existe encore !
Son oncle la prenait sur les genoux et lui narrait la vie de l'impératrice. Alors Evelyne se projetait dans un monde merveilleux, un peu comme celui qu'elle voyait représenté sur les motifs de la toile de Jouy qui recouvrait les murs du petit salon du rez-de-chaussée où toute la famille avait l'habitude de prendre le café après le déjeuner. Elle rêvait devant les scènes champêtres où des jeunes femmes enrubannées et rubicondes se balançaient sur des escarpolettes que des jeunes gens, précieux et poudrés, le regard énamouré, poussaient doucement. Moutons et brebis paissaient à proximité d'un élégant petit pavillon de chasse où d'autres personnages semblaient se rendre deux par deux en se tenant par la main. Elle trouvait que la maison était bien exiguë pour accueillir autant de monde. Elle finit par imaginer que ce n'était qu'un petit salon de thé où ils venaient se désaltérer. Car tous ces gens si richement vêtus possédaient sans nul doute des palais aussi vastes et aussi bien décorés que celui de Joséphine.
Les dessins naïfs de cette tapisserie avaient un air de famille avec ceux qu'elle avait découverts chez le photographe à l'occasion d'une visite avec sa mère. Tout de suite, elle avait été séduite par tous les décors travaillés en trompe l'oil qui servaient de toile de fond et devant lesquels on posait. Il suffisait de choisir l'un d'eux pour être immortalisé par l'objectif devant un cadre idyllique. Elle avait choisi la toile qui représentait un jardin d'hiver. Puis, assise dans un délicieux petit fauteuil en rotin blanc, elle s'était laissée, le temps de la pose, transporter dans un univers de verdure luxuriante et de moiteur délicatement parfumée. Depuis, à chaque fois qu'elle regardait son portrait accroché au mur de sa chambre, elle se remémorait la scène.
Depuis le début Evelyne n'avait pas arrêté de parler. Clément retenait son souffle. Elle divaguait. Il la laissait faire sans l'interrompre. Il avait l'impression qu'elle se délectait de son passé comme d'un dessert dont on ne se lasse jamais. A quel moment allait-elle enfin avoir une indigestion ? La séance se prolongeait et elle continuait, continuait, continuait encore.
Pendant ses deux premières années d'école, Evelyne travailla dur pour apprendre à lire et à retenir ses leçons. La lecture allait l'entraîner dans un monde fabuleux où son imagination trouvait écho. C'était le monde des fées, des gnomes, des sorcières, des rois, des chevaliers et des princesses. Envoûtée, elle passait des heures le nez plongé dans des histoires passionnantes où il était toujours question d'une héroïne innocente qu'un valeureux prince arrachait de justesse à ses bourreaux.
En classe, on lui enseignait qu'il fallait toujours avouer ses fautes, rester sereine dans l'adversité et pardonner à ses ennemis (on te frappe sur la joue droite, tends la gauche !). Joli programme qui n'était guère compatible avec les réalités de la vie mais qui avait contribué pour une grande part à faire d'Evelyne une enfant puis une adolescente très émotive et facilement culpabilisée.
Un jour, Evelyne fut autorisée à aller seule à l'école. Cette émancipation elle la devait en partie au fait que sa mère attendait un bébé. Celle-ci, assez fatiguée, était obligée de se reposer. L'arrivée de cette grossesse avait été qualifiée d'accident déplorable. La grand-mère d'Evelyne ne se cachait pas pour dire à quel point elle était choquée. Comment un homme qui n'avait pas de santé pouvait-il agir avec autant de désinvolture vis-à-vis de sa femme ? Evelyne ne comprenait pas ce qu'on reprochait à son père. Car, elle l'aimait très fort son papa et elle voyait bien que les autres membres de la famille le critiquaient sans arrêt. A chaque fois qu'il était question de lui, sa mère ne disait rien mais elle prenait un air de femme trahit par le destin.
Evelyne n'aimait pas beaucoup sa mère (elle ne disait que très rarement maman). Elle trouvait qu'elle manquait d'élégance (sauf le dimanche quand elle faisait un effort) et regrettait qu'elle n'ait pas le chic de sa grand-mère. C'était une femme stricte qui faisait passer le sens du devoir avant tout autre chose. Avec elle pas de cajoleries ni de bisous à répétition. Elle exigeait d'Evelyne une obéissance aveugle et une reconnaissance inconditionnelle pour l'éducation qu'elle lui dispensait. Difficile à assimiler quand on est une enfant sensible plus attirée par l'imaginaire que par la dure réalité des choses.
Evelyne aurait adoré que son père s'occupât d'elle. Comme le faisaient son grand-père et son oncle. Hélas ! Elle n'avait que deux ans quand il était parti se soigner dans un sanatorium. Les soins qu'on lui prodiguait le fatiguaient beaucoup et, quand il rentrait à la maison pour une permission de quelques jours, elle n'avait pas le droit de grimper sur ses genoux. Lui aurait bien aimé mais il ne voulait pas prendre le risque de la contaminer. Alors Evelyne le regardait de loin et lui, tout pâle, allongé dans une chaise longue, se contentait de la dévorer des yeux et de lui sourire.
D'un naturel doux et peu combatif, le père d'Evelyne se laissait facilement dominer par les événements et les gens. La maladie avait eu raison de son énergie ; sa belle-famille et son épouse, en prenant l'habitude de décider à sa place, avaient fini par lui ôter le peu d'envie qu'il avait encore de lutter.
La naissance d'un second enfant l'avait laissé perplexe. C'était inimaginable. Car lorsqu'il y réfléchissait, il pouvait compter sur les doigts d'une main les fois, où ces derniers mois, sa femme avait supporté de faire l'amour. Certes, elle n'avait jamais été un gouffre de tendresse mais depuis qu'il était malade elle trouvait tous les prétextes pour refuser la moindre étreinte charnelle. En outre, il était certain d'avoir pris ses précautions d'autant qu'à chaque fois elle ne manquait pas de le lui rappeler d'un ton sec, peu disposée à supporter les conséquences d'un acte qu'elle subissait et dont l'achèvement n'était que souillure.
Et maintenant elle était enceinte. Il en était heureux et malheureux tout à la fois. Heureux parce qu'il aimait les enfants, malheureux parce qu'il n'était pas assuré de vivre assez longtemps pour voir Evelyne et son petit frère ou sa petite sour grandir.
Evelyne n'avait pas conscience du drame familial qui se jouait. Elle ne comprenait pas pourquoi ses parents étaient consternés par cette prochaine naissance. Elle avait fini par interroger son grand-père :
- Ça coûte donc si cher d'acheter un bébé ?
- Non, avait-il répondu avant d'ajouter pensif : pas vraiment mais vois-tu Evelyne ton papa est malade et pour l'instant il ne gagne pas assez d'argent pour élever plusieurs enfants.
- Oui mais toi tu en gagnes. Avait-elle dit pour se rassurer.
- Bien sûr mais je vieillis et je ne serai pas toujours là.
Evelyne n'avait pas insisté. Les problèmes des grandes personnes la dépassaient.
Elle mit à profit la liberté relative qui lui était désormais accordée pour se faire des amies. Ses premières relations avec les petites filles de son âge furent assez difficiles. Car elle dut très vite compter avec les petites garces, les idiotes, les ombrageuses et. avec leurs mères. De cette période elle garde des souvenirs mitigés. Il lui revient en mémoire les brimades dans la cour de récréation où deux ou trois emmerdeuses, fortes du fait que leur mère quêtait à la messe le dimanche ou que leur père, médecin, soignait la maîtresse du cours moyen, imposaient leur loi. Les hiérarchies s'établissaient en fonction de détails insignifiants mais amplifiés par la directrice de l'établissement qui se montrait souvent partiale dans ses jugements. Malgré tout, de temps à autre, Evelyne parvenait à sortir du rang et à susciter de la part des autres une certaine considération. C'était la croix épinglée sur son tablier pour la récompenser de sa bonne conduite ou bien la visite éclair de son oncle qui, à cette occasion, avait fort impressionné son institutrice par ses connaissances sur Napoléon ou bien encore le colis qu'elle avait confectionné pour l'orphelinat au moment de Noël et qui avait été jugé comme le plus réussi.
Timide, elle ne cherchait jamais à profiter de ces moments où elle occupait le devant de la scène. Car elle savait trop bien qu'ils ne pouvaient que lui attirer rancune et jalousie au sein d'une communauté où le prêche de la tolérance allait de pair avec une absence totale de charité. Evelyne connut l'encrier renversé sournoisement sur son cahier de leçons de choses qu'elle s'était appliquée à décorer de feuilles séchées et de jolis dessins de papillons, le contenu de son plumier dévalisé alors qu'elle était en récréation, son manteau piétiné dans le vestiaire. Au début, elle eut la naïveté de se plaindre auprès des maîtresses mais, là encore, elle réalisa vite que les petits anges dévastateurs s'arrangeaient pour obtenir l'impunité et retourner toute l'affaire contre elle. Aussi, finit-elle par s'organiser pour ne rien laisser traîner, raréfiant ainsi les occasions d'être enquiquinée par ses camarades.
D'un naturel rêveur, Evelyne reconnaît volontiers qu'elle manifestait une grande tendance à ne plus écouter dès qu'une leçon l'ennuyait. Elle évoque un cours d'arithmétique où, au lieu de suivre les explications données par l'institutrice, elle s'était absorbée dans la contemplation de la veste en tricot d'une des élèves et elle avait passé toute l'heure à essayer de compter combien de fois se répétaient les motifs jacquards.
Malgré ces petits défauts, Evelyne était considérée comme une bonne élève ; ce qui lui valait d'être sévèrement punie quand elle bâclait un devoir ou qu'elle négligeait d'apprendre ses leçons. Les activités scolaires occupaient presque tout son temps et il lui en restait peu pour jouer.
Il restait le jeudi après-midi. Après avoir terminé ses devoirs elle avait enfin le droit de se distraire. Depuis que sa mère attendait le bébé, elle la confiait à l'une de ses amies qui avaient deux fils un peu plus âgés qu'Evelyne. Henri et René étaient de redoutables garnements dont leur mère ne venait pas à bout et qu'aucune punition n'arrêtait. Avec l'audace et l'inconscience des gamins de leur âge ils ne savaient quelle bêtise inventer pour se rendre odieux. Evelyne, entraînée par ces deux chenapans avait appris à tirer les cordons de sonnette puis à détaler à toutes jambes, à faire l'aveugle pour réclamer trois sous, à jouer les éclopés pour apitoyer les passants, ce qui, curieusement, avait fini par développer chez elle un certain goût du risque. C'est ainsi qu'elle apprit à escalader les murs, à grimper aux arbres, à chaparder dans les jardins. Sa mère qui ne se doutait de rien s'étonnait seulement de voir sa fille revenir le soir avec des vêtements déchirés et couverte d'égratignures. Evelyne se gardait bien de lui dire la vérité car elle aurait été désolée d'être privée de ces escapades qui l'amusaient tant. Fort heureusement sa mère avait toute confiance en son amie !
Evelyne se souvenait aussi d'Alain et de Jean-Louis, deux autres garçons de son âge qui étaient les fils de la patronne du salon de coiffure où sa mère était cliente. Cette femme aimait bien Evelyne et à chaque fois qu'elle venait, elle appelait ses fils pour qu'ils viennent jouer avec elle. Mais Evelyne ne les aimait pas. Sournois, ils étaient féroces. Sadiques, ils éprouvaient un malin plaisir à martyriser le chat, à terroriser le chien sans parler des oiseaux qu'ils visaient avec une fronde et torturaient. Leur brutalité était sans limites. Evelyne en avait peur et préférait se réfugier dans le salon de coiffure plutôt que d'avoir affaire à eux.
Au moins, dans le salon, elle assistait médusée à la mise en place des indéfrisables. Elle était impressionnée par les énormes pinces qui, fixées sur de minuscules bigoudis protégés par des papillotes, recouvraient les têtes des femmes stoïquement assises sur leur fauteuil de torture. Ainsi harnachées elles ressemblaient, vues de dos, à une rangée de monstres préhistoriques aux écailles hérissées.
Elle écoutait les conversations. Entre deux coupes, deux teintures ou deux mises en plis, les meilleurs ragots du moment circulaient. Les histoires les plus graves étaient susurrées à mots couverts. Sous leur casque, malgré le bruit du moteur qui les coupaient du débat en cours, les clientes faisaient des efforts désespérés pour saisir la moindre bribe de conversation. Elles prenaient toutes des airs de conspiratrices, les yeux brillants, la mine réjouie quand enfin elles apprenaient un potin franchement savoureux.
Evelyne aurait aimé avoir les cheveux longs avec des anglaises attachées sur la nuque par un ruban de velours rouge. Mais elle n'eut jamais gain de cause car sa mère, craignant les poux, lui faisait couper les cheveux très courts. Evelyne détestait le contact de la tondeuse sur son cou et le crissement des ciseaux qui s'activait au-dessus de sa tête. L'épreuve terminée, elle éprouvait le besoin de se détendre. Alors, inconsciente, elle acceptait une partie d'échasses ou de patins à roulettes avec les deux galopins de la coiffeuse qui n'attendaient que cela pour lui faire des croche-pieds et la faire tomber.
Evelyne se rappelle aussi des jeudis après-midi passés dans le salon des dames Micoud, des amies de sa grand-mère. Là, elle découvrait un tout autre monde. Un monde feutré fait de rites immuables, de porcelaines fragiles et d'argenterie rutilante. Les Micoud, quincailliers de père en fils depuis plusieurs générations, occupaient l'une des plus belles maisons de la ville. Entourée d'un très grand jardin bien entretenu elle attirait l'oil du promeneur. Le décès récent du chef de famille avait laissé une veuve et deux filles à l'abri du besoin. Elles avaient l'habitude de recevoir pour le thé à cinq heures. La collation fort bien servie par une petite bonne à tablier blanc était toujours très recherchée. Evelyne se gavait de tarte, de mousse au chocolat et de crème caramel. La finesse des tasses et des assiettes, l'élégance de la nappe bise ajourée, la disposition impeccable des couverts en argent parfaitement astiqués ajoutaient encore un plus à toutes ces bonnes choses.
Quand il faisait beau Evelyne aimait à se rendre dans le jardin. Les autres fois, elle visitait la maison, autorisée en cela par les propriétaires. Au fil des ans ces derniers n'avaient pas lésiné sur le mobilier. Le salon, de grande taille, était luxueux. On pouvait y voir une vitrine Boulle, une vraie avec la signature, qui faisait l'admiration des visiteurs. Les sièges, le lit de repos et les commodes qui avaient été choisis en bois clair, orme ou érable, égayaient la pièce qui, avec des meubles plus sombres, aurait été triste. Evelyne aimait tout particulièrement une petite jardinière en bois de rose à cause de ses ferrures et de ses bandeaux en bronze. C'était murmurait-on, une copie d'un original qui se trouvait à la Malmaison. dont son oncle lui parlait si souvent. Elle aimait aussi les tentures assorties à la tapisserie des fauteuils : une soierie jaune paille dont les motifs mats sur fond brillant, un dama fort réussi, se répétaient à l'infini. Des couronnes de feuilles de laurier comme celles qui ornaient le front des empereurs romains dans son livre d'histoire.
En dehors du salon, une autre pièce l'attirait beaucoup : la bibliothèque. Cette pièce occupait, au rez-de-chaussée, une aile attenante au bâtiment principal. Haute de plafond, elle était remplie d'armoires en chêne qui contenaient un nombre impressionnant de volumes. Au centre, une grande table cirée, également en chêne, entourée de chaises cannées à haut dossier, permettait de s'installer tout à son aise pour lire.
Cette bibliothèque avait été créée par l'arrière-grand-père de la dynastie. Un beau jour, il avait décidé de compenser son manque d'instruction par l'accumulation d'ouvrages qui, même s'il ne devait jamais les consulter, pouvaient laisser supposer qu'il était un esprit cultivé. Il avait alors confié à un libraire le soin de lui acheter tout ce qu'il était de bon ton d'avoir dans des domaines aussi diversifiés que la politique, les sciences humaines, les sciences de la vie, les arts, la littérature.
Ses descendants, soit par goût, soit par habitude, avaient continué de remplir les rayonnages. Paradoxalement, ces gens simples, plus au fait des catalogues de quincaillerie que de ceux des maisons d'édition, avaient réussi à réunir un capital inestimable que beaucoup de bibliophiles leur auraient envié.
Pendant que les grandes personnes discutaient entre elles, Evelyne se glissait sur la pointe des pieds dans ce petit temple de la connaissance où l'odeur forte de l'encaustique l'emportait sur celle générée par les encres d'imprimerie, les colles des reliures et les cuirs patinés des livres anciens. Elle avait découvert dans une des armoires un Roman de Renard illustré par l'Imagerie d'Epinal et quelques tomes des romans de Jules Verne imprimés dans la fameuse édition Hetzel. A chaque visite, elle explorait de nouveaux rayonnages, feuilletant tout ce qui lui tombait sous la main. Elle prit l'habitude de venir se réfugier là, au calme, loin des adultes et de se plonger avec délice dans des abîmes de lecture. A plusieurs reprises, elle fut même autorisée à emprunter quelques livres ce qui était pour elle un immense plaisir.
A cet âge, Evelyne possédait un fin minois qui attirait le regard. La fille aînée des Micoud, professeur de dessin et ancienne élève des Beaux-Arts, proposa de faire son portrait au fusain. Evelyne dut supporter des séances de pose très ennuyeuses. Toutefois, déjà narcissique et curieuse de voir sa frimousse reproduite sur une feuille de papier, elle tint bon, malgré les crampes et les démangeaisons qui l'incitaient à gigoter sans arrêt.
Le portrait terminé n'était pas très ressemblant. Il fut encadré et accroché dans la chambre de ses parents où tout le monde s'empressa de l'oublier.
Evelyne aurait bien aimé que la maison au bord de la rivière soit aussi joliment meublée que celle de la famille Micoud. Elle rêvait de vivre au milieu de meubles précieux. Elle rêvait. Elle n'en finissait pas de rêver.
Clément n'en finissait pas d'écouter. De l'écouter. Elle poursuivait imperturbable. Il n'en pouvait plus. Il fut obligé de l'interrompre car la séance durait depuis plus de deux heures.
De nouveau face à face, ils s'affrontaient du regard. Lui, supportait de moins en moins l'image de petite fille modèle qu'elle voulait à tout prix donner. Elle, continuait à s'interroger sur sa personnalité ambiguë et aurait beaucoup aimé connaître le défaut de sa cuirasse.
- XIX -
Après chaque séance, Evelyne tentait de faire le point. De plus en plus, elle s'étonnait de sa propension à manifester autant d'animosité à l'égard de Clément. Elle avait beau connaître la théorie selon laquelle toute psychothérapie passe par un transfert analytique du patient sur son thérapeute, elle n'arrivait pas à comprendre son attitude. Elle avait beau s'interroger et chercher une raison susceptible d'expliquer une telle agressivité, aucune réponse satisfaisante ne lui venait à l'esprit.
Ce malaise qu'elle ressentait durablement, remontait, lui semblait-il, à ce dimanche où elle avait découvert Clément se roulant dans la poussière alors qu'il répétait le rôle d'Ubu. Comme elle l'avait trouvé grotesque ! Comme il l'avait agacée par ses mimiques outrées ! Elle se souvenait avec dépit du peu d'empressement qu'il avait montré quand Jacques les avait présentés l'un à l'autre. Il avait presque paru offusqué de la voir. Elle qui savait par expérience que les homosexuels étaient très courtois avec les femmes n'avait pas compris l'attitude méprisante qu'il avait manifestée à son égard.
Une autre chose l'avait intriguée : pourquoi Jacques n'avait-il pas paru choqué par la désinvolture de Clément ? Comme s'il l'avait prévue. Quel lien subtil existait entre eux ? Que tenaient-ils tant à lui taire ?
Evelyne approchait de la vérité. Seule lui échappait encore la véritable raison pour laquelle, après un refus, Clément avait accepté de la prendre en charge. Elle était certaine que Jacques en savait beaucoup plus qu'il ne voulait bien le dire. Plusieurs fois elle avait tenté de l'interroger mais à chaque fois il s'était dérobé :
- Ecoute Evelyne, ne cherche pas midi à quatorze heures. Cesse de te compliquer la vie. Il n'y a rien d'autre que tu ne saches déjà. Pas de paranoïa s'il te plait !
Le ton avait été sec. Inutile d'insister ! Mais Evelyne n'avait pas été dupe de ses faux-fuyants qui ne servaient qu'à masquer sa mauvaise foi.
Autre chose encore clochait. Impression fugace (mais elle devait en tenir compte) qui remontait à sa première visite chez Clément. Au cours de la conversation préliminaire qu'ils avaient eue pour définir les bases de départ de son analyse, elle avait eu le sentiment qu'il ne s'était pas comporté avec elle comme avec une patiente ordinaire. Il avait dépassé les normes permises. L'interrogatoire qu'il lui avait fait subir l'avait mise mal à l'aise et elle se rappelait qu'à plusieurs reprises elle avait dû éluder certaines questions qui lui étaient apparues hors de propos. A certains moments elle s'était sentie comme prise au piège d'un système dont elle ne possédait pas le mode d'emploi.
Il lui avait dit aussi :
- Dès que je le jugerai nécessaire, je vous enverrai chez l'un de mes confrères.
Elle avait trouvé bizarre cette façon d'envisager les choses. Pourquoi vouloir déjà l'envoyer consulter ailleurs alors qu'elle n'avait pas commencé le moindre début d'analyse avec lui ? Dans ce cas pourquoi avait-il accepté de s'occuper d'elle ? Etait-ce pour le seul plaisir de la disséquer comme un gros insecte les pattes en l'air sous la loupe binoculaire du Dr Freud ou bien était-ce seulement pour rendre service à Jacques ?
Bien que son subconscient ait enregistré suffisamment d'éléments pour la mettre sur la voie, Evelyne trop préoccupée d'elle-même - cette analyse l'obligeait à de gros efforts - passait à côté de la vérité.
Si Jacques n'avait rien dit à Evelyne ce n'était pas par connivence masculine (ce qui aurait pu être le cas) mais tout simplement par souci d'efficacité. Il ne voulait pas gâcher par des commentaires inutiles une situation qu'il avait eue bien du mal à susciter. Evelyne devait se soigner au plus vite. Il n'était pas question de la perturber et de lui fournir des arguments qui risquaient de tout faire capoter, au moment même où elle était décidée à suivre une analyse.
En réalité c'était mal la connaître. Evelyne n'était pas une femme qui renonçait facilement. A partir du moment où elle avait décidé de débuter une analyse elle entendait bien la continuer coûte que coûte. Avertie de l'exacte situation elle n'en aurait pas pour autant changé d'avis. Tout au plus aurait-elle été stupéfaite de découvrir qu'elle était la rivale de Clément. Et cette constatation l'aurait sans nul doute rendu moins vindicative à son égard. Par compassion peut-être, elle aurait été plus encline à le respecter et à ne pas chercher à le provoquer comme elle en avait pris l'habitude depuis le début.
En fait, l'ignorance dans laquelle les deux hommes la maintenaient, pour des motifs différents, stimulait son agressivité ce qui, d'une certaine manière, l'aidait à progresser sans qu'elle en prît véritablement conscience.
Les mauvais jours Evelyne se demandait par quel miracle elle trouverait le courage d'aller jusqu'au bout de son introspection. Elle avait souvent l'impression de piétiner. Et même parfois de reculer. Un pas en avant, deux en arrière. Personne pour l'aider. Alors elle voyait tout en noir. C'étaient les périodes sombres dont elle n'osait parler à quiconque et surtout pas à Jacques. Elle s'accusait d'être fautive. Au lieu de faire évoluer les choses, elle se complaisait dans une introspection maladive, à revenir sans arrêt sur cette petite enfance qui lui servait de paravent pour masquer tout le reste.
Certes, elle avait eu besoin de se replonger dans cette première période de sa vie pour trouver l'énergie de commencer. Mais maintenant il était clair qu'elle tournait autour du pot, paniquée à l'idée d'affronter la suite. Elle reculait devant l'effort à fournir. La suite ? Evoquer la suite, c'était enfin parler du fameux triangle infernal qu'avaient constitué pour elle, son père, sa mère et sa sour. La suite, c'était elle, ballottée entre trois êtres qu'elle ne demandait qu'à aimer et qui, pour diverses raisons, l'avaient conduite à tout sacrifier à sa carrière. La suite c'était son destin imposé par la volonté des autres.
Pouvait-elle aujourd'hui leur en vouloir ? Quoiqu'ils aient désiré, quoiqu'ils aient tenté d'infléchir, c'est elle et elle seule qui, en définitive, avait choisi de mener cette vie-là. Tout d'abord par lâcheté pour liquider une fois pour toutes le contentieux qu'elle avait avec sa mère. Et aussi par orgueil, elle devait l'admettre. Pour jouer à la femme libérée qui, sans fil à la patte, est capable de réussir mieux que les autres dans sa vie professionnelle.
Pourtant, petite fille elle disait souvent que plus tard elle se marierait et aurait plein de bébés. Elle l'avait dit longtemps et l'aurait sans doute fait si la pression des événements n'avait pas modifié sa vie. Elle se souvenait de ce garçon rencontré en fac qui voulait l'épouser (elle avait alors dix-neuf ans). Elle l'avait repoussé comme elle en avait repoussé tant d'autres ensuite de peur de ne pas tenir la promesse qu'elle s'était faite. Tous évincés. Dès lors elle avait préféré parce qu'elle n'était pas asexuée et qu'elle éprouvait le besoin d'une présence masculine, opter pour des aventures passagères qui ne l'engageaient pas mais qui étaient bien souvent décevantes. A chaque fois, elle y avait laissé un peu de sa peau et, à force de se desquamer, elle avait développé cette névrose infernale qui lui avait gâché la vie.
Tout comme Clément qui s'était cru fort, elle s'était forgée, pendant des années, une carapace qui l'avait confortée dans sa manière de vivre et lui avait évité toute remise en question. Elle avait même fini par se persuader que son choix était le bon et que tout autre aurait été une catastrophe.
Hélas, l'approche de la quarantaine lui avait été fatale. Quand, seule, Evelyne plongeait le soir dans ces délires qui finissaient par la rendre folle, quand elle refusait de vivre autre chose qu'une vie exempte de tout grain de poussière, de toute vaisselle salie, de tout objet superflu, elle devenait peu à peu esclave de son mode de vie.
Puis le monde avait basculé. Elle avait rencontré Jacques et mis au rencard tous les points de repère qui l'avaient aidée à vivre jusque-là. Jacques l'avait catalysée. Pour la première fois elle désirait découvrir autre chose. Mener une autre vie. Encore fallait-il qu'elle soit prête à accepter ce que ce nouveau mode de vie impliquait : cohabiter ; se marier sans doute ; avoir un enfant peut-être.
La vie en commun, Evelyne ne connaissait pas. Certes, Jacques avait, plus que tous ceux qui l'avaient précédé, envahi son studio sans lui demander son avis mais jusqu'à maintenant elle avait su préserver son autonomie. Il habitait chez lui, elle vivait chez elle. C'était tout de même moins contraignant que de le côtoyer vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle ne se leurrait pas : à son âge, après tant d'années passées seule, la vie à deux risquait d'être difficile. De toute façon, tant qu'elle souffrirait d'affreuses migraines elle s'opposerait à toute cohabitation même si Jacques insistait. Car, elle ne supportait pas l'idée qu'il puisse voir dans quel état de délabrement la mettait chaque crise.
Lorsqu'elle raisonnait calmement, avoir un enfant lui paraissait relever de la plus parfaite ineptie. Primipare à quarante ans, une folie ! Une chance (!) non négligeable de fabriquer un petit mongolien ou pire encore. Du reste le désir d'enfant ne l'avait jamais beaucoup préoccupée. Elle qui, à longueur d'année, manipulait spermatozoïdes et ovocytes pour mieux étudier les mécanismes qui, en les faisant se rencontrer, induisaient la formation d'un embryon, elle qui suivait pas à pas les progrès des équipes impliquées dans la mise au point de techniques de fécondation artificielle fiables, elle qui en bref essayait de comprendre la genèse de la vie n'avait jamais envisagé de la donner.
Lorsqu'il lui arrivait d'aborder la question avec sa gynécologue, ne serait-ce que parce que celle-ci s'inquiétait toujours d'un revirement tardif (souvent trop tardif !) chez ses patientes qui, atteignant la quarantaine, voulaient soudain un enfant dans les neuf mois qui suivaient, Evelyne le faisait d'une manière détachée comme si, au-dessus de la mêlée, elle ne se sentait absolument pas concernée.
Et que pouvait-elle apporter à un enfant ? Un père avait répondu Jacques un jour où ils en avaient discuté. Car, Jacques qui déplorait parfois de ne pas avoir eu d'enfant lors de son mariage, était prêt à vivre cette expérience si Evelyne le voulait et. avant qu'ils ne soient tous les deux trop âgés.
Trop âgés. Oui, s'ils n'y prenaient pas garde, ils allaient être trop vieux pour avoir un enfant. Surtout Evelyne avec des ovaires déclinants et un utérus plutôt défraîchi. Et Evelyne savait aussi qu'une gestation tardive comporte toujours des risques. Elle était consciente de cette situation mais évitait de trop y penser. Certes, elle réalisait la chance qu'elle avait eue de croiser le chemin de Jacques au moment même où elle ne donnait plus très cher de son existence mais elle avait, pour l'instant, bien du mal à imaginer leur couple dans le rôle de parents. Pourquoi mais pourquoi ne s'étaient-ils pas rencontrés plus tôt ?
- XX -
Un de ces soirs pluvieux d'avril à ne pas mettre un greffier dehors, Clément se rendit à pied au trente-six quai d'Orléans où ses parents occupaient un somptueux appartement au dernier étage de l'immeuble. S'il n'avait pas plu, le chemin qu'il empruntait par les vieilles rues du quartier Saint-Paul aurait été des plus agréables. D'autant qu'à la tombée de la nuit la circulation automobile se ralentit ce qui permet aux piétons de marcher au milieu de la chaussée sans prendre le risque d'être renversés par une voiture. Mais, par cette grisaille humide, personne ne se sentait l'envie de flâner bien longtemps dehors. Clément, pressé d'arriver, marchait droit devant lui sans se soucier du reste. A l'exception de deux clochards installés sur la bouche de chaleur de la station de métro Saint-Paul qui l'interpellèrent pour lui demander une cigarette, il ne croisa âme qui vive.
Clément se rendait au dîner d'anniversaire de son père qui fêtait ses soixante-dix ans. C'était bien à contrecour qu'il avait promis à sa mère d'y assister. Et comme elle se méfiait de sa parole, le matin même, elle lui avait téléphoné pour lui rappeler sa promesse.
Contraint, Clément s'exécutait. Une vraie corvée ! Car son père ne l'intéressait pas. Son père était l'homme le plus détestable de la terre !
Haïssable et enjôleur tout à la fois, son père avait le don de désarmer son entourage par une apparente et déconcertante franchise qui en réalité, finement calculée, servait ses intérêts. Il savait convaincre. Avec un aplomb insolent. Ses adversaires, si coriaces fussent-ils, avaient peu de chance de sortir vainqueurs devant une telle pugnacité. En fait, et Clément l'avait compris depuis longtemps, derrière l'homme du monde à la démarche souple et au sourire charmeur se cachait un individu sans scrupule. Homme d'affaires implacable, il n'hésitait jamais à user de son pouvoir pour obtenir gain de cause. Politicien habile, il savait louvoyer en eau trouble et rester en place malgré les changements de gouvernement.
A ses succès professionnels s'ajoutaient ceux qu'il avait auprès des femmes. Vieux beau aux allures de Don Juan, il plaisait. Séducteur calculateur il avait toujours choisi ses maîtresses en fonction de leur position sociale. Toutes l'avaient aidé, à un moment ou à un autre, à faire carrière.
Sa réussite aurait été totale sans Clément. Ce fils, reçu comme le maillon de la chaîne qui le reliait aux générations futures, ne prendrait jamais la relève. Echec total. Echec définitif sans l'espoir de voir un jour s'infléchir le cours des choses. Parfois il mettait cet échec sur le compte du peu d'importance qu'il avait porté à l'éducation de son fils. Il aurait dû être plus vigilant et ne pas laisser son épouse en prendre l'entière responsabilité. Mais à l'époque avait-il le temps de s'occuper de ce garçon gringalet et timoré qui, il devait l'avouer, ne l'attirait pas. Aujourd'hui il regrettait une indifférence qu'il payait cher. Car l'enfant puis l'adolescent et enfin l'adulte lui avaient toujours échappé. Sous l'influence maternelle Clément avait développé des tendances en totale opposition avec celles que son père aurait voulu lui voir prendre. Au fil des années un fossé d'incompréhension s'était creusé entre les deux hommes. D'un côté Clément affichait un profond mépris pour les spéculations financières et les magouilles politiques de son père. De l'autre, celui-ci considérait le jargon psychanalytique comme le reflet de l'éternelle incompétence de la médecine à soigner la folie. Quant au fait que Clément soit homosexuel cela avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. L'opprobre s'était abattu sur la famille !
Ce soir-là, Clément retrouva l'ambiance des dîners maternels. Invités triés sur le volet, toilettes recherchées, conversations banales et maniérées. Sa mère virevoltait d'un bout à l'autre du salon. Elle saluait les arrivants d'une phrase stéréotypée qu'elle répétait comme un automate.
Vêtue d'un fourreau noir aux manches décuplées qui la faisaient ressembler à une immense chauve-souris déployant ses ailes, coiffée d'une perruque blonde aux reflets cuivrés, parée d'un unique mais remarquable collier en or et du bracelet assorti, elle était parfaite. Son excentricité, loin d'être vulgaire, dénotait chez elle une originalité de bon goût. Pourtant un tel exhibitionnisme exaspérait Clément. Il ne supportait pas de voir sa mère cabotiner, prête à dire n'importe quoi pour se rendre intéressante. Ses robes lui paraissaient toujours trop voyantes et ses perruques trop apprêtées qui l'obligeaient à raser ses cheveux lui rappelaient les affreux personnages en cire du musée Grévin. Il se sentait meurtri lorsqu'il l'apercevait, entourée de faux-culs flatteurs ou de jacasses stupides pérorant à tort et à travers. Il se sentait meurtri quand il la voyait jouer les bas-bleus cherchant à prouver coûte que coûte qu'elle était au fait des dernières nouveautés littéraires, cinématographiques ou artistiques.
A force de faire semblant elle aurait pu acquérir une certaine culture si elle ne s'était pas cantonnée à des engouements snobs dont elle se toquait, persuadée à chaque fois d'avoir mis la main sur la perle rare, le génie du siècle pourquoi pas !
C'est ainsi qu'elle donnait son opinion, d'un air entendu, sur n'importe quelle publication, sur n'importe quelle ouvre entrevue dans une galerie à la mode. Conforme à cet intellectualisme parisien qui en fait courir plus d'un dans les salles de concert, de cinéma ou de théâtre, elle tombait dans le piège de ces sots qui se croient seuls-habilités à juger d'une ouvre à sa juste valeur. En matière d'art elle était capable du pire. Clément se souvenait encore, avec horreur, qu'au cours d'une réception donnée par le maire de Paris dans les salons de l'Hôtel de Ville, elle avait lancé de sa petite voix flûtée alors qu'un malheureux silence venait de s'installer :
- Je déteste Renoir ! Qui peut aimer Renoir ? Quelle vulgarité toutes ces femmes charnues affalées comme de grosses vaches dans un pré !
Personne ne releva. Beaucoup furent choqués, quelques-uns apprécièrent le franc-parler de la dame. Après tout Renoir pouvait ne pas faire l'unanimité. Clément, lui, était consterné. D'autant qu'il soupçonnait sa mère d'avoir confondu Renoir avec Rubens. Depuis, à chaque fois qu'il l'accompagnait en public, il la surveillait étroitement de peur qu'un pareil incident ne se reproduisît.
Le dîner était servi dans la vaste salle à manger contiguë au salon. Argenterie, cristaux et porcelaine fine décoraient la table recouverte d'une mousseline brodée de chez Porthault. Le repas (turbot à la Polangis, canard aux mangues, granité au champagne) était le fait d'un jeune cuisinier engagé depuis peu en raison de ses compétences en matière de nouvelle cuisine.
Clément devait s'incliner : sa mère savait recevoir. Son goût pour le décorum et la mise en scène et aussi son désir de forcer l'admiration de ses hôtes la poussait à se surpasser. Certes les moyens financiers dont elle disposait lui permettaient de ne pas lésiner sur les dépenses engagées. Volontiers extravagante dans ses choix, elle avait cependant un réel talent de décoratrice. Elle était réputée pour ses exigences. L'ordonnance d'une pièce, la disposition des meubles, des bibelots, des fleurs ne devaient jamais subir le moindre changement sans son ordre. Elle excellait dans l'art d'harmoniser les couleurs. Elle se complaisait dans les pastels tendres. Tentures et tapis, voilages et doubles rideaux, tapisseries et toiles murales faisaient l'objet, à chaque rénovation, d'une réflexion longuement mûrie. Elle mettait parfois plusieurs semaines avant de se décider, exaspérant au plus haut point tous les corps de métier qui travaillaient à son projet. Mais la décision finale débouchait toujours sur un chef-d'ouvre. Chef-d'ouvre qui faisait une excellente publicité à tous les artisans qui y avaient contribué.
Pour cette femme, les moindres détails comptaient. Un savon bleu ne pénétrait jamais dans une salle de bains verte, une nappe à ramages était exclue d'une table recouverte de vaisselle en céladon. Tout engendrait une recherche excessive de la perfection. Pour ne rien oublier, elle tenait à jour un grand cahier où elle répertoriait, pièce par pièce, tous les meubles et les objets qui s'y trouvaient. L'organisation d'un déjeuner, d'un dîner ou même d'un simple thé s'établissait selon un protocole strict. Les domestiques habitués à ses caprices obéissaient au doigt et à l'oil. Tout comme les artisans, ils étaient fiers de la bonne renommée de la maison qui les employait. Et c'est sans sourciller qu'ils acceptaient compliments et pourboires après chaque réception.
Ce soir-là, comme à l'habitude, Clément regretta d'être venu. Le dîner s'étirait parfait et monotone. La perfection des lieux, le service irréprochable créaient une solennité qui interdisait tout laisser-aller. Les conversations tenues en laisse restaient d'une platitude désolante. Clément s'ennuyait. Son regard errait songeur alors qu'il répondait machinalement à un importun qui se croyait subtil en l'interrogeant sur l'avenir de la psychanalyse. Soudain, il aperçut sa mère plus triomphante que jamais au centre de son décor. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser qu'au travers de sa mère c'était Evelyne qu'il venait de voir. L'analogie le fit presque sourire. Comment n'y avait-il pas songé plus tôt ? C'était l'évidence même : ces deux femmes se ressemblaient. Elles étaient les deux facettes d'une même angoisse. Sous des formes différentes leur démarche était identique. Et si l'une, extravertie à l'extrême, installait ses fantasmes au milieu de son salon, l'autre, assaillie par une peur panique des choses, les installait au centre de ses cauchemars. Quel besoin de sécurité les avait poussées à un tel schéma névrotique ? Pourquoi éprouvaient-elles la nécessité d'inventer ou de créer des décors extraordinaires où, éternelles petites filles inquiètes, elles continuaient de rêver ? Essayaient-elles par ce biais de retrouver l'univers clos et douillet du berceau utérin ? Sans doute vulnérables parce que nées et tombées du nid sans ménagement ; toutes les deux frustrées de leurs enveloppes embryonnaires, nues et frissonnantes, abandonnées en des mains inconnues, à côté d'un placenta désormais inutile.
Clément extrapolait. Clément était à cent lieues de son interlocuteur qui ne le lâchait plus. Clément venait peut-être de découvrir le véritable visage de sa mère. La fragilité de sa mère. Et pour la première fois il réalisait qu'il ne savait rien de cette femme qui l'avait mis au monde.
Il fut interrompu dans ses réflexions par Grégoire, le maître d'hôtel : on le demandait au téléphone. Qui pouvait bien l'appeler à une heure aussi tardive ici chez ses parents ?
- Ce sont les urgences de l'Hôtel-Dieu, monsieur, murmura Grégoire voyant l'étonnement de Clément.
- Les urgences ?
- Oui monsieur.
Clément intrigué prit l'écouteur. C'était Jean-Lou. Plus exactement c'était le service des urgences qui le prévenait que Jean-Lou venait d'être hospitalisé. Que s'était-il passé ? Il avait eu un malaise dans la rue et le car de police-secours qui l'avait ramassé l'avait conduit à l'hôpital le plus proche. On allait lui faire des examens. Dans l'immédiat il se reposait mais dès demain les visites seraient autorisées. Clément pourrait rappeler dans la matinée.
Depuis le passage de Clément le soir de la répétition, les deux hommes s'étaient revus deux ou trois fois mais en coup de vent. Jean-Lou continuait à refuser toute aide et vivait une fois de plus en transit chez de nouveaux copains qui voulaient bien l'héberger. A chacune rencontre Clément le trouvait de plus en plus maigre. Emacié. Un chat écorché. Clément avait mis cette maigreur sur le compte d'une mauvaise hygiène alimentaire ou d'un manque de sommeil. Lui, médecin n'avait pas su diagnostiquer la maladie.
Dès qu'il put trouver un prétexte pour s'éclipser sans trop attirer l'attention, Clément quitta la réception. Alors qu'il enfilait son manteau sa mère vint le rejoindre.
- Que se passe-t-il, pourquoi pars-tu si vite ?
- Hélène excuse-moi (sa mère tenait à ce que son fils l'appelât par son prénom) mais Jean-Lou est malade. Il vient d'être hospitalisé.
Hélène, mieux que son époux, avait accepté l'homosexualité de Clément. ou pour le moins faisait semblant de l'avoir acceptée. Elle connaissait Jean-Lou de longue date et l'appréciait parce qu'à ses yeux il avait le privilège d'être un artiste.
- De quoi souffre-t-il ? Il n'était pas très épais, c'est un fait, la dernière fois que je l'ai vu.
- Tu l'as vu récemment ? S'enquit Clément très étonné.
- Oui, il est venu me rendre une petite visite le mois dernier. Je lui avais demandé de passer pour que je lui remette le chèque que je lui avais promis.
- Un chèque ? Clément imaginait mal Jean-Lou réduit à la mendicité.
- Bien sûr pour l'aider à monter son prochain spectacle. Il faut l'encourager. C'est bien ce qu'il fait et ce n'est pas parce que tu. comment dire. parce que vous êtes séparés que.
- Mais je subventionne régulièrement la troupe comme par le passé rétorqua Clément presque ulcéré par les propos de sa mère.
- Alors c'est parfait car deux chèques valent mieux qu'un.
En d'autres circonstances, le mécénat d'Hélène aurait fait sourire Clément mais ce soir-là il était trop inquiet pour s'en amuser. Que Jean-Lou l'ait fait prévenir n'était pas de bon augure car il savait très bien que celui-ci n'avait pas l'habitude de déranger ses amis pour un rien. S'il avait souhaité que Clément soit informé de son hospitalisation c'est qu'il jugeait son état grave.
Avant de partir, Clément promit à sa mère de lui donner des nouvelles dès qu'il en aurait et rentra chez lui extrêmement préoccupé.
- XXI -
Jean-Lou quitta l'Hôtel-Dieu quelques jours plus tard avec en poche une ordonnance aussi longue qu'un jour sans pain. Les médecins avaient, semblait-il, diagnostiqué une mononucléose infectieuse associée à une adénopathie. Dans l'immédiat, Jean-Lou était tiré d'affaire. Son état de santé s'était amélioré assez vite mais l'interne qui l'avait suivi souhaitait le revoir le mois prochain. Il avait insisté pour qu'il vienne à sa consultation et lui avait fait promettre de ne pas prendre sa demande à la légère.
Clément avait promis. Il avait repris des couleurs et à part ce gros ganglion à la base du cou qui le gênait quand il tournait la tête, il se sentait beaucoup mieux.
Le jour de sa sortie, Clément était là. Cette fois, il avait obtenu gain de cause : Jean-Lou acceptait d'occuper la chambre de bonne afférente à son appartement ce qu'il avait jusqu'alors refusé. Son passage à l'hôpital l'avait secoué. Seul au fond de son lit il avait paniqué. Lui, qui avait horreur des piqûres, des prises de sang, des examens en tout genre, avait mal supporté d'être pris pour cobaye par toutes les blouses blanches qui s'étaient penchées à son chevet. Et soudain il avait pensé à Clément. Clément médecin. Clément qui allait le sortir de là au plus vite avant qu'on ne décide de le charcuter. Clément qui était venu le voir dès le lendemain de son admission et qui l'avait rassuré. Tout compte fait, il avait été bien traité. Au fur et à mesure qu'il reprenait du poil de la bête, son humour coutumier avait resurgi et quand Clément entrait dans sa chambre il lui disait en riant : « pas vrai, tu me dorlotes comme une vieille maîtresse que l'on ne veut pas perdre ! » Clément haussait les épaules mais au fond de lui-même il était soulagé de constater que son ami allait de mieux en mieux.
Les jours qui suivirent la sortie de Jean-Lou furent calmes. Celui-ci acceptait de rester allongé une grande partie de la journée et ne se levait que pour les repas qu'il prenait avec Clément. Leurs deux vies s'étaient de nouveau rejointes mais cette fois dénuée de toute passion tumultueuse.
Les choses n'avaient pas changé pour autant. Clément était toujours torturé par la violence de ses sentiments pour Jacques. Seule la maladie de Jean-Lou lui avait fait oublier un instant ses propres tourments. Mais certains jours, ses nerfs craquaient. Par exemple les jours où Evelyne venait consulter ou bien quand, par hasard, il rencontrait Jacques. Seulement par hasard, car Jacques avait coupé les ponts. Au mieux, Clément l'apercevait de loin à un vernissage ou à un cocktail. Il avait fini, lui qui détestait les mondanités, par accepter toutes les invitations où il avait une chance de le croiser. Parfois, Evelyne l'accompagnait. Tous trois se saluaient puis par politesse échangeaient quelques propos insignifiants : « Ce peintre a un réel talent. Comment allez-vous ? Comment vas-tu par ce temps de chien ? . C'est un miracle. Je suis arrivé à me libérer. Si tu savais j'ai un boulot fou. Et vous ? . Et toi ? ». Clément évitait d'adresser la parole à Evelyne qui de son côté faisait un effort méritoire pour paraître indifférente en sa présence. Mais comment pouvait-elle l'être quand elle songeait aux heures passées sur son divan pendant lesquelles ils se jaugeaient sans ménagement, guettant leur moindre faiblesse. Curieusement, par le canal du double transfert analytique ils étaient devenus inséparables. Et condamnés. Condamnés par l'interpénétration de leurs pensées à une symbiose dont ils s'étaient rendus prisonniers. Ils jouaient à un jeu diabolique. En dehors de l'univers clos où ils pouvaient s'affronter tout à loisir sur un pied d'égalité, ils avaient choisi de s'éviter le reste du temps. Et quand il leur arrivait de se rencontrer le jeu était faussé. Faussé au point que la séance suivante était un calvaire réciproque. Evelyne se complaisait à répéter cent fois la même chose tandis que Clément serrait les poings en l'écoutant ressasser ses souvenirs de petite fille attardée. Il avait hâte d'en finir avec elle. Et aussi avec tous ces mensonges qui pendant des années l'avaient empêché de regarder la vérité en face.
Déjà il avait évolué. Peu à peu, il avait cessé de considérer Evelyne comme une rivale. Elle aimait Jacques et en était aimée. Que pouvait-il y faire ? Son ressentiment, s'il éprouvait encore un ressentiment, allait plutôt vers l'homme qu'il aimait et qui, sans scrupule, s'était servi de lui pour parvenir à ses fins. Et malgré tout, il ne parvenait pas à se détacher de celui qui l'avait trompé, mais qu'il avait tant admiré pour la première fois dans le prétoire de Versailles. Son image le poursuivait encore. Une telle impétuosité, une telle superbe : tout ce qu'il aurait voulu être, tout ce dont il avait rêvé depuis qu'il était enfant. Rêve qui tournait au cauchemar. Cauchemar qu'il fallait endiguer s'il ne voulait pas perdre la raison alors que les autres attendaient de lui des miracles. A commencer par sa mère égocentrique, son père intraitable, Jean-Lou paumé et malade et. tous ces gens qui chaque jour venaient le consulter dans l'espoir de guérir !
Depuis quelque temps Clément ne cessait de penser à sa mère. Son dernier passage chez ses parents le jour de l'anniversaire de son père l'avait fait réfléchir. Pourquoi Hélène était-elle toujours outrancière ? Pourquoi cet exhibitionnisme imbécile ? En vérité il n'avait pas de réponse tout simplement parce qu'il ne savait rien de sa mère. Encore un secret bien gardé. Il ne savait que ce qu'on avait bien voulu lui raconter. Peu de choses : née à Cracovie d'un père fourreur qui gagnait péniblement sa vie et d'une mère dont on ne parlait jamais, elle avait été élevée par la tante Sophie, sour cadette de son père. De sa grand-mère maternelle Clément ignorait tout. Etait-elle morte à la naissance d'Hélène ? Avait-elle quitté son mari ? Etait-elle seulement juive ? Autant de questions qui restaient sans réponse. Hélène n'avait jamais dû connaître sa mère. D'ailleurs dans le vieil album écorné qui avait appartenu à la tante Sophie il n'y avait aucune photo d'elle. Et, parmi les objets qu'Hélène conservait dans une malle (une toque en astrakan toute mitée, deux ou trois broches sans grande valeur, une robe brodée et un petit chandelier à sept branches) Clément n'avait jamais entendu dire que l'un d'eux avait appartenu à sa grand-mère. Alors aujourd'hui, que pouvait-il espérer dénicher après tant d'années de silence ? Au mieux un début d'enracinement dans un passé qui soudain lui manquait cruellement. Qu'était devenu le grand-père fourreur ? Quand, où et comment était-il mort ? Avait-il un jour quitté la Pologne ? En tout cas son chemin n'avait jamais croisé celui de son petit-fils.
En revanche, Clément se souvenait de la tante Sophie. Elle habitait Nancy et juste après la guerre elle venait assez souvent leur rendre visite. Une fois, il en avait été marqué, elle avait tenu à l'emmener à la synagogue de la rue Pavée parce qu'elle refusait d'admettre que son neveu puisse être baptisé et inscrit au catéchisme. Des détails lui revenaient. Il la revoyait tout de gris vêtue, la tête couverte d'un fichu à fleurs qu'elle attachait fort sous le menton, ce qui accentuait le contour anguleux de son visage et rehaussait le bleu délavé de ses yeux. Elle parlait un mauvais français et son accent guttural écorchait les oreilles. Clément se rappelait qu'elle lui faisait peur et que son père ne semblait pas beaucoup l'apprécier. Il s'absentait quand elle venait. Ou s'il se trouvait là, il ne lui adressait pas la parole. La tante Sophie avait fini par espacer ses visites puis par ne plus venir du tout et son souvenir s'était peu à peu estompé.
Ensuite ? Plus rien. A part ces images fugitives que Clément avait bien du mal à extraire de son passé d'enfant, c'était le noir complet. Un jour il avait appris que la tante Sophie était morte. Sa mère s'était absentée deux ou trois jours. Elle était revenue les traits fatigués mais n'avait rien dit. La vie avait repris et la femme que tout le monde connaissait réapparut : excentrique, charmeuse à ses heures, détestable à d'autres.
- XXII -
Ce soir, Jacques n'est pas venu. Trop de dossiers en retard. Il lui a juste téléphoné pour lui souhaiter une bonne soirée et lui rappeler que le week-end prochain ils étaient invités chez ses parents. Evelyne allait découvrir la famille de Jacques. Un moment qu'elle redoutait depuis qu'ils en avaient parlé mais comment y échapper ? Jacques avait tant l'air d'y tenir qu'il était bien difficile de refuser. Pour l'instant elle préfère ne pas trop y penser.
La soirée est belle. On est en mai. Le Jardin des Plantes qu'Evelyne aperçoit de son balcon regorge de couleurs. Malgré l'orage violent qui a éclaté dans l'après-midi, les cerisiers du japon sont encore couverts de fleurs. Venant de la ménagerie on entend le cri strident des gibbons qui s'interpellent d'une cage à l'autre. Oup.oup.ouip.ouip.ouiip.ouiip.iiip.iiip.iiii !
Au lieu de se détendre et profiter de ces heures de calme pour lire ou écouter de la musique, Evelyne se lance dans le nettoyage méticuleux de la baignoire entartrée par un goutte-à-goutte sournois. Entreprise stupide qui la laisse vite insatisfaite car malgré ses efforts toutes les taches ne sont pas parties.
Bien sûr elle aurait dû utiliser un autre produit pour que ces taches partent. Elles doivent partir. L'angoisse la gagne. Les taches augmentent de taille à vue d'oil. Elle frotte. Les taches s'agrandissent encore. L'odeur du décapant l'indispose, l'éponge qui en est imbibée lui brûle les doigts. Se renseigner. Trouver au plus vite le produit miracle qui arrangerait tout. Et puis non, cela ne changerait rien. Car elle le sait : les taches sont là pour la narguer, résistant à plaisir.
Evelyne vacille incapable de se dominer. Une nouvelle crise la terrasse. Elle a peur. Ses jambes flageolent. Elle s'assied sur le rebord de la baignoire le temps de reprendre son souffle. Elle lutte. Elle essai de respirer très fort comme on le lui a conseillé. Prendre les cachets de migraspirine dans l'armoire à pharmacie. Faire couler de l'eau dans le verre à dents. Avaler. Avaler. Gestes simples qu'elle est dans l'incapacité d'accomplir. Elle a honte mais elle n'a plus la force de bouger. Elle lève les yeux et, dans le miroir au-dessus d'elle, elle voit la grande maison blanche qui l'attend, accueillante.
Cette fois, le film débute par un gros plan du hall, juste sous l'escalier, là où elle avait installé le téléphone dans une précédente crise. Aujourd'hui, plus de téléphone mais une ravissante fontaine en vieux Rouen, blanche et bleue. L'eau en jaillit projetée par une amusante gueule de dauphin en vieil argent. Vieil argent aussi pour la coquille où repose une petite savonnette blanche veinée de vert, vieil argent encore pour l'anneau auquel elle accroche une serviette éponge dont le camaïeu de bleus s'harmonise parfaitement avec les teintes passées de la vasque.
Maintenant la caméra se déplace. Le décor change. Grand angle sur la cage d'escalier où, à mi-parcours, une porte s'entrouvre. Pipi-room story/première. Elle les imagine inconfortables. Il y fait toujours froid. Un jour parcimonieux que diffuse une étroite meurtrière vitrée n'incite pas aux lectures prolongées. Pourtant, la moquette claire, la tapisserie en papier japonais, les accessoires en hêtre massif, le déodorant à la senteur de pinède et le papier ouaté vert pâle font tout pour rendre les lieux moins austères.
La caméra se déplace encore. Evelyne la suit. Elle gravit le palier, fébrile à l'idée de pénétrer dans la salle de bains vaste et somptueuse qui jouxte la salle mauve. Elle avance à pas menus dans ce sanctuaire où tout atteint la perfection. Son regard avide fouille les moindres recoins. Et voici, en déesse incontestée, la monumentale baignoire blanche exposée nue sur ses quatre pattes de lion en bronze. Les robinets à ailettes attirent l'attention. En leur centre un médaillon peint sur émail sert de repère : une drôle de petite sirène verte pour l'eau froide, une écrevisse vermillon pour l'eau chaude.
Le bain coule, odorant, tumultueux et apaisant lorsqu'elle y pénètre. Viennent alors les porte-savons : le premier encastré dans le mur contient les gros pains à la glycérine ; le second métallique fixé par des crochets au rebord de la baignoire supporte les savonnettes parfumées. A portée de main, le porte-serviette avec sa gueule de léopard (un ancien heurtoir sans doute) est pourvu d'un immense drap de bain vert amande.
Elle néglige le gant de crin qui flotte inutile à la surface de l'eau mousseuse et appuie doucement sa nuque douloureuse contre le repose-tête en satin dont le premier contact glacial la fait frissonner. Mais vite une sensation de bien-être l'envahit. Ses yeux ne se lassent pas de contempler l'étagère en bois clair si finement sculptée où des flacons s'accumulent. Certains voués à un destin éphémère seront jetés après usage. D'autres, par leur élégance, la préciosité de leur matériau ou simplement par leur histoire déjà ancienne, ont eu la chance d'être pérennisés. Ils sont tous là.
Flacons en verre ciselé ou en cristal à bouchon argenté, flacons en verre teinté bleu, rose, vert à bouchon doré, flacons en opaline laiteuse, flacons en verre épais moulés dans des formes amusantes de chats, de crapauds, de pingouins ou décorés de lianes enchevêtrées, de volutes d'élodées, de roseaux et de flamants roses. Vides, ils exhalent encore le souvenir des essences qu'ils ont contenues. Pleins, ils abritent tout ce que le corps peut souhaiter : sels de bain, crèmes ou huiles odorantes, shampoings ou lotions capillaires, eaux de toilette, parfums.
Alanguie par le bain, elle tourne légèrement la tête vers la gauche. Alors quel émoi face à la somptuosité du meuble qu'elle découvre ! Rêve de star, évocation d'un passé au parfum des années folles, nostalgie d'un luxe oublié, d'une immense féminité. Coiffeuse aux tons chatoyants, coiffeuse des années trente. Pièce unique en loupe de merisier qui reflète encore l'intimité des femmes qui eurent le privilège de la posséder. Coiffeuse où tous les objets précieux qui la garnissent se reflètent dans le miroir central et sont multipliés à l'infini par les deux miroirs latéraux.
Et d'abord cette lampe en pâte de verre orange qui rappelle quelque plante aquatique et dispense alentour, en un halo diffus, une lumière opalescente presque irréelle.
Ensuite ? Ensuite, c'est un enchantement irrésistible. Evelyne caresse du bout des doigts les brosses à cheveux, les peignes et les démêloirs dont les manches et les montures en écaille sont incrustés d'argent et décorés d'un monogramme. Elle devine quelque cadeau princier choisi dans une de ces boutiques où les prix se veulent anecdotiques. Elle imagine avec quel soin avait dû être emballé le gros vaporisateur en cristal incrusté de lapis-lazuli et dont la poire coiffée d'un gland frangé en soie distille à chaque pression un fin brouillard aux subtils effluves. Cadeau aussi le nécessaire à ongles en ivoire, le crochet à bottines, le chausse-pied en corne et les boîtes à onguents qui remplissent les tiroirs.
Elle s'abandonnerait plus longtemps au mirage de tous ces objets si, soudain, le contact du carrelage froid ne l'obligeait à se réfugier ailleurs. La somptuosité de la pièce s'efface comme carrosse redevenu citrouille. Le charme est rompu et les taches au fond de la baignoire réapparaissent.
Evelyne est meurtrie et honteuse d'avoir encore cédé à ses fantasmes stériles. Elle doit à tout prix se ressaisir et ne plus craquer à la moindre occasion. Maintenant que la crise est passée, elle tente courageusement de se convaincre que le carrelage taché, la casserole qui attache au fond, le chemisier fripé et le collant qui file font partie des choses de la vie, de la vraie vie. L'imaginaire dont elle se repaît ne fait qu'entretenir sa névrose. Elle le sait, elle doit résister. Facile à dire et si difficile à réaliser !
- XXIII -
Ils partirent le vendredi soir. Avec Ernestine. Malgré les encombrements, celle-ci se comporta comme une grande fille : elle toussota un minimum, embrayant en douceur lorsque Jacques la sollicitait. Il faisait beau. Entre la végétation qui s'épanouissait, les jours qui allongeaient, le soleil qui se montrait plus ardent et les jours fériés qui transformaient les semaines en semaines des quatre jeudis, le mois de mai était idéal pour une escapade à la campagne. Et les Parisiens, toujours avides de grand air, ne s'en privaient pas ! Ce qui entraînait chaque week-end des embouteillages monstres sur les périphériques et les bretelles d'autoroutes.
Mais cette fois, contrairement à ce triste week-end où il s'était retrouvé seul à Honfleur, Jacques quitta l'autoroute de l'ouest dès Rocquencourt où il bifurqua pour prendre un itinéraire plus calme et plus touristique. Evelyne, assise à ses côtés se taisait. Elle imaginait les heures à venir et ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine appréhension à l'idée de rencontrer les parents de Jacques. Jusqu'à maintenant la jeune femme avait échappé à cette visite pour la simple et unique raison que ces derniers étaient partis en voyage. Mais dès leur retour ils avaient émis le désir de connaître la nouvelle compagne de leur fils. Depuis que le père de Jacques, notaire à la retraite, occupait tous ses loisirs à la restauration de l'ancien prieuré de Montchauvet, petit village des Yvelines, son épouse et lui avaient décidé de s'y installer.
Montchauvet ! Jacques avait expliqué à Evelyne : « tu verras, c'est formidable. Un village qui a choisi de rester hors du temps. Un village où les serfs du Moyen-Âge sont encore présents cachés derrière chaque pan de mur des fortifications, derrière chaque vestige de l'abbatiale et du monastère. Une atmosphère à la Péguy si tu vois. » Evelyne avait souri moqueuse : « je ne pensais pas que notre visite chez tes parents allait tourner au pèlerinage, très cher frère convers ! » Jacques avait haussé les épaules et avait seulement ajouté un peu vexé de ne pas être pris au sérieux : « moque-toi ! Tu verras bien par toi-même ».
L'itinéraire qu'ils avaient pris était agréable. C'était l'Ile-de-France avec ses voies à travers champs, encore canalisées par des trottoirs rocailleux, la plupart du temps mal goudronnées sur un soubassement pavé qui apparaissait, relique du passé, sur les bas-côtés.
Ils atteignirent Maule. Puis ce fut Thoiry qui revenait à la vie depuis la création de son parc zoologique. Après Septeuil ils traversèrent une belle forêt de hêtres et de chênes puis ce fut Montchauvet.
L'ancienne ville forte apparut sur la gauche, perchée sur un piton rocheux, à l'écart de la route. Montchauvet, site retranché qui, autrefois, fut sans doute un havre de paix pour ceux qui s'y réfugièrent reste aujourd'hui un havre de paix pour ceux qui ont la chance d'y posséder une maison.
Le chemin qui traverse le village est sinueux comme une route de montagne. Son étroitesse a même nécessité la création d'un sens unique qui oblige les voitures à faire un détour pour gagner la grand-place. Aussi les riverains ont-ils pris l'habitude de privilégier la marche à pied ou le vélo pour aller faire leurs courses chez l'épicier, unique commerçant du lieu.
La propriété des parents de Jacques se situait un peu à l'écart du bourg. De l'extérieur on n'apercevait qu'un haut mur qui protégeait des regards indiscrets la maison et ses dépendances. Jacques franchit le portail laissé ouvert à leur intention et gara Ernestine sur le terre-plein qui servait de parking. Un petit coup de klaxon pour prévenir de leur arrivée fit sortir de sa niche un énorme bouvier des Flandres qui vint vers la voiture et qui, dès que Jacques mit le pied à terre, lui fit fête en sautant sur lui avec ses grosses pattes terreuses.
- Porthos ! Couchez ! Gronda Jacques dont les vêtements commençaient à souffrir. Peu obéissant, Porthos continuait à manifester intempestivement son affection et il fallut l'intervention du maître de maison pour que le chien consente enfin à se tenir tranquille.
Evelyne découvrit alors un petit monsieur replet aux joues roses et à l'oil malicieux. Un personnage digne de ceux de Courteline avec un charmant prénom : Armand. En bras de chemise et un râteau à la main il avait l'air tout heureux de profiter du beau temps pour jardiner.
- Gisèle ! Ton fils est là, cria-t-il en se tournant vers le fond du jardin. Une silhouette surgit de la remise. Gisèle était tout le portrait féminin de Jacques. Brune, élancée, assurément plus grande que son mari, elle avait la démarche élégante, l'air décidé et un visage d'une grande beauté. Comme son fils elle était très affable. Aussi, dès qu'elle aperçut Evelyne, elle s'empressa de mettre la jeune femme à l'aise afin que dès cet instant aucune gêne ne vienne s'installer entre elles.
Jacques connaissait sa mère : ravie de voir son fils se décider enfin à « refaire sa vie », elle allait tout mettre en ouvre pour se montrer à la hauteur de la situation même, si par la suite, les choses risquaient de se gâter.
Aussitôt Evelyne fut prise en main. On ne lui donna, ni du mademoiselle, ni du « ma petite » mais on l'appela simplement par son prénom. On évita de lui évoquer le Jacques bébé si mignon et de lui signaler que s'il avait toujours mal digéré le chou-fleur, il pouvait en revanche se gaver de tripes sans tomber malade.
Le premier soir fut très plaisant. Une petite flambée dans la cheminée du salon accueillit les arrivants. Le repas simple mais excellent, arrosé d'un petit vin de pays, mit tout le monde de bonne humeur.
Armand était très fier des travaux de restauration qu'il avait mené à bien :
- Evelyne, dès demain matin je vous fais visiter mon ouvre. Un fignolage au petit poil vous verrez. J'y ai consacré vingt ans de mon existence et je ne le regrette pas. Il faut savoir laisser des traces de notre passage sur cette bonne vieille planète. Ce ne sont pas les actes notariés que j'ai pu rédiger tout au long de ma carrière qui laisseront un souvenir impérissable de moi, tandis que ces murs. Et il englobait d'un geste large toute la propriété. Il en restera quelque chose, enfin je l'espère !
Après un bref silence, il reprit plein d'enthousiasme :
- ce prieuré n'était qu'une ruine lorsque je l'ai acheté pour une bouchée de pain en mille neuf cent cinquante juste après la guerre. Moi-même je l'ai laissé en état plusieurs années parce que je n'avais pas le temps de m'en occuper et aussi parce que je n'avais pas bien réalisé l'importance du site. La chapelle transformée en grange pendant des lustres cachait des trésors sous les meules de foin. Quant au reste, c'est-à-dire le réfectoire, la bibliothèque, les appartements du prieur et les cellules des moines, j'ai dû tout reconstituer à l'aide des plans que j'ai pu retrouver à l'évêché de Mantes. La pièce où nous sommes était le réfectoire.
Il se faisait tard et, malgré le bavardage intempestif d'Armand, Jacques et Evelyne somnolaient à moitié devant la cheminée où, peu à peu, le feu s'éteignait doucement. Le père de Jacques finit par s'en rendre compte :
- Gisèle ! je parle, je parle et ces enfants tombent de sommeil. Il est temps que tu montres sa chambre à notre invitée. Ah ! Ces parisiens qui nous arrivent toujours fatigués !
Jacques n'avait pas sourcillé. Sa mère non plus. Conduire Evelyne à sa chambre ? Quelle chambre sinon celle de Jacques. Ou bien son père avait des conceptions d'un autre temps ou bien il ne s'était même pas rendu compte de ce qu'il disait, tout à son dada favori.
Il n'y avait qu'un problème dans la chambre de Jacques : l'exiguïté du lit. C'était un lit ancien d'un mètre vingt de large. Du temps de son mariage avec Anne, Jacques avait demandé à sa mère d'installer un lit plus vaste. Mais celle-ci n'en avait jamais rien fait. Au début lorsque le jeune couple venait passer quelques jours à Montchauvet Jacques trouvait agréable la promiscuité imposée par l'étroitesse de la couche. Ensuite, quand les choses allèrent de mal en pis et qu'Anne cherchait querelle pour un rien, le lit devint cause de dispute. « Impossible de dormir pliée en deux. Pas fermé l'oil de la nuit » ronchonnait-elle bien décidée à ennuyer Jacques par ses récriminations. L'histoire se termina par un lit-cage qu'on déplia dans le cabinet de toilette voisin et que la jeune femme monopolisa aussitôt. Après leur séparation, Gisèle, se dispensant de tout commentaire, fit disparaître le lit-cage.
Aujourd'hui le problème se posait à nouveau. Jacques savait qu'Evelyne aimait ses aises et qu'elle avait plutôt tendance à dormir en travers du lit. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, il lui expliqua le problème. Evelyne prit le parti d'en rire. Jacques alors crut bon d'excuser sa mère :
- Tu comprends, expliqua-t-il, elle considère qu'un couple de jeunes mariés est fait pour avoir des enfants. Et comme elle veut un héritier, crois-moi, l'installation du lit-cage l'avait mise dans tous ses états.
- Mais tes sours (Jacques avait deux sours plus âgées que lui) ont déjà des enfants rétorqua Evelyne surprise et puis, ajouta-t-elle, avec les méthodes contraceptives actuelles on a beau partager le même lit.
- Sans doute, répondit Jacques, mais moi je transmets le nom de la famille comprends-tu ? Pas mes sours. Quant à parler pilule à ma mère autant lui parler chinois. Elle ne veut rien savoir. Elle a décidé une fois pour toutes que les femmes qui la prenaient mettaient leur santé en péril.
Ils avaient très, très sommeil mais Gisèle avait raison : les rapprochements suscitent les désirs.
Le lendemain matin les trouva toujours enlacés mêmes si de sérieuses courbatures matérialisaient les positions acrobatiques qu'ils avaient dû prendre pour essayer de dormir sans trop se gêner l'un l'autre.
Evelyne allongée près de Jacques s'étonnait :
- Tu n'as jamais insisté pour que ta mère installe un autre lit ?
- Non
- Pourquoi ?
- Parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête.
- Et si Anne le lui avait demandé ?
- Elle n'aimait pas Anne et c'était réciproque alors tu vois.
- Ça promet, soupira Evelyne de nouveau inquiète.
- Rassure-toi, elle a mis de l'eau dans son vin depuis mon divorce. Elle ne supporte pas de me voir seul. Elle fait partie de cette génération de femmes qui s'imaginent qu'un homme célibataire est incapable de se cuire un ouf, de laver une paire de chaussettes et encore moins de repasser une chemise. Seule une femme peut régler de tels problèmes matériels.
Evelyne soupira :
- Raison de plus pour que je sois inquiète. Tu sais très bien que je n'excelle pas en la matière.
- Sans doute mais n'y pense pas. Je ne vis pas avec ma mère. Si nous devons vivre ensemble il y a d'excellents traiteurs, des laveries automatiques et. des femmes de ménage. Crois-tu vraiment qu'Anne s'occupait de moi ?
- C'est peut-être pour cela que ta mère ne l'aimait pas.
- Je n'en suis pas persuadé. Allons viens et profitons de la matinée qui s'annonce belle.
Effectivement le soleil qui montrait déjà le bout de son nez laissait augurer d'une chaude journée.
Lorsqu'ils pénétrèrent dans la cuisine pour prendre le petit-déjeuner, ils trouvèrent des croissants sur la table et la cafetière remplie d'un délicieux café. Gisèle et Armand étaient absents.
- Ils sont partis faire leur jogging avec le chien, expliqua Jacques.
- C'est le chien qui les entraîne ? demanda Evelyne non sans humour.
- Si tu veux. Il n'empêche qu'à leur âge c'est bien qu'ils continuent à se tenir en forme.
- Tu as sans doute raison. On devrait s'y mettre nous aussi. Peut-être que cela m'aiderait à évacuer mon stress et à mieux dominer mes migraines.
- Tu parles sérieusement ?
- Je suis on ne peut plus sérieuse. Tu ne fais aucun sport. Quant à moi, il y a belle lurette que je n'ai pas touché une raquette de tennis faute de partenaire.
- Je croyais que c'était à cause de tes migraines ? A propos tu m'en parles moins, cela irait-il mieux ? Clément ferait-il des miracles ?
Evelyne avait caché sa dernière crise à Jacques. Ce n'était pas par manque de franchise mais, comme toujours, elle n'avait pas envie de l'ennuyer. Et pourtant elle aurait pu lui dire que les crises non seulement semblaient s'espacer mais aussi qu'elles étaient moins violentes qu'avant. Que les vomissements étaient moindres et que l'apaisement venait plus vite. Qu'elle ne restait plus des nuits entières sans dormir. Des progrès si minces qu'elle ne jugeait pas utile d'en parler. Aussi, ce matin-là sa réponse fut comme à l'accoutumée évasive :
- J'essaie de m'en sortir.
- Et où en es-tu avec Clément ?
- Toujours pareil. Je parle, il écoute. Il y a des moments où il a l'air bizarre comme si ce que je lui dis l'indispose. J'ai comme l'impression qu'il veut à tout prix me taire quelque chose. Je ne suis pas très psychologue mais je suis certaine qu'il détient un secret qui le met mal à l'aise à mon égard.
Jacques prit un air embarrassé surtout quand Evelyne ajouta :
- Et je pense que ce secret tu le connais.
A son tour Jacques éluda :
- Pas vraiment. Il vit peut-être mal son homosexualité.
Evelyne allait pousser Jacques dans ses retranchements lorsque le retour de ses parents interrompit leur conversation. Mais elle se promit d'y revenir dès que l'occasion s'en présenterait.
« Bien dormi ? » Gisèle et Armand rentraient tout essoufflés de leur jogging mais très fiers de leur performance quotidienne.
Comme promis, Armand entraîna Evelyne faire le tour de son domaine. Elle visita la crypte, le cloître, et surtout la bibliothèque qui avait été non seulement restaurée mais encore regarnie de nombreux volumes très anciens. Une petite merveille. Evelyne qui aimait les livres se mit à feuilleter ça et là ce qui lui tombait sous la main. Armand finit par la laisser et il fallut que Jacques vienne la chercher à l'heure de l'apéritif tant elle s'était absorbée dans ses lectures.
Ils déjeunèrent sur la terrasse qui dominait le vallon. Cette fois la conversation fut plus intimiste que celle de la veille. On parla des sours de Jacques. De Catherine qui mariée à un médecin avait abandonné son cabinet de kinésithérapeute pour s'occuper exclusivement de l'éducation de ses deux filles. « De toute façon à Dijon où ils vivent il y a pléthore de kiné.alors autant qu'elle se consacre à son foyer. » Quant à Michèle, la cadette, mariée à un onologue. « Elle préfère aider son mari dans son travail. Elle le suit dans tous ses déplacements à travers le vignoble bordelais et assure son secrétariat. sans pour cela l'empêcher de surveiller de près le travail scolaire de leur fils qui est un excellent élève. »
« Ma vieille prends-en de la graine » se disait Evelyne en écoutant Gisèle faire l'éloge de ces deux ménages exemplaires. Dans ce tableau idyllique Jacques faisait office du canard boiteux qui aurait tout intérêt à se ranger avant de se voir désavoué. Toutefois, Il était clair que Gisèle se montrait beaucoup plus indulgente avec Jacques qu'elle ne l'aurait été avec ses filles en pareilles circonstances. Même si elle réprouvait le mode de vie de son fils, elle le tolérait. Du reste, Jacques qui le savait en profitait volontiers. Et, quand sa mère abordait le sujet il se contentait de sourire sans répondre.
Le repas fut aussi soigné que celui de la veille. Gisèle excellait dans l'art de tenir une maison et aimait qu'on le remarquât. L'intendance était son cheval de bataille et dès que l'occasion lui était donnée de l'enfourcher, elle ne s'en privait pas pour bien montrer qu'en ce domaine elle était imbattable.
L'après-midi s'écoula entre la digestion d'un déjeuner trop copieux, le rangement de la cuisine et une courte promenade à travers le bourg. Jacques habituellement incapable de tenir en place semblait se plier au rythme paisible de ses parents. En réalité il rongeait son frein et n'avait qu'une hâte : trouver un prétexte pour échapper à l'emprise familiale.
Il le trouva en fin de journée quand sa mère s'aperçut, vexée, qu'elle avait oublié de passer prendre le poulet, la faisselle de fromage blanc et le pot de crème qu'elle avait commandés chez le fermier qui l'approvisionnait en volaille et en laitages.
-Te dérange pas ! J'emmène Evelyne faire un tour et nous passerons chez le père Lemée récupérer le tout. O.K. ?
La balade à travers la campagne les détendit. Jacques imita sa mère :
- Alors mademoiselle quand cesserez-vous de travailler pour élever vos lardons ?
Et d'ajouter :
- Te fais pas de bile, elle a l'air comme ça de vouloir tout régenter mais en réalité mes frangines ne lui disent pas tout. pour avoir la paix.
Evelyne trouva qu'il était optimiste. Les choses ne sont jamais aussi simples. Mais elle ne voulut pas le décourager et dit :
- Nous verrons bien. Encore faudrait-il déjà que nous soyons décidés. Tant que je n'irai pas mieux.
- Je sais, je sais. N'empêche que nous ne pouvons pas attendre trop longtemps, nous n'avons plus vingt ans !
Evelyne ne le savait que trop !
- Si tu tiens à moi, aie la patience d'attendre encore un peu. Mon analyse avance mais crois-moi ce n'est pas facile de percer l'abcès.
En disant cela Evelyne avait les larmes aux yeux. Ces dernières heures l'avaient fatiguée. Bien que les parents de Jacques soient des gens charmants elle s'était sentie, dès son arrivée, observée voire disséquée tel un insecte sous la loupe de l'entomologiste. Afin de ne point déplaire elle s'était efforcée de faire bonne figure mais s'y était épuisée. Elle avait hâte que le week-end s'achève.
Jacques ému la prit dans ses bras. D'un coup son angoisse disparut et d'une petite voix frêle elle murmura : « tu as raison, il ne faut pas tarder ».
Le reste du week-end passa très vite. Le dimanche, la visite d'amis venus à l'improviste permit à Jacques et à Evelyne de ne plus être sur la sellette. Ils rentrèrent sur Paris dans la soirée, légèrement bronzés et tout compte fait, pas mécontents de ces deux jours passés à la campagne.
- XXIV -
Il fait très lourd. La fenêtre entrouverte pour laisser pénétrer un peu d'air dans la pièce ne laisse, en fait, pénétrer que le bruit infernal des voitures. Bruit que l'air chargé d'électricité et l'étroitesse de la rue amplifient encore. Clément entend à peine ce que murmure Evelyne. Dès son arrivée il a constaté qu'elle a un comportement inhabituel. Elle a évité de le regarder et s'est précipitée sans un mot vers le divan où elle s'est allongée sans essayer de prendre une pose désinvolte.
« Ma sour avait deux ans quand papa nous a quittées et ma mère n'a jamais accepté qu'il nous ait laissées démunies de tout »
Evelyne vient de prononcer la phrase fatidique qu'elle retenait depuis des semaines. Elle l'a jetée dans un sanglot incoercible, incapable de refréner plus longtemps les larmes qui inondent son visage.
Son père ! Sa mort lui fait horreur. Elle se rappelle. Elle a neuf ans et découvre l'absurdité du néant. Son père. Elle ne veut pas quitter la chambre où il repose. Elle ne veut pas qu'on l'enterre. Son grand-père essaie en vain de la raisonner mais les arguments employés ne servent à rien. Elle veut son père et reste fermée à toute tentative de consolation. Surtout, elle ne comprend pas pourquoi le bon Dieu qu'elle priait pour la guérison de son père ne l'a pas entendue. Son père. Son premier chagrin. Son premier grand chagrin d'amour. Sa mère ne lui dit rien. Sa mère se contente de la rabrouer lorsqu'elle la surprend à pleurer dans son coin : « Evelyne, s'il te plait ! Cesse de pleurnicher. Ton père était gravement malade. Il valait mieux pour tout le monde qu'il soit parti très vite. Il aurait pu nous contaminer tous et surtout ta petite sour qui est si fragile ».
Evelyne serre les poings. Elle écoute les conversations des grandes personnes entre elles : « le médecin a dit qu'il était devenu allergique au rimifon. Le pauvre n'avait plus aucune chance de s'en sortir ! »
Le jour des obsèques Evelyne donne la main à son oncle parce que personne d'autre que lui ne s'occupe d'elle et qu'il est le seul à comprendre ce qui se passe dans sa tête. Lorsqu'elle pleure trop fort, il la prend par les épaules et lui essuie les yeux avec un grand mouchoir à carreaux qu'il sort de la poche de son veston.
Plus tard dans la soirée, il obtient d'emmener Evelyne pour qu'elle passe quelques jours auprès de sa tante et de ses cousines. Permission accordée du bout des lèvres par sa mère qui juge sévèrement le comportement excessif de sa fille aînée en de telles circonstances.
Ce soir-là Evelyne se souvient : ses trois cousines, qu'elle voit rarement, sont ravies de l'avoir avec elles. Sa tante lui fait boire une énorme tasse de chocolat et elle finit par s'endormir coincée bien au chaud entre les coussins du cosy-corner de la salle à manger.
Evelyne restera quinze jours chez son oncle. On est en décembre. Noël approche. Evelyne participe à la décoration de l'immense sapin dressé dans l'entrée. Ses cousines lui apprennent à faire des étoiles en carton qu'elle recouvre de papier doré ou argenté. Elle grimpe sur un escabeau pour attacher plein de petits sujets en papier mâché et des boules en verre de toutes les couleurs. Elle installe des guirlandes.Tout lui paraît féerique. Autour d'elle on croit qu'elle oublie son chagrin. Elle cicatrise mais elle n'oublie rien. Simplement ici elle se plait. Bien que sa mère n'y tienne pas sa tante insiste pour qu'elle reste réveillonner.
Pour la première fois, elle assiste à la messe de minuit puis au retour. il y a les cadeaux au pied du sapin. Evelyne déniche le sien. Et, sous l'emballage en papier décoré de petits lutins, elle découvre une jolie trousse garnie de crayons de couleurs et des habits pour sa poupée.
Ensuite, elle se souvient d'avoir mangé du gâteau de riz arrosé de crème anglaise, un gros morceau de bûche au chocolat et d'avoir bu un peu de champagne dans une grande coupe en cristal. Sous l'effet de l'émotion elle s'est mise à pleurer. Elle pleure parce que lors de son dernier anniversaire c'était avec son père qu'elle avait trinqué. Et puis ce jour-là, il lui avait offert une très belle poupée qu'elle convoitait depuis longtemps. Et puis elle pleure parce que la peine ça ne s'explique pas. Sa tante alors, pour la consoler, la prend sur ses genoux et la câline jusqu'à ce qu'un sourire illumine enfin son visage. Les souvenirs qu'Evelyne garde de sa tante sont fugaces mais empreints de moments délicieux comme celui-là où, pelotonnée contre sa poitrine, elle laisse libre cours à son chagrin.
Evelyne enviait ses cousines. Intercalée entre la cadette et la benjamine, elle aurait pu être leur sour, ce dont elle rêvait en secret. Car leur vie était beaucoup plus agréable que la sienne. Par exemple, elles ne semblaient jamais astreintes à faire leurs devoirs, à apprendre leurs leçons. Les résultats scolaires s'en ressentaient peut-être un peu mais, grâce à leur mère qui les choyait, elles bénéficiaient d'une atmosphère familiale chaleureuse qui valait bien toutes les bonnes notes de la terre.
Evelyne s'en moque de pleurer devant Clément. Ses larmes contenues pendant des années se répandent sur son visage sans qu'elle essaie de les essuyer. Elles glissent le long de son cou et viennent en rigoles inonder son corsage.
Clément ne dit rien. Il faut qu'Evelyne continue de parler. Jusqu'au bout, sans rien omettre. Les vannes de son subconscient viennent enfin de s'ouvrir au moment même où il désespérait d'obtenir un résultat positif. Maintenant qu'elle a lâché prise, elle s'abandonne sans retenue et semble avoir totalement oublié la lutte qui jusqu'alors, à chaque séance, les opposait.
Clément est soulagé. Le chemin qu'Evelyne vient de parcourir a été douloureux mais salutaire. Aujourd'hui elle va enfin pouvoir régler ses comptes avec son passé et envisager un avenir plus serein. Clément l'envie car il sait que pour lui rien n'est réglé.
A travers ses larmes, Evelyne ne voit plus rien. Seul son passé qui explose dans sa tête défile devant ses yeux.
Après Noël, elle retrouve les siens et là tout change. Définitivement. Dans la maison au bord de la rivière, la vie a repris son cours. Normalement. Tous paraissent même soulagés. Plus aucune trace de son père ne subsiste. La chambre où il est mort a été désinfectée et tous ses vêtements ont été donnés aux petites sours des pauvres. La seule marque du passage de son père dans cette maison est sa photo en marié, dans la chambre de ses grands-parents. Le culte du souvenir s'arrête là.
Evelyne comprend vite qu'il ne faut poser aucune question. Et elle n'en pose aucune mais, lorsqu'ils ont tous le dos tourné, elle fouille dans les tiroirs et finit par dénicher une vieille photographie où elle pose avec son père. Il sourit en la regardant, il sourit tendrement. Elle vole le cliché et le conservera, caché sous la couverture d'un livre. Cette photo, elle la possède encore aujourd'hui mais elle a toujours beaucoup de mal à la regarder avec sérénité.
Ensuite, tout bascule très vite. Evelyne n'existe plus que pour rendre des comptes sur ses résultats scolaires. Le reste du temps on la néglige au profit de sa sour Jacqueline qui est de nature chétive. Et puis sa mère doit trouver un emploi car la maigre pension qu'elle reçoit ne suffit pas pour subvenir à leurs besoins. « Ah ! Si j'étais veuve de guerre, je n'aurais pas de problèmes financiers mais qui va accepter d'embaucher la veuve d'un tuberculeux ? Cela fait peur » geint-elle à longueur de journée.
A tout cela s'ajoute l'angoisse des grands-parents qui, victimes de mauvais placements en bourse, voient leurs revenus s'amenuiser de jour en jour. Rien ne va plus. La famille éclate. On parle de vendre la maison, de vendre l'entreprise qui périclite. On en veut à son oncle qui préfère son indépendance à une association familiale. Le grand-père d'Evelyne baisse les bras et n'aspire plus qu'à une retraite bien méritée encouragé en cela par sa femme qui rêve de retourner en Auvergne dans le village où elle est née.
Evelyne supporte les récriminations de sa mère. Et pourtant celle-ci devrait s'estimer heureuse d'avoir trouver du travail comme secrétaire dans une fabrique de papiers peints qui vient juste de s'installer à proximité de chez eux. Combien d'années Evelyne n'entendra-t-elle pas le leitmotiv que sa mère ne cesse de répéter « une femme doit avoir un métier. Moi qui suis veuve avec deux enfants je peux en parler en connaissance de cause. Même si on choisit bien, pas comme moi qui ai épousé un malade bien sûr, on est toujours à la merci d'une guerre, d'un accident, que sais-je encore. d'un abandon ou même d'une période de chômage. Et si on n'a aucun diplôme pour faire face autant dire qu'on est vite dans de beaux draps ! Heureusement j'avais mon brevet. » Elle ne pleure pas son mari. Elle pleurniche sur elle-même. Et d'ajouter : « puisque Evelyne travaille bien en classe elle aura au moins la satisfaction d'avoir une situation. Une bonne situation et pas de mari voilà l'idéal ! ».
Et c'est ainsi que sa mère lui inculque peu à peu l'idée que seul le métier compte dans l'existence. Un métier qui lui permettra de devenir indépendante et. le cas échéant de subvenir aux besoins de sa mère qui fait tant pour elle et de sa sour si fragile. Evelyne est bercée par des phrases telles que : « tu dois bien ça à ta mère qui se sacrifie pour que tu puisses faire des études. Combien d'enfants de ton âge sont déjà obligés de travailler ! ».
A force de l'écouter, Evelyne finit par faire siens les propos de sa mère. Ne doit-elle pas remplacer au mieux son père qui n'est plus là. Toutes ces années, pas un instant, il ne lui viendra à l'idée de contester les décisions maternelles. Elle s'inclinera, en souvenir de son père, comme d'ailleurs il l'aurait fait s'il avait été encore là.
Les années qui suivirent vont transformer Evelyne en une adolescente studieuse qui n'a qu'un but : réussir ses examens.
Finalement la maison au bord de la rivière a été vendue. Les grands-parents se sont retirés dans un petit village proche de Clermont-ferrand. L'oncle a déménagé et Evelyne a très peu de nouvelles de sa tante et de ses cousines. Dans le Morvan, ses grands-parents paternels très éprouvés par le décès de leur fils unique se sont éteints l'un après l'autre à quelques mois d'intervalle. Leur maison aussi a été vendue. La vente a permis à sa mère d'acheter un petit appartement dans une construction neuve à l'autre bout de la ville loin de la rivière. Il n'y a plus de grenier, il n'y a plus d'objets inutiles à épousseter. Il n'y a plus de jardin. Seule avec sa mère et sa sour Jacqueline, Evelyne mène désormais une vie austère quasi monacale.
La petite Jacqueline se porte mieux depuis qu'elle passe toutes ses vacances en Auvergne où le bon air fortifie ses poumons délicats. Evelyne n'éprouve pas beaucoup d'affection pour sa sour. Elle la trouve idiote. Il est de fait que l'enfant ne brille pas par son intelligence et que souvent elle donne du fil à retordre à ses institutrices. Apprendre lui coûte et, en classe, elle préfère de loin bayer aux corneilles et rêvasser plutôt que d'écouter la leçon. Elle est souvent punie et reléguée parmi les dernières de sa classe. Ce dont elle se moque totalement.
Chose curieuse, leur mère n'a pas les mêmes exigences vis-à-vis de ses deux filles. Jacqueline considérée d'emblée comme une enfant aux possibilités très limitées sera très vite cantonnée aux tâches ménagères. Elle en prendra l'habitude sans se plaindre. Peu à peu elle deviendra, ce qui soulage sa mère et sa sour, l'intendante du foyer. Et, l'année où Evelyne achève brillamment sa licence de biochimie, Jacqueline passe de justesse le brevet élémentaire.
Evelyne est devenue ce que sa mère voulait qu'elle devienne : une femme dépouillée de toute féminité. Evelyne ignore tout de l'art de se tailler une robe dans un morceau de tissu, de se tricoter un pull à la mode, de réaliser la moindre recette culinaire. Elle ignore aussi le plaisir d'acheter des fleurs et de les mettre harmonieusement dans un vase, d'accrocher un tableau pour décorer un mur trop nu, de préparer une jolie table pour recevoir des amis. Vivant désormais seule, elle déjeune d'un sandwich et dîne d'un morceau de fromage et d'un fruit. Peu à peu elle se laisse envahir par son travail et plus rien d'autre ne compte. La seule chose qui la sauve c'est qu'elle possède, tout comme sa grand-mère maternelle, le sens inné de l'élégance vestimentaire. Aux pires moments, elle continuera à se vêtir avec soin, évitant tout laisser-aller. Toutefois, le goût des toilettes ne suffira pas à pallier le vide d'une vie certes indépendante mais solitaire.
Au début de sa vie professionnelle, Evelyne ne souffre pas de son isolement. Elle s'acharne à réussir dans son travail. C'est son seul but. Elle voit autour d'elle ses collègues vivre en couple et avoir des enfants mais elle n'éprouve pas le besoin de faire comme eux. Au fond d'elle-même, elle ne les critique pas mais elle ne les envie pas.
Evelyne hésite à poursuivre. Clément retient son souffle. Dehors, l'orage vient d'éclater. Dans la pièce il fait très sombre et un peu plus frais. Evelyne reprend : je sais très bien ce qu'a voulu ma mère. Au travers moi, elle voulait se venger. Se venger des hommes. Elle voulait que j'acquière les prérogatives des hommes. Que j'accède à une carrière d'homme. Et elle a tout fait pour y parvenir. Elle m'a moralement castrée pour que je ne tombe pas amoureuse d'un homme qui aurait pu ruiner tous ses espoirs et qui immanquablement ne pouvait faire que mon malheur. Avec ma sour, elle s'est vengée des femmes. Elle l'a obligée à n'être qu'une esclave juste bonne à récurer les casseroles et à nettoyer les affaires sales des autres. Ma mère avait la haine au cour lorsqu'elle nous a élevées. Résultat : Jacqueline a épousé un homme qui la domine et fait d'elle ce qu'il veut. Quant à moi, je n'ai connu que des aventures minables avec des hommes que je choisissais volontairement sans intérêt me garantissant ainsi l'assurance d'une histoire sans lendemain. J'ai passé mon temps à tricher avec moi-même et aujourd'hui je paie douloureusement la note.
Evelyne maintenant parle fort. Elle hurle : ma mère est un monstre. Elle n'avait pas le droit de nous traiter comme elle l'a fait. Un monstre d'égoïsme ! Je la déteste ! A cause d'elle je vis un cauchemar depuis des années. C'est elle qui aurait dû mourir et non mon père. mon père lui je l'aimais. comme j'aime Jacques aujourd'hui.
Au nom de Jacques, Clément tressaille. Mais Evelyne trop préoccupée d'elle-même ne prête pas attention à ses réactions. Elle poursuivrait à l'infini son monologue mais Clément conscient de l'effort qu'elle vient d'accomplir lui suggère de s'arrêter :
- Vous êtes épuisée. Allez vous reposer. Nous reprendrons jeudi voulez-vous ?
Comme un automate, Evelyne se lève, les joues en feu, les paupières gonflées. Elle regarde Clément et prend subitement conscience qu'il a tout entendu. Alors, gênée, elle fuit son regard mais, soudain, sur le point de partir, elle s'arme de courage et fixant Clément droit dans les yeux elle lui lance rageusement :
- Je ferai tout pour garder Jacques parce que je l'aime vraiment. Tout comme vous n'est-ce pas ?