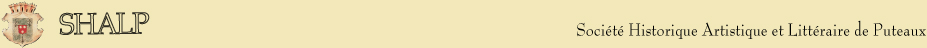

Littérature > Publications > Nouvelles > Les larmes du pays Toraja
![]()
Les larmes du pays Toraja
par Stéphanie Albarède
Elle rentra chez elle, les épaules voûtées par le désespoir. Toute cette énergie gaspillée en vain !
Elle laissa tomber ses clefs à même le carrelage, envoya promener ses ballerines à travers l’entrée. Elle se dirigea dans l’appartement sans allumer la lumière. Elle ne risquait pas de se cogner, il était quasiment vide. Elle se mit devant la baie vitrée de son salon - salle à manger – cuisine, le tout en un, terme bien à la mode. Elle pensait y retrouver la magie des premiers jours où elle avait emménagé. De son 16ème étage, elle avait tout de suite adoré la vue plongeante sur les appartements de la tour voisine. Quel plaisir de s’installer dans le noir et de regarder les ombres se mouvoir derrière les voilages, d’imaginer scénarios et dialogues au rythme des pièces qui s’allument et s’éteignent, au gré des agitations des silhouettes. Elle avait attribué un caractère de chipie aux jumelles du quinzième qui faisaient courir leur mère à l’heure du coucher, elle avait donné un rôle de bof totalement égoïste à l’homme du 14ème qui passait ses soirées devant l’écran de télévision pendant que sa femme s’escrimait dans la cuisine ou derrière ce qu’elle imaginait être une planche à repasser, elle se reconnaissait dans les soirées studieuses de l’ado du 16 ème qui semblait scotchée à son bureau. Dans l’appartement mitoyen, un couple semblait, par leur gestuelle, se disputer en permanence. Heureusement, leurs querelles ne gênaient pas le logement du dessous qui restait obstinément inoccupé. Au début, Franck se moquait gentiment de son petit côté voyeurisme à la Hitchcok. Puis, il avait pris plaisir à l’écouter inventer la vie de ces inconnus certains soirs où plongés dans le noir main dans la main, assis sur leur clic-clac, Chopin en fond musical, ils regardaient les lumières de Paris.
C’est avec Franck qu’elle avait choisi cet appartement. C’est avec lui qu’elle avait emménagé, chacun apportant avec lui les quelques meubles Ikéa survivants de leur passé tout récent d’étudiant. Ils s’étaient rencontrés six mois plus tôt à la soirée des publivores. Le hasard leur avait donné deux sièges côte à côte. Sa première pensée fût que ses jambes étaient immenses. Elle l’avait observé du coin de l’œil pensant qu’il n’arriverait jamais à les caser entre deux rangs de spectateurs. Elle fut surprise de voir avec quelle rapidité et quelle souplesse, il avait trouvé la place pour son mètre quatre vingt dix. Il lui avait adressé un sourire qui l’avait immédiatement séduite. Regard espiègle, boucles d’ange, il respirait la joie de vivre. Très vite, la salle avait plongé dans la pénombre de la projection, la privant ainsi de son image. Elle s’était concentrée alors sur les pubs qui défilaient. Elle était très bonne spectatrice, elle oubliait rapidement le monde qui l’entourait pour se laisser aller à toutes ses émotions, le seul moment où elle se le permettait. Ce soir-là, un cocktail de scènes humoristiques avait été diffusé. Ce qui avait déclenché en elle une cascade de fous rires qu’elle savait communicatifs. Petit à petit, elle s’était rendu compte que Franck ne regardait plus tellement l’écran. Il l’observait et riait de la voir rire. A la pause, elle s’était tournée vers lui et lui avait souri pleine d’espoir. Il lui avait proposé d’aller lui chercher une boisson. La glace était rompue.
Six mois après, ils terminaient leurs études respectives, lui d’ingénieur génie civil, elle de pharmacie. Chanceux dans le marasme actuel, ils trouvèrent rapidement un job. La décision d’habiter ensemble fut rapidement prise.
Trois ans déjà que, sûrs de leur amour, ils avaient co-signé le bail de ce deux pièces. Ce qui s’annonçait comme une merveilleuse histoire prometteuse de milles petits instants de bonheur s’était achevé six mois plus tôt sans qu’elle ne le pressente. Elle ne s’était pas rendu compte de la distance qui s’était petit à petit installée entre eux, trop occupée à construire, croyait-elle, leur avenir. Elle n’avait accordé que très peu de temps à Franck au cours de ces deux ans et demi, peut-être même moins encore qu’au temps de leurs études. Elle était obnubilée par le fait qu’elle devait faire carrière pour pouvoir construire leur foyer : engranger et vivre après. Elle avait donné plus d’heures à l’industrie qui l’avait embauchée qu’un couple ne pouvait supporter. On lui avait fait comprendre que le poste qui l’intéressait ne s’obtiendrait qu’au compte d’un certain nombre de sacrifices qui outre une certaine soumission impliquait des horaires élastiques.
Un dimanche de mai, elle rentra tard d’un séminaire et découvrit les valises de Franck encombrant leur entrée minuscule. Elle pénétra abasourdie dans le salon et le vit scotcher des cartons. Leurs regards se croisèrent. Soudain, Franck lui parut étranger, visage lisse inexpressif. Ce sourire qu’il lui adressait à chaque fois qui la regardait avait disparu. La peur lui serra la gorge, depuis combien de temps avait-il disparu ? Elle ne put articuler un mot. Franck prit la parole : «cela fait un moment que j’essaie de te parler, tu n’es plus qu’un fantôme pour moi. Même quand tu es là, ton esprit est ailleurs ». Ils discutèrent toute la nuit. Au matin, un copain vint l’aider à débarrasser ses affaires.
Elle n’avait pas pleuré. Elle ne savait pas pleurer. Et pourtant, elle souffrait. Son estomac tentait d’extérioriser par des brûlures intenses ce qu’elle ne pouvait évacuer par les larmes. Extérieurement, rien ne transparaissait. Seul un œil avertit aurait repéré une alimentation devenue anarchique, alternant crises de boulimie et périodes de jeûne.
Elle avait redoublé de zèle au travail pour abrutir suffisamment son esprit. Surtout éviter de penser...
Hier, Michelle avait organisé un apéritif pour son départ à la retraite. Elle l’avait serrée dans ses bras en lui souhaitant bonne chance, heureuse de voir que sa relève était assurée par une jeune femme talentueuse.
Michelle n’était pas, comme elle le pensait, dans le secret des dieux. Ce matin, le successeur fut présenté. Ce n’était pas elle. Elle vécut la scène au ralenti, persuadée qu’elle rêvait. Abasourdie, elle essayait de comprendre à quel moment elle avait bien pu pêcher. Mais le vide s’était installé dans sa tête. L’image de Franck vint combler l’espace. Elle n’avait plus qu’un mot à son vocabulaire «gâchis».
Toujours pas de larmes. Le sort s’acharnait contre elle, mais elle continuait à faire bonne figure, comme toujours.
Petite déjà, elle cachait ses émotions sous un verni glacé alors qu’elle aurait aimé crier qu’elle n’était pas un être froid, insensible, égoïste comme semblait le penser son entourage sauf... sa grand-mère.
Ce soir, elle était là devant sa baie du 16ème étage avec un leitmotiv comme fond musical : «Toute cette énergie gaspillée en vain». Plus de Franck, sacrifié au nom d’un poste usurpé par un inconnu à amitiés profitables.
Toujours pas de larmes. Juste des soupirs, métronomes du temps qui s’écoule.
Elle ne vit pas les lumières des acteurs de ses élucubrations nocturnes s’éteindre une à une. Alors que Paris s’endormait, une longue nuit de veille l’attendait.
Elle remonta le fil du temps, essayant de ne repenser qu’aux bons moments avec Frank d’abord, puis avec sa famille. Elle semblait vouloir faire un bilan à travers cette rétrospective. Souvenir après souvenir, elle arriva à son enfance. L’aurore pointa son nez alors que ses paupières s’alourdissaient sur sa grand-mère la berçant dans ses bras. A l’heure du marchand de sable, assises sur son petit lit, elles partageaient un moment de tendresse. Mémé lui racontait un des récits nés de ses voyages. C’était son préféré «les larmes du pays Toraja ». Toute à l’écoute de cette voix apaisante, son esprit traversait les frontières à la recherche du sommeil. « Cette histoire se passe au pays Toraja, sur une île dont la forme rappelle celle de l’orchidée et que l’on appelle Sulawesi. Les Torajas, issus d’un peuple très ancien qui avait quitté la Chine, avaient élu domicile dans les montagnes sauvages au cœur de l’île. La légende raconte que, arrivés par la mer, ils avaient utilisé leurs embarcations en les retournant pour confectionner les toits de leurs maisons... ».
Soudain, elle bondit de son canapé rescapé de la séparation des maigres biens. Elle voulait partir. Elle irait aux Célèbes et suivrait les pas de sa grand-mère qui lui manquait tant. Elle eut un instant d’hésitation par pur orgueil. Poser ses congés de suite pourrait passer vis à vis de ses collègues comme une manière de masquer sa déception, d’éviter leurs commentaires et leur pitié, de fuir un sentiment d’échec. Mais, l’envie de souffler, de se retrouver ou plutôt de se trouver fut la plus forte. Elle se brancha sur Internet et prix un aller-retour pour Yogyakarta, Ujung Pandang n’étant plus disponible. Elle partait dans trois jours.
Elle essaya de dormir pendant les longues heures de vol, mais l’adrénaline l’empêchait de s’enfoncer profondément dans un sommeil réparateur. Cette molécule qui lui était si utile quelques jours plus tôt créait des sortes de trous d’air dans son esprit au moment où elle sombrait et la ramenait ainsi, par des tressaillements, à la réalité. Ses sursauts d’une hyper-activité passée semblaient gêner son voisin. Elle avait essayé boules Quies et masque noir mais cela n’avait pu neutraliser ce stress qui tapit au fond d’elle, tentait de refaire surface à la moindre perte de conscience. Elle avait donc lu et relu son guide, afin de perdre le moins de temps possible (encore un travers de sa vie passée) dans le déroulement de son périple.
A son arrivée à l’aéroport de Yogyakarta, elle choisit de prendre un taxi pour se rendre directement à la gare routière. Java recelait des merveilles mais arriver le plus vite possible à Rantepao, capitale du pays Toraja, lui semblait vital. Elle eut la chance d’avoir un des seuls taxis qui maniait quelques mots d’anglais. Il parut surpris qu’elle veuille prendre un bus pour Surabaya, à l’Est de l’île. Il tenta de lui décrire les beautés de sa région, de lui dépeindre le charme et le sentiment de paix que dégageait Borobudur. Elle savait que ce temple bouddhique était une des plus belles merveilles du monde. Mais pour couper court à ce verbiage semi-compréhensible, elle lui dit un peu sèchement qu’elle ne manquerait pas à son retour de s’y rendre mais que pour l’instant elle devait rejoindre impérativement l’île de Célèbes. Le taxi insista en précisant que bientôt l’anniversaire de la naissance de Bouddha transformerait la visite en un instant magique. Des milliers de robes monastiques aux couleurs safranés viendraient se mêler aux 72 stupas dentelés. Elle hocha la tête. Délicatesse ou frustration, il arrêta sa description.
Lorsqu’ils arrivèrent à la gare routière, il lui indiqua à quelle compagnie s’adresser pour sa destination. Elle se rendit compte combien ce renseignement était précieux lorsqu’elle pénétra dans la gare, qui relevait plus à proprement parlé d’une zone délimitée plutôt qu’un bâtiment. Il était 9 heures du soir, et pourtant une foule disparate occupait tout l’espace, voyageurs, êtres désœuvrés, vendeurs de tout ou presque rien, de la fillette aux mouchoirs au vieillard aux petits pains... Ses vêtements collaient à sa peau moite. Leurs couleurs avaient pâli, une fine poussière grisâtre commençait à les recouvrir. La dernière douche était loin. La fatigue commençait à gagner vraiment du terrain. Elle prit un billet pour un bus de nuit dont elle ne savait pas réellement le prix, son esprit commençait à patiner, toute conversion monétaire mentale lui était impossible.
Elle prit une bouteille de coca à une vieille femme, aux dents et gencives ensanglantées. Un passage du guide lu dans l’avion lui revint en mémoire. Elle comprit que ce n’était pas du sang, mais une pigmentation, la vieille femme devait chiquer du bétel. Elle monta dans le bus qu’elle trouva confortable vul’état de la gare. Une fois assise, elle attacha son sac à dos à ses pieds car elle sentait que sa vigilance allait lui faire rapidement défaut. Elle cala sa tête contre la vitre. Quand le bus démarra, elle dormait enfin profondément.
Surabaya, joli nom exotique qui fait rêver. En fait de rêve, parlons plutôt de petit cauchemar ! A son arrivée, elle découvrit une ville industrielle sans âme, surpeuplée. Son bateau ne partait que le lendemain. Elle prit un petit hôtel à l’aspect colonial désuet mais les chambres bien que rudimentaires offraient l’eau chaude et avaient l’avantage d’être propres. Ayant une journée à tuer, elle décida de se rendre à la seule attraction touristique de cette mégapole : le zoo. Elle prit un bus puis finit le trajet à pieds, elle découvrit ce qu’était une circulation intense et anarchique, aucune commune mesure avec les chauffards et embouteillages parisiens. Y avait-il seulement un code de la route ? Oui, sûrement que le plus fort passe ! Aux voitures et bus brinquebalants, se mêlaient cyclo-pousses et Bekaks. Elle n’avait jamais envisagé la moto comme un transport en commun mais ici la démonstration était faite, jusqu’à cinq membres d’une même famille trouvaient place le long du cadre de l’engin. L’enfer sonore s’agrémentait d’un air fortement pollué. Un vrai régal cette balade !
Le zoo, décrit comme miteux par le guide, lui apparut cependant fortement intéressant. De nombreuses espèces, qui lui étaient inconnues, étaient représentées notamment le sanglier de Sulawesi dont parlait sa grand-mère dans son conte. Elle put vérifier qu’il avait bien 4 défenses. Mais ce qui retint le plus son attention fut le varan de Komodo, énorme lézard à allure préhistorique. Nul ne pouvait imaginer que cet être à l’aspect lourd et apathique pouvait se déplacer à une rapidité supérieure à celle de l’homme. Nul ne pouvait imaginer que cette petite tête pouvait lui permettre de broyer rapidement sa proie. Fascination et dégoût pour ce redoutable prédateur la maintinrent en observation un long moment.
Le lendemain, le cœur battant, elle pris enfin le bateau pour Sulawesi. Elle essaya d’oublier son aspect vétuste en discutant avec une touriste australienne qui avait déjà plusieurs îles indonésiennes dans son carnet de souvenirs. Elle avait craint fortement les pirates qui sévissaient dans ces eaux mais la traversée se passa sans embûche.
A son arrivée, elle décida de quitter immédiatement Ujung Pandang pour gagner le centre de l’île. Elle avait lu que des bus de nuit faisaient la jonction avec le centre de l’île. Elle, qui croyait avoir vu à Java ce qui pouvait se faire de plus rudimentaire en matière de gare routière, tomba de haut. Une marée humaine pataugeait dans vingt centimètres de boue. Son bus ne partait que deux heures plus tard, mais elle se dit qu’il valait mieux attendre à l’intérieur, la peur d’une quelconque contagiosité lui enlevant toute velléité d’exploration des alentours. Cependant, le trajet étant long, elle décida de se rendre au petit coin de la gare avant de s’installer. La porte des toilettes à la Turque constituée de quelques planches de bois non jointives était entrouverte. La marée de boue avait pénétré jusque là, ne permettant de déceler aucun dénivelé à usage de marche pieds. Impossible d’identifier ce qui relevait de la terre ou des excréments. Etant dans la capitale, elle se demanda ce qui l’attendait à Rantepao.
Lorsqu’elle monta dans le bus, il était déjà à moitié plein. Un jeune garçon d’une quinzaine d’année occupait la place mitoyenne de la sienne. Il lui sourit, ses longs cils noirs lui donnaient un regard doux. Elle sortit son guide pour tuer le temps. L’adolescent se pencha dessus et dit avec un fort accent : « Française ? ». Elle mit quelques secondes à répondre, étonnée de l’entendre parler sa propre langue. Elle répondit par l’affirmative. Il parût content, elle comprit plus tard l’intérêt qu’il lui portait. Il embraya immédiatement sur la religion en lui demandant de quel culte elle relevait. Elle ne fut pas surprise de cette question. Le guide l’avait avertit et conseillait de répondre «protestant », étant donné la particularité de Sulawesi. Très étonnant, sachant que Java la grande était essentiellement peuplée de musulmans. Elle suivit le conseil. Le jeune homme se tourna vers ses congénères et leur traduit lui sembla-t-il sa réponse. Cela déclencha une série de hochements de tête satisfaits. Puis, il lui demanda s’il pouvait lire le livre qu’elle tenait à la main à haute voix pour qu’elle corrige son accent. Elle sut alors pourquoi cela lui avait fait plaisir qu’elle soit française. L’exercice dura plus d’une heure. Elle trouva son accent charmant. Ensemble, ils rirent des accidents de parcours. On sentait par moment que la lecture était purement phonétique, la signification des mots échappait alors à l’adolescent. Assise près d’eux, une vieille dame au visage raviné les regardait le sourire aux lèvres. Elle semblait se laisser bercer par le chant des mots, par les sons d’une autre culture. Quand la fatigue eut raison de la voix de l’enfant, l’octogénaire lui tendit un fruit qui lui était inconnu. L’adolescent lui en révéla le nom : salak. Cela avait la forme d’une châtaigne et la taille d’un gros abricot. La peau avait un aspect repoussant, on aurait dit des écailles de serpent. L’enfant rit devant son air étonné et lui dit «mange, c’est bon ». Elle n’osa pas refuser. Elle ne le regretta pas. Sous la peau reptilienne, se cachait une chair à l’aspect de savonnette mais qui en bouche avait un goût proche de la poire avec au loin une pointe de noix. Elle dégusta lentement ce subtil mélange de parfums. Soudain, elle s’aperçut qu’elle ne ressentait plus cette impatience d’arriver au plus vite. Elle prenait goût au temps qui s’écoule lentement. Elle commençait réellement à se détendre et à savourer son voyage. Elle sourit aux gens qui l’entouraient, reconnaissante de ces instants de plénitude qu’ils lui offraient.
Les 12 heures de bus sur une route cahotante et sinueuse lui parurent finalement passer rapidement. L’ascension sur les plateaux montagneux lui fit découvrir une nature plus verte et plus exubérante.
Rantepao, enfin une ville à taille humaine. Elle prit une chambre dans un petit hôtel que lui avait indiqué l’adolescent sur une rue secondaire. Elle s’installa sur la terrasse et but du thé le temps qu’on lui prépare sa chambre. Courbaturée suite à cette nuit inconfortable, elle se lova dans le fauteuil moelleux et se laissa gagner par une douce léthargie. Un homme d’une quarantaine d’années vint lui proposer d’assister à des funérailles animistes d’un membre de sa famille. Sûrement un rabatteur qui n’avait rien à voir avec la famille concernée. Mais curieuse, elle céda et décida de reporter à demain la découverte des maisons typiques surnommées tongkonan et des statues mortuaires dont sa grand-mère abreuvait son récit. Cet après-midi, elle irait donc se confronter à un culte ancien en compagnie de cet homme qui malgré une insistance agressive paraissait somme toute sympathique. Elle était loin de s’imaginer ce qui l’attendait. Sa grand-mère avait passé sous silence cette coutume qui aurait pu hanter ses rêves d’enfant.
Son guide lui expliqua dans un anglais approximatif que le village où il se dirigeait avait été construit selon la coutume, spécialement pour ces funérailles, afin d’accueillir les invités. Elle découvrit un ensemble de cases en bambou aux toits en taule délimitant une grande place carrée au centre de laquelle se dressait une hutte sur pilotis destinée aux proches. Il lui désigna sur le sol de terre battue les pierres servant de lits de sacrifice. Là seraient égorgés les buffles. Le soleil était au firmament, il rendait l’air quasi irrespirable. Le guide la fit entrer dans une des cases et la présenta. Elle offrit les trois cartouches de cigarettes qu’il lui avait conseillé d’amener en guise de cadeau. On lui désigna une place, à même la terre. Elle s’assit entre deux jeunes filles aux cheveux noir ébène. Leur peau sombre était éclairée par le Batik bleu turquoise de leurs vêtements. Sans gène aucune, elles regardaient ses cheveux roux et sa peau laiteuse en riant. Elle se sentit le centre d’attraction et tenta de sourire malgré son malaise. Elle ne se sentait pas à sa place bien que le guide lui ait dit que sa présence était un grand honneur pour la famille. Peu à peu, leur gentillesse eut raison de son embarras. Elle se mit alors à son tour à observer les gens qui l’entouraient. Ils semblaient pour la majorité vieillis avant l’âge, l’état de leur dentition renforçant cette impression. Soleil et pauvreté avaient façonné leur visage. Ils étaient assis en tailleur autour d’une natte qui ferait office de table. Cette position ne lui permit pas tout de suite de remarquer l’état de leurs pieds mais lorsque l’un d’entre eux souleva une de ses jambes pour se gratter la voûte plantaire, elle découvrit une peau couverte d’un amas croûteux au ton jaunâtre. Boue, mycose, ... toute une série de causes possibles défila dans son esprit lui coupant l’appétit. Elle savait qu’ils allaient tous manger à main nue dans un plat commun. En effet, deux hommes arrivèrent avec deux tiges de bambou fumantes. Ils les ouvrirent et répandirent le contenu sur des feuilles de bananiers. Piètre cuisinière, même au summum de son incompétence, elle n’avait jamais servi un plat à l’aspect si peu ragoûtant. Un amas informe à l’aspect de tripes noirâtres lui était apparu. Les assiettes végétales entamèrent le tour des convives. Microphobie, parasitophobie, aspect « autopsique » et calciné de la nourriture, vision cauchemardesque de pieds, tout se mélangea dans son esprit. Une forte nausée la surprit. Elle passa son tour et demanda au guide, d’une petite voix chevrotante de bien vouloir traduire le fait qu’elle avait déjà mangé. Piètre mensonge ! Une des jeunes filles sourit, s’absenta quelques instants et revint avec un paquet de cookies. Ce geste l’émut. Depuis son arrivée sur l’île, elle n’avait croisé que des gens pleins de gentillesse. Elle grignota deux biscuits par politesse, essayant d’oublier la nausée qui semblait s’être définitivement installée. La chaleur ne faisait que renforcer son écœurement. Le toit de taule sous le soleil de plomb avait transformé l’air de la pièce en véritable fournaise. Les hommes se mirent à fumer, rendant l’air encore plus irrespirable. Le mélange sueur - fumée lui brûlait les yeux, donnant naissance à une crise migraineuse. Elle sentait sa tempe gauche se rigidifier, signe annonciateur de futures douleurs pulsatives. Elle commençait à se demander ce qu’elle faisait là, les jambes engourdies par la position assise en tailleur. La cérémonie n’avait toujours pas débuté. Elle était arrivée à midi, le rite ne prendrait fin qu’à la tombée de la nuit.
Brusquement, le temps parut s’accélérer. Des cris, des gens qui s’agitent et s’affolent, des bruits sourds de piétinements... Son cœur s’emballa, la panique s’empara d’elle. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Incrédule, elle vit la paroi arrière de la cabane exploser sous les cous de cornes d’un buffle, rendu furieux par le pressentiment de sa dernière heure. Il se rua sur eux, les yeux exorbités par la peur. Elle pria doucement. Heureusement, l’animal fut maîtrisé avant même que quiconque fût blessé. Tremblante, elle se rassit. Elle s’était vue pendant un bref instant éventrée par les cornes effilées du buffle. Les pulsations migraineuses, profitant du choc, s’en donnaient à cœur joie. On lui offrit une tasse de thé, elle se concentra sur le liquide brûlant afin de se calmer.
La cérémonie commença. Le guide lui expliqua qu’elle assistait à la dernière journée des secondes funérailles du défunt. Les premières avaient eu lieu juste après le décès. Pour organiser les secondes, il fallait du temps et de l’argent à la famille. Elles étaient importantes car l’âme de l’animal qui allait être sacrifié permettait au défunt de se détacher de sa vie terrestre afin de gagner le royaume des âmes. Plus de buffles seraient sacrifiés, plus l’âme du défunt s’élèverait. D’où la nécessité d’économiser de l’argent avant de réaliser cette seconde cérémonie. Il lui fit remarquer le catafalque en forme de tongkonan qui trônait en haut d’une tourelle de bois. Le défunt supervisait ainsi la scène. Son esprit fut happé par tout ce qu’elle voyait. Elle avait l’impression de vivre un des derniers cultes originels sur terre, non galvaudé par la vie moderne, comme si elle avait pris la machine à remonter le temps. Le rite s’éternisait en un curieux mélange de mélancolie et d’allégresse. Elle avait l’impression de vivre au ralentit. Le Mabadong accentua la torpeur dans laquelle l’avait plongée la chaleur. Cette lente ronde, dansée par des hommes habillés de sarongs noirs, durait 4 heures. Elle était comme hypnotisée. Elle était bien loin de son quotidien et de ses préoccupations. Le sacrifice mit fin à son état léthargique. La mise à mort du premier buffle lui parut une véritable boucherie. Le bourreau ayant raté l’égorgement dû s’y prendre à deux fois, prolongeant ainsi la souffrance de l’animal agonisant. Elle ferma les yeux pour ne pas voir la mise à mort des animaux suivants. Puis, le catafalque fût emporté par des hommes de la famille, suivit par le cortège de ses proches jusqu’au lieu de repos définitif du défunt dans une des falaises environnantes.
Elle rentra épuisée à l’hôtel. Elle prit une douche et n’eut pas le courage de ressortir pour manger. Sa nuit fut peuplée de minotaures la poursuivant ou agonisants à ses pieds.
Elle consacra la journée suivante à Lemo et Londa, deux villages au sud de Rantepao. Elle voulait voir les fameux Tau Tau, suite logique à sa journée de la veille. Elle fut impressionnée par les falaises sacrées. Des niches y avaient été creusées pour accueillir les tombeaux des villageois les plus riches. Pour chaque tombe, une statue, Tau Tau, effigie du défunt dont elle portait les vêtements, se dressait en gardienne du lieu. C’était spectaculaire toutes ces représentations installées aux balcons des niches. Leurs yeux de coquillages semblaient la fixer, créant une sensation de malaise comme si toute une armée de revenants lui faisait des reproches. La peur des revenants, une peur remontant à l’enfance...
Le lendemain, elle partit à la découverte de l’architecture unique et pittoresque de ce peuple. Sur le trajet, elle put admirer le paysage depuis le taxi collectif, une immensité de rizières où quelques paysans travaillaient alors que leurs buffles somnolaient dans l’eau boueuse. Elle visita plusieurs villages similaires par la disposition des maisons et leur architecture, mais son émerveillement ne fut pas émoussé par cette répétition. Une force extérieure semblait la pousser, à chaque visite, à aller à la découverte d’un autre village. Son regard ne se lassait pas d’admirer les tongkonan. Posé sur des pilotis en bambou, le corps rectangulaire du bâtiment offrait des façades décorées de peintures symboliques. Dans les teintes orange, noire et blanche, arabesques et figures géométriques s’étageaient en frises rectilignes. Les toits, mélange de bambou et chaume de riz, s’élançaient majestueusement vers le ciel en 2 pointes symétriques telles des proues de bateaux. Chaque tongkonan faisait face à son jumeau, le grenier à grain. Marcher entre ces deux rangées de constructions donnait l’impression de traverser une haie d’honneur.
Lorsqu’elle arriva à Palawa, elle s’assit sur une plate-forme sous un grenier à grains pour se désaltérer. Elle se croyait seule dans ce village apparemment déserté quand soudain elle aperçut une petite fille d’environ deux ans au visage rond, à la moue boudeuse, au regard inquisiteur. Soudain, une voix appela l’enfant. Dans la précipitation de la rejoindre, celle-ci trébucha et s’étala de tout son long sur la terre battue. Elle se releva, les genoux criblés d’écorchures. Ce petit bout de chou fixa alors son regard, les yeux humides. Elle sut malgré son jeune âge retenir ses larmes en se mordillant la lèvre inférieure. Elle s’efforçait de ne pas laisser transparaître son chagrin. Cela ne dura que l’espace d’un instant car dès qu’elle tenta de l’approcher, l’enfant disparut vers celle qui l’appelait. Elle resta interdite, cette petite fille c’était elle. Elle avait eu, enfant, ce même tic dompteur de larmes. Elle passa son index sur sa lèvre inférieure comme s’il pouvait en rester une trace. Subitement, elle se rendit compte que ses joues étaient baignées de larmes. Elle pleurait enfin. Elle resta là longtemps à laisser s’écouler son chagrin. Lorsqu’elle quitta le village, elle se sentait plus légère. Elle décida que Palawa serait le village qui clôturerait son circuit. Son voyage à Célèbes touchait à sa fin. Elle choisit de faire un bout de chemin à pieds au milieu des rizières. Le soleil rendait la marche pénible mais elle était heureuse. Le pays Toraja lui avait offert des larmes.
Elle décida de rentrer à Java par avion. Elle monta dans ce qui lui sembla être un coucou. Son état n’avait rien à envier à celui du bateau de l’aller. Un européen d’une trentaine d’années, à l’allure de baroudeur, prit place à côté d’elle. Il engagea immédiatement la conversation, en anglais. Elle rit en reconnaissant l’accent français. Ils continuèrent dans leur langue maternelle. Il lui raconta son périple en Indonésie : Bali, Lombok et Sulawesi. Ils échangèrent leurs impressions sur cette dernière. Il terminait comme elle son voyage par Java et lui proposa de visiter ensemble les alentours de Yogyakarta. Elle accepta. Son échappée solitaire tant désirée commençait à lui peser, elle ressentait le besoin de partager ses émotions. Ils discutèrent ensuite de leur vie professionnelle. Généraliste, il travaillait depuis la fin de ses études pour médecins sans frontières. La majorité de ses missions s’étaient déroulées dans le Nord de la Thaïlande. Il lui raconta son quotidien, ses peines, ses certitudes, ses désillusions, mais surtout ses joies et moments de bonheur qui le poussaient à continuer. Elle écouta avec passion son histoire. Elle eut petit à petit l’impression de découvrir ses propres aspirations, de se découvrir. Elle sut que sa vie allait changer.
« Merci, mémé, de m’avoir mise sur sa route, de me montrer la voie à suivre, merci pour ce cadeau».
La jeune femme qui descendit de l’avion n’était plus la même.