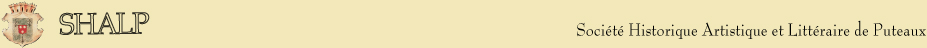
" L'aquarelle est-elle un art mineur ?
Son histoire de Dürer à Jackson Pollock "
Par Jean Roussaux
Texte d'une conférence de la SHALP au Palais de la Culture du 28.09.2024
1- Introduction.
Si vous feuilletez un livre d'histoire de l'art ou un de ces beaux ouvrages qui
décrivent avec de fort belles reproductions les tableaux des grands artistes ou si vous vous intéressez à leur
vie, décrite dans de nombreuses biographies, vous ne trouverez que bien rarement évoquée l'aquarelle. Cette
variété de peinture à l'eau si abordable par chacun ne serait-elle qu'un art mineur ? En parcourant ensemble une
petite histoire de l'aquarelle chacun pourra se faire une opinion.
2- Bref historique
C'est dans l'eau que la vie est apparue sur terre. De même c'est grâce à l'eau que la peinture a pu naître. La
peinture à l'eau est la plus ancienne des techniques. La plus universelle aussi. Doit-on rappeler que les
peintures rupestres seraient des œuvres faisant appel à une technique semblable au pastel dilué et que les
premiers textes des Egyptiens confiés aux bandes de papyrus sont illustrés de figures peintes à l'eau. Chez les
Hébreux les premiers textes sacrés sont tracés sur des papyrus ou du cuir puis sur des parchemins plus ou moins
enluminés. Les romains illustrent les textes des « volumes » avec des couleurs transparentes, peintures à la
détrempe ou à tempera, qui servent aussi aux décorations murales. En Chine et au Japon les peintures des
premiers siècles sont des peintures à l'eau comme l'aquarelle et dans le monde arabe, dont la peinture connaît
son apogée au XIIIème siècle, les illustrations de manuscrits comme le Maqâmât d'Al-Harîrî sont de belles
peintures sur papier. C'est à la Chine que l'on doit l'invention du papier qui, en Europe, va remplacer les
parchemins au cours du XVème siècle et permettre le dessin et le lavis. Parallèlement les plumes et les pinceaux
se diversifient servant à écrire ou à peindre. Finalement les premières peintures sont des peintures à l'eau.
Utilisée dans toutes les civilisations, la peinture à la détrempe subsiste encore au Moyen-âge en Europe où elle
permet les enluminures et la réalisation de fresques. Son utilisation restera universelle jusqu'au XIVème siècle
lorsque la peinture à l'huile est inventée par un peintre flamand, peut-être Jan Van Eyck (1390-1441). A partir
de cette époque la peinture à l'huile se généralise car, contrairement à la peinture à l'eau, elle permet les
retouches et assure une bonne conservation des œuvres.
3- Les techniques de peinture à l'eau
Lorsqu'on parle de techniques de la peinture il faut bien distinguer les techniques générales de la technique
particulière d'un peintre donné laquelle comporte bien des adjonctions au schéma général : utilisation ou non de
couleurs saturées, rapidité variable de la touche, papier plus ou moins humide et finalement l'acte créateur qui
varie naturellement d'un peintre à l'autre.
Dans la peinture à l'eau, l'eau est le solvant qui dissout des pigments finement broyés. Afin de fixer le
pigment on introduit un liant dont la nature donne des variantes de peinture à l'eau : L'addition d'une colle
(gélatine, colle de poisson, amidon) donne la détrempe, la fabrication d'une émulsion à base d'œuf donne la
peinture à tempera, éventuellement additionnée de résine ou même d'huile. L'addition de gomme arabique tirée
d'un acacia donne une couleur que l'on peut diluer : c'est l'aquarelle, fluide et transparente ; l'addition de
miel rend la couleur plus résistante au temps et lui donne plus d'éclat et de luminosité. Au contraire, si l'on
ajoute un blanc métallique, on obtient une couleur épaisse et pâteuse, la gouache, opaque et couvrante. Au
Moyen-âge les manuscrits font appel à des gouaches comportant du vinaigre, du sucre candi ou de la bile (fiel).
Plus récemment on a pu ajouter des dextrines (produits dérivés de l'amidon) ou des polymères acryliques.
Les pigments sont initialement des minéraux natifs (malachite : vert ; orpiment : jaune ; réalgar : orange.) ou
des produits organiques (cochenille, bois de saule brûlé.). Ultérieurement, et bien plus tard, s'introduiront
des composés organiques de synthèse : les peintures vinyliques et acryliques sont aussi des peintures à l'eau.
La peinture à l'eau a donc une longue histoire, ses techniques sont variées. Selon ses variantes elle peut
s'appliquer sur toute sorte de supports et son utilisation restera universelle jusqu'au XIVème siècle, alors
pourquoi l'aquarelle ne figure-t-elle pas au palmarès de la peinture ? serait-elle un art mineur, voire un art
dévalué ? Pour répondre, place à l'histoire de l'aquarelle !
4- Les premiers aquarellistes
Jusqu'au XIVème siècle les peintures sont donc des variantes de la peinture à l'eau. La peinture chinoise, des
illustrations de manuscrits du Moyen-âge et certaines œuvres de précurseurs comme Dürer (1471-1528), Raphaël
(1483-1520) ou Rubens (1577-1640) et les peintres de leurs ateliers, utilisaient l'aquarelle. Chez ces derniers
l'aquarelle, souvent monochrome ou lavis, servait à créer les ébauches de leurs œuvres à l'huile ou les
« cartons » préparatoires à la confection de tapisseries.
5- En effet la découverte de l'huile
relégua l'aquarelle à des esquisses pour de futures œuvres à l'huile et à
des peintures de petit format ou à des croquis pris sur le vif, sortes de notes de couleur. Vous voyez ici deux
belles esquisses au lavis de Lorrain et de Poussin qui sont riches de dégradés matérialisant le volume.
Rembrandt, réalisa aussi de tels lavis mais l'un des premiers grands aquarellistes est Dürer, pourtant ses
aquarelles ne représentent à son époque qu'une production plutôt isolée, la plupart des paysagistes pratiquant
le dessin à la plume.

6- Albert Dürer (1471-1528),
était un personnage important de la ville de Nuremberg, il était non seulement peintre mais aussi graveur et auteur
d'ouvrages comme un traité des proportions du corps humain ou des
instructions sur la fortification des villes et châteaux. Son œuvre à l'huile en fait un des artistes rivalisant
avec les maîtres italiens de la renaissance. Parmi les nombreux dessins qu'il a laissés, des illustrations
représentent des plantes ou des animaux peints à l'aquarelle soulignée de traits de gouache : ces œuvres font de
Dürer un des premiers peintres naturalistes. Ce type d'études culmine avec la grande touffe de gazon de 1503. La
grande touffe de gazon est exécutée avec un réel souci du détail à l'aide d'une aquarelle opaque maniée avec une
dextérité remarquable.

Comme beaucoup, il se rend à Venise (en 1494) et découvre la peinture italienne et la beauté des sites alpestres,
ce qui donnera naissance à de belles aquarelles comme le Val d'Arco. La vue du val d'Arco, de 1495, dans le
Tyrol méridional, nous présente la citadelle que l'on atteint en traversant des pentes peuplées d'oliviers et
de vignes dont l'aquarelle rend le modelé saisissant. L'horizon est débarrassé des montagnes lointaines pour ne
pas distraire le spectateur.

7- L'étang dans la forêt représente un paysage mélancolique probablement au voisinage de Nuremberg.
La lisière de la forêt, une sorte de sapinière, borde l'étang d'un bleu soutenu. Sur l'autre rive, un maigre bouquet
d'arbres décapités par l'orage parait se terminer dans un nuage bleu acier. Cette masse nuageuse limite le fond du
paysage formé par l'étendue claire et désolée d'une sorte de dune. C'est une sorte d'esquisse, car cette aquarelle a un
côté inachevé dont le ciel orangé et les nuages opaques pourraient indiquer la tombée du soir. Quant à ces arbres
décapités par l'orage n'auraient-ils pas inspiré Cézanne comme nous le verrons plus loin ?
La tradition naturaliste des peintures botaniques et zoologiques passe par les Pays-Bas avec Jacob de Gheyn le
Jeune (1565-1629) et Ambrosius Bosschaert dit l'ancien (1573-1621) et ses fils, tous peintres floraux. Elle se
perpétue au XVIIIème siècle avec Jan Van Huysum (1682-1749), peintre d'histoire mais aussi de fleurs et de fruits
. L'image montre le style de peinture florale mais il ne s'agit pas ici d'une aquarelle.
8- En France Gaston d'Orléans réunit les meilleurs peintres de fleurs qui travaillent sur vélin (un parchemin
issu de veau mort-né) donnant ainsi une importante collection de vélins conservés au Muséum d'Histoire Naturelle
de Paris. 0n peut citer Claude Aubriet (1651 ? -1742) qui avait illustré les trois volumes des Éléments de
botanique de Tournefort. De 1700 à 1702, Aubriet accompagne ce dernier au Levant et rapporte de nombreux dessins. Mais
le plus célèbre des peintres naturalistes de l'époque est probablement Pierre Joseph Redouté (1759-1840),
surtout connu pour ses roses aquarellées. Il est surnommé « le Raphaël des fleurs » et reçoit le titre de dessinateur et
peintre du Cabinet de la Reine Marie-Antoinette. Plus tard, il sera professeur de dessin de Joséphine et de Marie-Louise
et enseignera au Muséum d'histoire Naturelle de Paris.

Les aquarelles de fruits de Redouté sont plus rares que celles de fleurs. Sur l'image on admirera le velouté des
pêches, la chair translucide des raisins blancs, la discrétion des mûres qui ne le sont pas encore ...Mais une
question se pose : aurait-on l'idée de prendre son couteau pour couper l'une de ces belles pêches ? Non, tous
ces fruits sont trop beaux, nous n'en sommes pas dupes. En un mot c'est cela de l'art. La peinture zoologique,
elle, doit de fort belles œuvres à Maria Sibylla Merian (1647-1717) comme ses aquarelles des insectes du Surinam
. Longtemps méconnue, elle a produit une œuvre artistique et scientifique remarquable qui en a fait une
importante figure de l'histoire naturelle de son époque.
9- L'aquarelle anglaise
Avec Antoine Van Dyck (1599-1641), un élève de Rubens, portraitiste et peintre à la cour de Charles 1er
d'Angleterre, on retrouve des aquarelles ayant la transparence et la fraîcheur de celles de Dürer. Pourtant van
Dyck, qui influença les portraitistes anglais, n'est pas à l'origine du développement de l'aquarelle en
Angleterre après 1750. En effet au début du XVIIIème siècle, sous le règne de Georges II de Hanovre (1683-1760),
les peintres anglais qui trouvaient leur inspiration dans les ruines romaines, les paysages suisses et italiens,
produisaient surtout des eaux-fortes et des gravures dans la lignée des célèbres vedute (panoramas) de Canaletto
(1687-1758) sur la Tamise, Venise ou Rome.
10- Le véritable peintre à l'origine de l'aquarelle anglaise est Paul Sandby (1731-1809)
dont on voit ici
l'atelier. C'est un cartographe militaire, qui transforme la gravure rehaussée d'aquarelle en une œuvre
essentiellement peinte. Contrairement à d'autres peintres de cette époque, ce n'est pas un voyageur : il se
cantonne à découvrir la campagne anglaise et tout particulièrement le parc du château de Windsor dont il fait de
belles aquarelles.

Son œuvre influence d'autres aquarellistes du paysage comme William Pars (1742-1782). Celui-ci
rapporte de ses voyages des vues de Grèce et aussi de la région des Alpes dont on peut admirer cette vue du glacier du
Rhône. Il peint aussi des portraits et des miniatures ; il devient membre de la prestigieuse Royal Academy en 1763. On
dit qu'il serait mort d'un refroidissement à Tivoli. Avait-il comme beaucoup à l'époque succombé à la "Tivoli-mania" ?
11- Francis Towne (1739-1816) est connu principalement pour ses paysages réalisés à l'aquarelle, en
particulier ses aquarelles romaines.
C'est en 1780 et 1781 qu'il effectue un voyage essentiel pour la suite de son œuvre : il se rend à Rome, en passant par
la Suisse. De sa confrontation avec les Alpes, il a peint comme beaucoup la source de l'Arveyron, Towne retient un sens
de la verticalité. De l'Italie, il rapporte des paysages très typés comme cette vue de la roche Tarpéienne mais aussi et
surtout la lumière si particulière à ce pays. Les œuvres de cette époque sont sans doute les plus frappantes et les plus
réussies de l'artiste. Si dans les aquarelles de Pars aucun contour ne délimite la couleur, chez Towne, un fin liseré à
la plume cerne les aplats colorés.

12- Avec Thomas Girtin (1775-1802), ce météore ami de Turner, mort de tuberculose, l'aquarelle
s'installe définitivement sur la scène picturale. Les premiers paysages de Girtin sont de style topographique mais dans
les dernières années de sa courte vie, il a développé un style audacieux, spacieux et romantique, dans un esprit proche
de la poésie de William Wordsworth, ce poète qui soutient le régime républicain lors de la Révolution française. Il peint
des scènes urbaines et des vues de montagne avec des tons chauds, ocre et brun, tout en donnant au ciel une place
prépondérante. Plus tard il renouvelle sa palette de couleurs d'aquarelle, l'enrichissant de gris ardoise, d'indigo et de
violet. L'aquarelle de l'abbaye de Jedburgh est particulièrement respectueuse des détails de l'architecture ; l'édifice
est mis en valeur par le contraste avec la masse de la végétation du bord de la rivière et les nuages sont très travaillés
comme chez plusieurs de ses successeurs. D'un séjour à Paris il rapporte dessins et aquarelles comme La vue de la rue
Saint-Denis, dont il existe plusieurs versions assez différentes. Celle-ci est également un modèle de respect du
modelé de l'architecture.

On admet que Girtin a exercé une double influence : d'une part il a libéré l'aquarelle anglaise de toute dépendance à la
gravure et, d'autre part, il a instauré de nouvelles façons d'appréhender le paysage, préparant ainsi Bonington et Turner.
Apprenant la mort prématurée de Girtin, Turner aurait dit : « si Girtin avait survécu, je serais mort de faim ». Le
British Museum, la Tate Britain et le Victoria and Albert Museum possèdent des collections de ses œuvres.
13- Au début du XIXème siècle, à la suite de la Révolution française et de l'épopée napoléonienne, l'engagement
artistique change de sens : à la foi en la raison de l'homme et en sa perfectibilité succède le règne de l'incertitude et
du conflit entre les aspirations de l'artiste, sa créativité, le caractère unique de son œuvre et le développement de la
société industrielle dont Tocqueville dira « qu'elle produit des merveilles mais dans laquelle l'homme civilisé redevient
presque sauvage ». C'est dans ce contexte que l'aquarelle anglaise, longtemps injustement écartée des expositions
organisées par la Royal Academy de Londres, prend son autonomie, d'abord par la création en 1804 et 1807 de deux sociétés
des aquarellistes qui organisent leur propre salon mais aussi par la diversification des thèmes, l'aquarelle englobant la
nature morte et les scènes imaginaires et fantastiques de William Blake et de Füssli. En même temps les aquarellistes de
l'époque prônent une peinture pure, dépourvue de tout trait de plume ou de crayon, de tout blanc et de toute opacité.
L'aquarelle, tolérant mal les retouches et les repentirs, devient alors une démonstration de virtuosité.
Henry Füssli (1741-1825), né en suisse puis naturalisé britannique, professeur de peinture à la Royal
Academy, n'est ni paysagiste, ni portraitiste, mais l'auteur de compositions inspirées par la littérature (Milton,
Shakespeare) et la mythologie. C'est aussi un peintre du "fantastique". Lorsqu'il qu'il expose pour la première fois
l'huile baptisée Le Cauchemar, un parfum de scandale le rend immédiatement célèbre. Son plus grand admirateur
fut Sigmund Freud : il avait accroché une gravure du tableau dans son bureau. En fait ce tableau a fait l'objet de
plusieurs versions dont l'aquarelle presque monochrome illustrée ici. Son œuvre influencera son contemporain William
Blake.

William Blake (1757-1827). Surtout aquarelliste et graveur, hanté dès son jeune âge par des visions
provoquées par des troubles mentaux, Blake se fit connaître par l'édition de poèmes illustrés d'aquarelles (Livre de
job, poèmes de Dante).Selon lui « l'imagination, don divin, doit contrôler l'entendement humain sujet à défaillance »
Par son œuvre, à l'inspiration fantasque, voire démoniaque, traitée par la gravure, la tempera et l'aquarelle, il illustre
à merveille les richesses de la confrontation entre un monde matérialiste et une vie intérieure perturbée, ce qu'il
résumait en 1810 par «mon œuvre est visionnaire et imaginaire».
Sur la figure on voit Nabuchodonosor le roi de Babylone qui, selon la Bible, s'est exilé dans le désert jusqu'à en
devenir fou et se transformer en animal sauvage. Le voilà, à quatre pattes, des griffes allongent ses orteils, de longs
poils couvrent son fessier et une étonnante crinière tombe jusqu'au sol. Grâce à son talent de dessinateur, Blake invente
une adaptation picturale de la métamorphose animalière, sur laquelle l'expression du roi déchu relève autant de l'homme
désespéré que du lion apeuré!
14- Certains peintres, les "anciens de Shoreham" un bourg du Kent, sont influencés par Blake. C'est le cas de
Samuel Palmer (1805-1881), peintre considéré comme un représentant majeur du paysage de l'époque romantique
britannique, qui produit des œuvres originales et fantastiques mais aussi de magnifiques paysages.

A douze ans, il peint déjà et, deux ans plus tard, il expose à la Royal Academy des œuvres fortement inspirées par Turner.
Parmi ses aquarelles on peut citer Une étable au toit de mousse (vers 1829), Le Pommier magique, encre
brune et aquarelle, Paysage rocheux au Pays de Galles, une gouache et aquarelle de 1836, Le Colisée et l'Arc
de Constantin du Palatin, à Rome et l'œuvre ici présentée Orage d'été près de Pulborough, une aquarelle de
belle dimension (51 × 72 cm). On peut parler ici de tableau, terme qui n'est pas généralement utilisé pour qualifier une
aquarelle. Mais, comme dans beaucoup des productions de l'école anglaise, on ne retrouve pas dans ce tableau les
caractéristiques classiquement attribuées à l'aquarelle : des couleurs translucides, la réserve de blancs qui aèrent
l'image, une réalisation que l'on sent rapide et instinctive. Ici l'aquarelle rivalise véritablement avec l'huile, tout
en gardant une luminosité et une légèreté propres à l'aquarelle.
Le paysage reste en effet le thème préféré de l'aquarelle anglaise et on peut à cette époque parler de "paysage
romantique", l'image et sa résonance affective, particulièrement illustrées par Constable et Turner, deux personnalités
très différentes. L'une, Constable, n'a jamais quitté sa chère Angleterre, c'est un gentilhomme campagnard aux idées
conservatrices, adepte de l'église anglicane ; l'autre, Turner, est un voyageur insatiable, engagé contre l'esclavagisme.
Ainsi en 1840 il peint Le Négrier une toile qui s'inspire d'un fait odieux : en 1781 un capitaine de vaisseau
avait fait jeter des esclaves à la mer afin de toucher une prime d'assurance. L'œuvre était un manifeste pour l'abolition
universelle de l'esclavage.
Turner fait aussi parfois figure "d'aventurier" : en 1841 il embarque sur un vapeur, l'Ariel, à Harwich, un port sur la
mer du nord en Essex, à l'est de l'Angleterre. Le vaisseau subit une tempête. Ne voulant pas perdre une miette du
spectacle, il se fait ligoter au mât, tel Ulysse affrontant le chant des sirènes. Il relatera bien sûr cette aventure
pour se faire de la publicité. Au fond, le seul point commun entre Turner et Constable, c'est d'avoir tous deux pratiqué
la peinture en plein air et produit de remarquables œuvres.
15- John Constable (1776-1837) assume avant Corot la difficile position de "peintre naturel"
pour qui chaque
motif a sa beauté. Il peint surtout des paysages à l'huile, la vallée de Dedham ou la charrette de foin sont
restés célèbres et furent des œuvres admirées par Géricault et Delacroix. Il n'a produit d'aquarelles qu'à l'occasion
d'un séjour dans la région des lacs du nord de l'Angleterre en 1806 et, après 1830, dans la région de Salisbury. C'est là
qu'il peint les magnifiques aquarelles de Old Sarum et de Stonehenge. Old Sarum est un des premiers sites de
peuplement en Angleterre datant de plusieurs siècles avant J.C. Il s'agit d'une colline fortifiée au voisinage de
Salisbury, au sud de l'Angleterre.

16- Quant à Stonehenge c'est un monument datant de l'âge du fer plus de 1000 ans avant J.C, situé lui-aussi au
voisinage de Salisbury. La puissance émotive de la représentation aquarellée de ce site est
« accentuée par les nuées qui
forment comme un double arc-en-ciel ». Par l'importance que Constable accorde au traitement de la lumière et des nuages,
il fait de belles études de nuages du ciel anglais en 1822, certains considèrent qu'il serait le précurseur de
l'Impressionnisme.

17- Mais Joseph Mallord William Turner* (1775-1851) reste le plus célèbre des aquarellistes anglais,
l'explorateur des propriétés expressives de la lumière et de la couleur. Turner fait ses premières armes à l'école de la
Royal Academy et dans une "académie" créée par un certain Docteur Monro, peintre et collectionneur d'aquarelles. Cette
"académie" fut le berceau d'aquarellistes renommés comme Girtin, Cotman ou De Wint. Surtout connu pour ses aquarelles,
Turner peignit aussi à l'huile ; il semble même que souvent des aquarelles lui servirent d'esquisses comme cela s'était
pratiqué antérieurement.

La vie de Turner : les dons de Turner pour le dessin et la peinture se manifestent dès ses 10 ans alors qu'il
séjourne chez un oncle à Brentford sur les bords de la Tamise. Plus tard, dans le Kent, puis dans le Berkshire, il
poursuit sa production, ce qu'atteste un carnet de croquis de cette époque. Mais il prend très vite contact avec des
professionnels de la peinture : il devient coloriste d'estampes chez un graveur à Covent-Garden ou dessinateur chez un
architecte. A 14 ans il entre à l'école de la Royal Academy et peut présenter des aquarelles à l'exposition d'été de cette
dernière. A partir de 1793 il commence une série de voyages dans le Sussex, le Kent, les Midlands, le Pays de Galles et
l'île de Wight. Dès cette époque il peut proposer plus de 200 œuvres, huiles et aquarelles. C'est alors qu'il rencontre
son premier mécène, le fameux Docteur Monro dont l'"académie" de peinture popularise l'aquarelle. Turner y complète sa
formation dans la représentation de paysages.
18- A 24 ans Turner devient membre associé à la Royal Academy, il fréquente des peintres, on lui passe des
commandes et en 1802 il se rend à Paris, puis en Savoie et en Suisse. Au Louvre, il admire les toiles de Gellée et de
Poussin. C'est maintenant un peintre reconnu, il ouvre une galerie pour exposer ses œuvres et devient membre du conseil
d'administration de la Royal Academy. Ses aquarelles de Venise ou des bords de la Tamise sont particulièrement connues
mais elles n'expriment qu'un aspect de la diversité des talents de Turner. L'aquarelle de Venise San Giorgio
Maggiore vu de la douane est bien dans la ligne des aquarelles telles qu'on les imagine, diaphane, aux teintes peu
saturées. En revanche, La Tamise rivalise avec une huile par la densité de la couleur et le modelé des sujets.

19- En 1832, lors de l'exposition annuelle de la Royal Academy, Turner se trouve confronté à son rival Constable.
Turner, qui présente une marine aux tons assez pâles, découvre, juste à côté de son œuvre, un tableau de Constable
richement coloré : L'Inauguration du pont de Waterloo. Il profite alors des jours de vernissage pour ajouter,
au milieu de sa marine, une petite bouée, d'un rouge vermillon, destinée à attirer tous les regards. Turner était
coutumier du fait : il venait volontiers compléter ses toiles alors qu'elles étaient déjà exposées. Faisait-il de même
avec ses aquarelles ? je ne le sais pas. Toujours est-il qu'il se comportait avant l'heure comme Bonnard qui retouchait
des toiles acquises par des particuliers ou exposées dans des musées, ce qui avait donné l'expression « bonnardiser » qui
signifie retoucher une œuvre après l'avoir terminée.

Pierre Bonnard (1867-1947), peintre illustrateur, graveur et sculpteur, était un esprit indépendant qui
s'était tenu à l'écart du fauvisme, du cubisme et du surréalisme ambiants. Il est un de ceux (avec Sérusier, Denis, Ranson)
qui fondent le mouvement "Nabi", ces initiés qui admirent l'art de Gauguin. Le mouvement visait à retrouver une
spiritualité dans l'art en exaltant les couleurs pourvoyeuses d'émotions. Suite à une exposition à l'Ecole des
beaux-arts où il avait découvert Hokusai et Hiroshige, on le surnommera le "nabi-japonard". La figure représente une des
aquarelles de celui que l'on baptisa "le peintre le plus peintre du demi-siècle".
Le couronnement de la carrière de Turner est sa nomination comme président de la Royal Academy. Mais la charge est lourde
et il se retire de la vie publique en 1846, vivant sous un pseudonyme de Mr Booth ou amiral Booth. L'héritage de Turner
fut géré par l'écrivain John Ruskin. En 1857 celui-ci est stupéfait lorsqu'il prend connaissance d'une série d'œuvres
conservées dans un carton interdit. Il découvre des esquisses de sexes féminins, des images de coïts et de scènes
érotiques. Il aurait décidé de détruire ces images obscènes, ce qu'il ne fit pas complètement car, en 2003, on retrouva
108 dessins accompagnés d'une note de Ruskin : « Gardés uniquement comme preuve d'un esprit égaré ».
20- L'œuvre de Turner. Pendant toute sa vie Turner a fait de nombreux voyages sur le continent, en France où il
visite les villes, découvre les bords de Seine ou de Loire, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, pays dont il
affectionne particulièrement les paysages. Un peu plus tard c'est l'Italie qu'il parcourt. De ces multiples voyages il
rapporte près de vingt mille dessins et aquarelles. De nombreux croquis seront à l'origine de remarquables tableaux. Les
régions frontalières des Alpes sont à l'origine de nombreuses œuvres (dessins au crayon, encres ou aquarelles telle
la source de l'Arveiron. L'Arveyron est le torrent émissaire de la mer de glace et affluent de l'Arve. Il prend
naissance au niveau d'une grotte localisée sur la partie terminale du glacier qui s'appelait glacier des Bois. Ce lieu de
la vallée de Chamonix a été l'objet de nombreux dessins et tableaux. D'Italie, ce sont déjà des aquarelles sur Venise
comme la vue du grand canal avec la Salute de 1818.

21- De ses séjours en Normandie, entre 1821 et 1831, il rapporte des aquarelles dont celles de la
cathédrale de Rouen. Ces dernières seront vraisemblablement connues de Monet et sont certainement à l'origine de la
fameuse série des huiles représentant la façade ouest et le portail à diverses heures de la journée et sous diverses
conditions d'ensoleillement. Ces tableaux "météorologiques" de la cathédrale, des huiles de 1892 à 1894, ont été peints
depuis les appartements de particuliers. Certains, comme la symphonie en gris et rose ou le portail, effet de matin,
sont fortement inspirés de Turner.

22- Vers 1840, Venise sera à nouveau le sujet de splendides aquarelles inondées de lumière, telles les vues du
grand canal. La facture étonnamment variée permet le renouvellement du sujet et rend chaque aquarelle profondément
originale. Cette variété des œuvres de Turner est le reflet de la variété des techniques utilisées : du traitement
classique à des expérimentations risquées comme « laisser les couleurs broyées flottées sur le papier inondé », produisant
sur toute la surface marbrures et dégradés.

23- La variété des œuvres à l'eau de Turner comme les vues de Paris ou celle de Zurich de 1842 ressortent
également d'une variété de traitement, elles reflètent l'habileté de Turner aquarelliste et sa volonté d'expérimentation.
Pour les finitions il pouvait retirer de la couleur pour créer des demi-teintes et par grattage créer des rehauts lumineux.
L'emploi de teintes criardes lui valait parfois des critiques acerbes : « Ce monsieur a choisi de peindre avec de la
crème, du chocolat, des jaunes d'oufs et de la gelée de groseilles ». Dans les dernières œuvres de Turner cette peinture
"expérimentale" va devenir la règle.

24- En effet les œuvres de la maturité (vers 1830, 1840), faites avec une grande économie de moyens, laissent
interrogatif : avec l'aquarelle étude de couleurs pour l'huile L'incendie du Parlement de 1835
(remarquez la différence de taille), on est confronté à des tourbillons de couleurs évanescentes qui déconcertent. Les
huiles de la même époque sont critiquées : un des confrères de Turner écrit : « je ne comprends rien à sa méthode de
peinture, ses compositions sont grandioses mais la facture (l'exécution) abominable, certaines parties du tableau sont
rigoureusement impossibles à déchiffrer ».

25- C'est le cas de l'aquarelle Navire en flammes et plus tard les huiles Vapeur dans une
tempête de neige de 1842 ou Pluie, vapeur, vitesse de 1844 qui ne peuvent séduire que des inconditionnels.
Pluie, vapeur et vitesse s'inscrit dans le contexte de la révolution industrielle du XIXème siècle qui fascinait
Turner. En Angleterre, le chemin de fer, inventé au début du siècle, se développe rapidement à partir de 1840 et devient
un symbole du progrès technique. Turner exprime son intérêt pour ce mode de transport en réalisant plusieurs toiles sur le
thème du chemin de fer.
Pluie vapeur et vitesse, qui est l'une des plus célèbres, représente la ligne de chemin de fer de la Great
Western Railway Company qui reliait Londres à Bristol franchissant un pont sur la Tamise. Turner était d'ailleurs un des
actionnaires de cette compagnie.

26- Mais à propos d'un tableau de 1842 Turner explique : « Je ne l'ai pas peint pour être compris ». La
personnalité de Turner est-elle éclairée par ce propos ? Rien n'est moins sûr bien que des témoignages s'accordent pour
lui attribuer un certain goût pour le mystère et la mystification. Bien que sa vie se déroule à une époque où le
romantisme de Lord Byron ou de Shelley remplace progressivement le néo-classicisme, rien ne l'inscrit dans cette lignée,
ni ses origines sociales, il est fils de commerçants, ni son apparence physique, qualifiée d'ordinaire, ni « sa tournure
d'esprit, mélancolique et sensible, voire taciturne et accompagnée d'un sens de l'économie allant jusqu'à la pingrerie ».
Seules la recherche d'un nouveau mode d'expression et une sensibilité alimentant ses "paysages intérieurs" peuvent le
rattacher au courant romantique.
William Turner n'avait pas un tempérament jovial, loin s'en faut. Personnalité assez rustre, il avait peu d'amis. Il ne
s'est jamais marié, bien qu'on lui ait connu deux longues relations sentimentales avec deux veuves. Il vivait avec son
père qui l'assistait en tout. Il appréciait particulièrement la compagnie des chats et, dépassant son naturel avare, il
ne rechignait pas à nourrir les chats errants londoniens. Rien n'illustre mieux ce personnage que le tableau de Parrot
qui le représente au vernissage, un peu bedonnant et apparemment peu soigné, ou ce portrait de John Thomas Smith : rien
qui laisse augurer un grand peintre romantique à l'huile et un remarquable novateur aquarelliste. Ce personnage un peu
falot, qui laissait indifférent, a néanmoins produit près de 300 huiles, des carnets d'esquisses, des milliers de croquis,
et peut-être 30 000 aquarelles.

Avec une approche nouvelle du paysage, des recherches sur la lumière et le mouvement touchant parfois à l'incertain, avec
des expérimentations préfigurant Pollok, Turner, voyageur infatigable et travailleur acharné, est bien l'un des plus
talentueux représentant de l'aquarelle anglaise.
27- Avec Richard Parkes Bonington (1802-1828) on trouve un aquarelliste particulièrement doué,
malheureusement mort de tuberculose comme beaucoup de jeunes gens de l'époque. Il fait ses premières armes à Calais puis
il fréquente l'atelier de Gros à l'Ecole des beaux-arts de Paris mais se brouille avec celui-ci. Il peint des paysages
normands, le cours pittoresque de la Seine, des séries architecturales (Rouen). Il expose au Salon de Paris et reçoit une
médaille d'or de Charles X. En 1825, il rencontre Delacroix qui considérait que les aquarelles de Bonington étaient « des
espèces de diamants »; les deux peintres se lient d'amitié. En 1826, Bonington qui voyage en Italie fait de lumineuses
aquarelles.

28- Ses œuvres, comme la magnifique aquarelle Près de Honfleur, ont certainement inspiré les
paysagistes romantiques que furent Paul Huet et Eugène Isabey. Comme Palmer et Turner, Bonington a été un des
aquarellistes les plus influents de cette école anglaise. Comme eux, il s'est affranchi des principes de l'« aquarelle
pure » en ayant recours aux rehauts de gouache, aux grattages et au masquage des blancs à la cire. L'aquarelle Près
de Honfleur est pour moi une des plus belles. Le dessin est sans défaut mais on ne le sent pas, l'image, traitée sans
particulière économie de moyens, n'en reste pas moins d'une grande douceur. Les teintes légères et le peu de contraste
donne une atmosphère à la fois lumineuse et infiniment apaisée, évoquant plus un souvenir d'un lointain passé que la
réalité crue d'un bord de mer.

29- Autre aquarelliste de renom, John Sell Cotman (1782-1842), également graveur,
peint les paysages d'Angleterre et du Pays de Galles mais aussi de Normandie. Dans son dessin, il simplifie volontiers
car il perçoit « la nature comme un agencement géométrique de motifs sobres et il rend cet effet en éliminant les détails
par l'emploi de simples lavis de couleurs froides ». Pour certains Cotman procède même à la « déconstruction du paysage
classique en renonçant à l'effet de profondeur et au modelé » rendant des paysages banals monumentaux grâce à une
aquarelle dépourvue d'artifices techniques.

Après la mort de Cotman et celle de Turner, certains considèrent que l'aquarelle anglaise serait devenue un art mineur
ayant perdu son niveau d'excellence antérieur. Pourtant l'aquarelle restera appréciée des classes moyennes. Les
aquarellistes qui s'étaient organisés en académies rassemblant l'élite de la profession, comme The Old Watercolour Society,
fondée dès 1804, tentent de rivaliser avec les peintres à l'huile ; ils donnent à leurs tableaux des dimensions plus
importantes, diversifient les sujets et multiplient les expositions.
30- L'aquarelle en France jusqu'à l'impressionnisme.
En France, l'aquarelle s'est développée bien plus tard qu'en Angleterre même si à la fin du XVIIIème siècle quelques
peintres, produisant surtout des huiles, ont donné de belles aquarelles.
31- Ainsi Hubert Robert (1733-1808) et ses jeunes filles peignant dans les ruines et
Jean-Pierre Houël (1735-1813), peintre et graveur, qui s'enthousiasme pour les monuments de l'antiquité.
De deux voyages en Italie et aux îles de Malte et de Lipari, il rapporte de nombreuses gouaches et aquarelles.

Au cours du XIXème siècle, les relations entre la France et l'Angleterre se développent avec des peintres
Comme Bonington et Delacroix (1798-1863) mais aussi par l'envoi d'aquarelles aux expositions à Paris. Au Salon de 1824,
à Paris, sont exposées les œuvres d'artistes comme Constable, Copley, Fielding et Bonington, elles participent à
l'expansion de l'aquarelle et du romantisme en France. En 1855, 114 aquarelles anglaises sont envoyées pour l'Exposition
Universelle, elles connaissent un succès considérable. Certains peuvent alors affirmer que « l'aquarelle est parvenue à
un tel degré de perfection que maintenant elle est devenue la rivale de la peinture à l'huile ». L'aquarelle prend son
essor, non seulement en France mais dans toute l'Europe. On publie des traités d'aquarelle et, en 1863, Charles Baudelaire,
dont la compétence comme critique d'art n'est pas contestable, publie dans le Figaro un éloge de l'œuvre d'un
aquarelliste qu'il qualifie de « Peintre de la vie moderne ».
32- L'expédition de Bonaparte en Egypte et, plus tard, la conquête de l'Algérie avait attiré l'attention des
peintres sur l'orient et certains choisirent de se rendre sur place pour peindre la vie et les paysages. La vie des
harems des sultans orientaux et les parades des cavaliers arabes retiennent leur attention. C'est ainsi que
Eugène Delacroix (1798-1863), inspiré par le peintre du cheval et portraitiste des fous
Théodore Géricault (1791-1824), et, après s'être initié auprès du photographe Charles Soulier et de
Bonington, fait de belles aquarelles de fantasias lors de son voyage en Afrique du nord en 1832. En 1834, Delacroix
rencontre George Sand (1804-1876) chez l'éditeur Buloz qui avait commandé à l'artiste un portrait de l'écrivaine pour le
frontispice du roman Lélia. Une amitié s'ébauche entre le peintre et George Sand encore affectée par sa rupture avec
Alfred de Musset. Plus tard elle dira à Delacroix : « Je serais folle de vous si je ne l'étais d'un autre. » Cet « autre »,
c'était Frédéric Chopin. Eugène Delacroix sera l'un des premiers témoins discrets de la liaison de Sand et du musicien.

33- La vie des harems ne laissera pas indifférent le roi de la ligne, Jean-Auguste-Dominique Ingres
(1780-1867) qui, sur ses vieux jours, propose l'Odalisque (1864), une fraîche aquarelle qui reprend le
thème du Bain turc, une œuvre terminée l'année précédente. Mais c'est Théodore Chasseriau (1819-1856),
un élève d'Ingres, qui, inspiré par Delacroix, invité par le Calife de Constantine en 1846, va illustrer,
surtout par des huiles, des combats de cavaliers et dévoiler la vie des femmes orientales, n'hésitant pas à les
représenter parfois dans des situations érotiques.
A la suite de Delacroix et de Chassériau, des peintres comme Gustave Doré (1832-1883), l'illustrateur de nombreux ouvrages
(des œuvres de Rabelais aux Travailleurs de la mer d'Hugo), Henri Harpignies (1819-1916), aquarelliste
de l'Ecole de Barbizon et Isabey (1803-1886), aquarelliste comme son père, miniaturiste de renom sous Napoléon 1er, se
retrouvent en 1879 dans une société des aquarellistes.

34- D'autres pratiqueront aussi l'aquarelle comme Gustave Moreau (1826-1898), un
romantique attardé, précurseur du symbolisme, adepte des sujets mythologiques. Parfois injustement classé comme "peintre
pompier", il produit bon nombre d'aquarelles dont certaines monumentales.

35- Avec Impression Soleil levant (1872) une huile-toile de Claude Monet (1840-1926)
et le courant impressionniste, la peinture se fait nonchalante et s'écarte des règles habituelles de cet art. Le peintre
saisit et représente un instant de sa perception du sujet. Les thèmes historique ou religieux laissent la place à la vie
quotidienne, l'atelier au plein-air et à la vibration de la lumière.
Claude Monet a résidé plus de quarante ans à Giverny. C'est là qu'il aura réalisé les 250 toiles qui composent la très
connue série des Nymphéas. Les nénuphars qui ont inspiré l'œuvre sont ceux d'un bassin qu'il a fait creuser en 1893. Sa
maison de Giverny est connue encore aujourd'hui pour ses parterres de fleurs et son pont japonais peint en vert. Grand
travailleur, Monet était souvent en proie à la colère ou au découragement. Son ami Georges Clemenceau le qualifiait
d'ailleurs de « vieux hérisson sinistre ».

Les précurseurs de l'impressionnisme sont les peintres de l'Ecole de Barbizon, Corot, Daubigny, Millet et
Théodore Rousseau (1812-1867), l'ermite amoureux de la forêt de Fontainebleau, dont on peut admirer ici
une célèbre aquarelle qui ne reflète toutefois pas la facture habituelle de ce peintre.
36- Parmi les précurseurs on trouve aussi Eugène Boudin (1824-1898) qui enseigna
Monet. Les belles aquarelles des scènes de plage de Boudin sont, comme ses huiles, des documents illustrant les habitudes
estivales de la société bourgeoise du second empire. D'une aquarelle transparente, rehaussée de quelques traits de crayon,
il présente des scènes d'une belle luminosité.
Dans les années 1861-65, Boudin, Daubigny et Monet séjournent sur la côte normande, ils y côtoient
Johan-Barthold Jongkind (1819-1891). Ce dernier, aquarelliste talentueux et graveur, produisait, selon
Signac, les « plus belles aquarelles qui soient au monde ». Elles nous montrent les bords de l'Escaut, Honfleur, Anvers,
Rotterdam ou les environs de Paris. Il influence Monet qui d'ailleurs le reconnaît. Également précurseur de
l'impressionnisme, sa touche nerveuse fait qualifier sa peinture de négligée. Suivant cet exemple, après la rencontre
avec Jongkind, il semble que le dessin de Boudin soit devenu plus impulsif et sa couleur plus vive.

37- De cette époque on ne peut oublier les délicates aquarelles qu' Edouard Manet (1832-1883)
joint aux billets qu'il écrit à de charmantes correspondantes. Selon des témoignages, Manet était un très
grand amateur de la gent féminine ; il aurait multiplié les conquêtes, ce qui ne lui portera pas chance puisqu'il décédera
des suites d'une syphilis en 1883. On citera aussi Berthe Morisot (1841-1895), élève de
Corot et disciple de Manet puis de Monet et de Renoir, dont l'œuvre est consacrée à son entourage féminin.

39- De Cézanne plus de 600 aquarelles subsistent. certaines furent exposées à la Galerie Berheim-jeune
en 1907 avant une rétrospective au salon d'automne qui sera consacrée surtout aux huiles. Elles sont ensuite présentées,
entre 1907 et 1914, à Berlin, à New-York, à Londres. Elles suivent l'évolution des conceptions du peintre aux diverses
étapes de sa vie. Progressivement il ramène les objets à des formes géométriques et conseille de « traiter la nature par
le cylindre, la sphère et le cône ». Ses paysages sont découpés en plans successifs, la confrontation de couleurs
différentes et la superposition de couches colorées remplacent les ombres et le modelé. Les aquarelles de paysages et de
natures mortes illustrent bien cette évolution : que de différences entre la Vue de Gardanne de 1886 et La
montagne Sainte-Victoire de 1904, montagne qui devient son thème favori et dont il réalise de 1901 à 1906 une
vingtaine d'aquarelles. En faisant la synthèse de la forme et de la couleur, « quand la couleur est à sa richesse, la
forme est à sa plénitude » dit-il, en épurant les formes, en les géométrisant, Cézanne, dont on admet qu'il domine la
peinture moderne, prépare la naissance du cubisme et les tendances du début du XXème siècle.
La personnalité de Cézanne a probablement joué un rôle important dans le développement de son œuvre et sa marche vers la
notoriété. Artiste révolutionnaire mais citoyen rétrograde, pétri de contradictions, Cézanne n'était pas un modèle de
modestie : « Il n'y a qu'un seul peintre vivant, c'est moi... Un Cézanne il n'y en a qu'un tous les deux siècles. » ; il
le prouve en affirmant « Gauguin n'était pas peintre, il n'a fait que des images chinoises ». Il avait probablement
grande confiance en son génie ce qui lui a permis de résister aux railleries que provoquait la présentation de ses
tableaux. La première période de son œuvre a en effet un parfum de scandale, les critiques étaient acerbes, les jugements
assassins. En 1904, un critique écrit encore : « le nom de Cézanne restera attaché à la plus mémorable plaisanterie d'art
de ces quinze dernières années ». Pourtant, avec le temps, l'image s'est inversée : l'œuvre de Cézanne serait non
seulement « une pensée en acte, l'une des plus féconde de la culture universelle mais aussi une création des plus
admirables qui soient ».

Quant à ses aquarelles « elles frappent par leur liberté, leur légèreté, leur manière pleine d'abréviations.elles frappent
aussi par l'éblouissante dextérité dont l'artiste témoigne. Vers la fin de sa vie Cézanne manifestera plus d'aisance dans
ses huiles et c'est probablement à ses travaux d'aquarelliste qu'il le doit ». De telles proclamations ne peuvent que
rendre interrogatif : est-on en présence d'un exceptionnel génie ? d'une peinture typiquement intellectuelle dont le sens
nous échappe un peu ? doit-on tenir pour vrai tout que l'on écrit sur l'influence de son esthétique ? Si je contemple son
aquarelle Rocher au château noir, dont la facture n'est pas sans rappeler l'étang de Dürer, je me dis que ce
jour-là cette œuvres n'a pas dû donner une méningite à l'intellectuel Cézanne ! Mais surtout ne retenez pas ces propos
iconoclastes !
40- Les peintres du début du XXème siècle ne sont pas des aquarellistes. Braque, Picasso et les
cubistes mais aussi Dali, Miro, Matisse, Léger, Delaunay ou le fauviste de Vlaminck n'ont que rarement eu recours à
l'aquarelle. Lorsqu'ils la pratiquaient c'était souvent pour réaliser des esquisses de leurs œuvres à l'huile, peut-être
aussi pour se reposer un temps de l'irritante odeur des solvants. Ainsi Picasso (1881-1973)
peint à l'aquarelle cinq femmes, des baigneuses parmi les arbres. Cette aquarelle est aussi détestable que les
demoiselles d'Avignon qui la précède. L'aquarelle gouachée un jeune acrobate et un enfant est une ébauche,
parmi d'autres, pour la série les Saltimbanques (1904-1906) destinée à illustrer le monde du cirque et du spectacle.

41- Voici maintenant quelques œuvres de ce début de XXéme siècle. Maurice de Vlaminck
(1876-1958), oubliant un instant son "fauvisme", propose Une église sous la neige. L'espagnol
Juan Gris (1887- 1927) s'installe à Paris dès 1906, il devient l'ami de Matisse, de Braque et
de Léger. Vers 1913, il séjourne à Céret, petite localité des Pyrénées orientales qui avait acquis la réputation d'être
la "Mecque du cubisme". Son aquarelle Trois lampes préfigure sa conversion au cubisme.
L'italien Umberto Boccioni (1882-1916), peintre et sculpteur, l'une des principales figures
du mouvement futuriste, contribue à façonner une esthétique révolutionnaire. Il procède par interpénétration de plans
colorés. Son aquarelle nous évoquerait plutôt un exercice de plis pour apprenti dessinateur. Quant à Robert
Delaunay (1885-1941), par son Hommage à Blériot, il honore le fabriquant de lanternes pour
automobiles devenu pionnier de l'aviation. Après avoir construit plusieurs prototypes qui avaient une fâcheuse tendance à
s'écraser, ce qui lui avait valu le sobriquet de "Roi des pâquerettes", Blériot réussit le premier traversée de la Manche
en 1909.

42- L'allemand August Macke (1887-1914) est un peintre expressionniste qui séjourne
fréquemment à Paris. Macke, Delaunay et Kandinsky font partie des "Blaue reiter" un groupe d'artistes qui publie
"l'almanach du cavalier bleu" et exposent leurs œuvres à Munich avant la guerre de 1914. Au printemps 1914,
l'aquarelliste suisse Louis Moillet, Macke et Paul Klee (1879-1940), peintre allemand et
pédagogue, se rendent à Tunis. Klee enregistre dans son journal les sensations, les spectacles, les odeurs et note les
étapes de ce bref voyage. Après des aquarelles sur le golfe de Tunis, les voyageurs visitent Hammamet puis la fabuleuse
Kairouan dont Klee dit que là s'accomplit « le mariage arabe de l'esprit et des sens, l'union avec la couleur ». En effet,
les deux aquarelles de Tunisie ne manquent pas de couleurs, l'une est encore figurative, l'autre élaborerait « une syntaxe
nouvelle en cristallisant les suggestions chromatiques issues de Cézanne et Delaunay ». Macke découvre Kairouan avant de
disparaître quelques mois plus tard, tué au combat sur la Marne au tout début de la guerre de 1914-1918.

43- Vassily Kandinsky (1866-1944), né moscovite, est naturalisé allemand puis français en
1939 ; il finit sa vie voisin de Puteaux. Avant de développer son œuvre abstraite il propose des toiles très classiques
(Rue de Murnau..), redécouvertes depuis les années 1960. Mais sa percée non figurative, qu'exprime Du
spirituel dans l'art, s'opère au travers de l'aquarelle avec une première œuvre purement abstraite de 1910, mais
probablement antidatée (1913 ?).

Kandinsky est l'artiste expressionniste le plus important du "Cavalier bleu" et le seul dont les textes et les écrits ont
transcendé sa propre œuvre pour influencer l'ensemble de l'art moderne. Par un long processus d'apprentissage, il a
réussi à dépasser le langage formel de l'expressionnisme et à atteindre une configuration picturale libre, non soumise à
un modèle naturel. Il est à l'origine d'un langage nouveau qui exprime sa « nature intérieure » et qui fait appel à la
musicalité (il utilise parfois des termes musicaux pour désigner ses œuvres). Kandinsky fut un artiste international,
ayant vécu longtemps à Paris et voyagé dans toute l'Europe, dont l'œuvre marque un tournant décisif dans la naissance de
l'abstraction en peinture.
44- Bien qu'art mineur l'aquarelle en séduit certains. Albert Marquet (1875-1947),
fauve "modéré" ou impressionniste tardif, est un élève de Gustave Moreau. Après avoir peint avec les "fauves"
mais avec des couleurs moins crues que les autres, il se consacre à une peinture de style naturaliste, en particulier pour
des paysages, la Seine, ses quais, des ports, Honfleur ou Hambourg. A partir de 1907, il découvre l'Algérie et la Tunisie
et peint la mer, des bateaux, des villes. L'aquarelle Lagouat de 1948 en est un exemple. Admirable dessinateur au
pinceau, il évoque la peinture japonaise : de lui Matisse disait « Il est notre Hokusai ».

Dunoyer de Ségonzac (1884-1974) est issu d'une famille aristocratique du Quercy. Peintre,
il a toujours refusé de participer aux grands mouvements esthétiques du début du siècle. Il restera un réaliste à la
palette réduite mais à la peinture saine et robuste. On dit que ses aquarelles, comme Feucherolles en automne
et ses gravures ont plus d'élégance que ses tableaux. Illustrateur, il a en particulier illustré les Croix de bois,
le livre de Dorgelès un peu oublié mais dont on ne peut faire l'économie si on veut connaître la vie des poilus de
la première guerre mondiale.
Georges Rouault (1871-1958), né dans une cave lors de la Commune, fut un des disciples
préférés de Gustave Moreau. Un moment attiré par le fauvisme il participe au Salon d'automne.de 1905. Il fait
successivement connaissance avec Huysmans, Léon Bloy et le philosophe catholique Maritain qui lui font découvrir le sens
religieux de la création. Jusqu'en 1918, il peint à l'aquarelle, avec rehauts de gouache ou de pastel, prostituées, filles
de cabaret, juges et clowns, toute une humanité expiant le péché originel. Dans Tabarin le dessin est plein
d'énergie, presque sexuellement provoquant, mais en même temps d'une facture pâteuse qui peut déplaire.
A la veille de la guerre de 1940, Raoul Dufy (1877-1953) peint des aquarelles des châteaux de la Loire et de Venise. Il
travaille également à de très grands panneaux pour le palais de Chaillot. Avec les non-figuratifs Maurice Estève
(1904-2001) et Jean Bazaine (1904-2001), il participera au renouvellement de la technique de l'aquarelle.
45- L'aquarelle européenne au XIXème siècle et le début du XXème siècle en Europe centrale.
46- Caspar David Friedrich (1774-1840) est le peintre romantique allemand le plus grand et le
plus mystérieux connu. Issu de l'Académie des beaux-arts de Copenhague, il s'installe à Dresde et fréquente un cercle de
peintres et d'écrivains comme Novalis. En 1805 il expose ses aquarelles à Weimar où Goethe les remarque. Ses œuvres ont
révolutionné le genre traditionnel de la peinture de paysage. Friedrich a participé à la révolution romantique toute
imprégnée de la tradition nordique et, en rupture avec la peinture de paysage néoclassique, il a introduit dans ses œuvres
la conscience de la fragilité de l'homme devant la puissance mystérieuse de la nature. Ses deux tableaux les plus connus
Le Voyageur contemplant une mer de nuages et La Mer de glace sont des huiles/toile mais ses dessins au lavis de
sépia et de belles aquarelles comme les Ruines de l'abbaye d'Eldena en Poméranie (1820) montrent la diversité de
son œuvre.

Rudolf von Alt (1812-1905) est certainement le plus représentatif des aquarellistes de
l'époque en Europe centrale. Elève de l'Académie des beaux-arts de Vienne, il tient l'amour du paysage de voyages avec son
père dans les alpes autrichiennes et en Italie du nord. Plus tard, il voyage et travaille à Rome et Naples. Succombant à
la "Tivoli-mania" il réalise des aquarelles des grottes de Tivoli (1835). Par la suite, il visite la Lombardie, la Bohême,
la Dalmatie et la Bavière avant de retourner à maintes reprises en Italie. En 1863, il se rend en Crimée pour y peindre
des vues d'un domaine de l'impératrice, et en 1867 il visite la Sicile. Au cours de ses voyages Rudolf von Alt n'a guère
quitté les provinces de la Monarchie austro-hongroise dont il a peint près de 5000 aquarelles. Il réalisait cependant des
peintures à l'huile dans son atelier, pendant les mois d'hiver. Certains de ses sujets sont des objets de la vie
quotidienne et des peintures d'intérieurs qui avaient attiré l'attention du public viennois. Après un voyage à Venise, il
développe des perspectives architecturales comme les Ruines du palais de Dioclétien ; ce palais était la
résidence fortifiée de l'empereur Dioclétien après son abdication volontaire en 305. C'est l'un des édifices de l
'Antiquité tardive les mieux conservés. Ses vestiges sont préservés dans le cœur historique de Split, sur la côte
Dalmate, en Croatie.
47- Avec Albert Nikolaïevitch Benois (1852-1936) on découvre un des grands aquarellistes russes.
Il appartient à une famille qui a donné de nombreux artistes talentueux pendant plusieurs générations. Le compositeur,
pianiste et chef d'orchestre Nicolas Tcherepnine (1873-1945) ainsi que Peter Ustinov (1921-2004) étaient apparentés à
cette famille. En 1880 Benois est un des fondateurs du cercle des aquarellistes puis li est nommé professeur d'aquarelle
à l'Académie impériale. A partir de 1924 il vient à Paris et sera élu membre de l'Académie des beaux-arts. Il décède à
l'Haÿs-les-Roses et est enterré au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Constantin Oukhtomski (1818-1881), peintre et architecte russe, est aussi aquarelliste et
maître de la peinture d'intérieurs. Une cinquantaine de ses œuvres sont conservées dans les collections du Musée de
l'Ermitage.
48- Piotr Fiodorovitch Sokolov, connu aussi sous le nom de Pierre Sokolov (1791-1848),
est un peintre de l'école romantique russe. Il fut l'un des aquarellistes et portraitistes les plus
réputés de la haute société de l'époque de Pouchkine et de Nicolas Ier, le tsar qui fut à l'origine de l'apparence et de
la disposition actuelles du Palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. C'est lorsqu'il donne des leçons de dessin que Sokolov
commence à produire des portraits à l'aquarelle dans des décors d'intérieur dits "portraits de chambre". Il abandonne
alors l'huile et se consacre entièrement à l'aquarelle de portraits de personnages de la haute société de
Saint-Pétersbourg.

En Allemagne et en Europe centrale, en particulier dans l'Empire austro-hongrois moribond, rongé par le problème des
nationalités, les mouvements plastiques prospèrent, nourris par les écrits de Freud ou ceux de Kafka. Contrairement à la
France avec sa transition impressionniste, en Europe centrale on passe directement de l'académisme à la peinture moderne
éprise de liberté.
49- L'un des principaux représentant de l'Art nouveau viennois est Gustav Klimt
(1882-1918), peintre baptisé symboliste. Fils d'un ciseleur sur métaux précieux, il acquiert une sérieuse
maîtrise technique dans la décoration à l'Ecole des arts appliqués, ce qui se sentira dans toute son œuvre. En 1897 un
groupe de peintres et sculpteurs qui ne supportaient plus l'influence conservatrice du goût officiel forment le "mouvement
Sécession" (1897) dont Klimt devient un des porte-parole. En accord avec ce mouvement, Klimt exprime sur la toile un
message de révolte contre la susceptibilité oppressive des moralistes. Vers 1900 Klimt réalise un projet de fresques pour
la nouvelle Université de Vienne. Les toiles préparatoires sont sévèrement critiquées, jugées pornographiques.
Les années suivantes constituent un tournant dans l'œuvre de Klimt : il entame la réalisation du Cycle d'or ou
« période dorée », avec les œuvres si connues Serpents d'eau, le Portrait d'Adèle Bloch-Bauer et Danaé. Il s'agit
surtout d'une période où Klimt explore le thème de l'érotisme, peignant des couples faisant l'amour ou des femmes se
masturbant. On crie à la pornographie mais les œuvres ne sont pas interdites. C'est l'époque où Freud (1856-1939), nourri
par les études de Charcot et les connaissances sur l'hypnose, développe sa théorie révolutionnaire psychanalytique qui
montre toute l'importance de la sexualité. A la fin de sa carrière, Klimt exécute des commandes pour une riche clientèle
viennoise, ce sont de grands tableaux de femmes parées d'ornements extravagants, voire de femmes nues aux poses
langoureuses.

Plus tard il réalise des paysages, véritables murailles végétales, d'une facture pointilliste. Dans la production de Klimt
les aquarelles sont des œuvres picturales uniques qui, comme ses huiles, comportent une surabondance de couleurs et des
motifs vifs et audacieux.
Avec Oskar Kokoschka (1886-1980), un peintre et écrivain autrichien, un temps élève de Klimt
et adepte de l'art oriental, on trouve un esprit rebelle et non conformiste au talent créatif mais insatisfait. Amant
d'Alma Mahler, veuve du célèbre compositeur aux neuf symphonies, il fait fabriquer une poupée de Mahler grandeur nature
qu'il peinturlure et repeinturlure avant de la détruire. Plus tard, vers 1934, le régime national-socialiste qualifie son
art de dégénéré et détruit certaines de ses œuvres. Il serait le créateur du portrait psychologique, s'efforçant de
révéler la vie intérieure de son modèle.
50- Que dire d'Egon Schiele (1890-1918), peintre autrichien fortement
influencé par Klimt. Pendant sa courte vie il accumule des tableaux de corps dénudés, tracés d'une main fébrile et
soulignés de couleurs crues. Tout au long de sa carrière, il réalisa des portraits à l'huile ou à l'aquarelle souvent
gouachée (Edith Schiele assise, 1915, gouache) mais aussi des ensembles floraux et des paysages souvent
mélancoliques. Une grande partie de son œuvre est consacrée à la représentation de nus.
Vers 1910 il s'intéresse particulièrement aux enfants des rues des quartiers pauvres de Vienne et produit une série de
portraits. Il peint particulièrement des jeunes filles, nues ou demi-nues, fillettes souvent maigres et encore impubères.
Pour Schiele il ne s'agissait pas seulement d'une production lucrative mais bien d'une recherche esthétique. Toutefois,
dans une société catholique bien-pensante, Schiele est accusé de détournement d'enfants et condamné à de la prison
préventive.
Il faut dire qu'une partie non négligeable de son œuvres est franchement pornographique et obscène, ce qu'illustrent des
gouaches ou des aquarelles mettant en lumière la masturbation qui était à l'époque considérée comme une maladie bannie
par la médecine. Vers la fin de la guerre de 1914, Schiele est quand même reconnu comme un grand peintre, successeur de
Klimt, mais ce succès est de courte durée car, comme sa femme, il est emporté par l'épidémie de grippe espagnole de 1918.

52- Après le choc de la première guerre mondiale naît le surréalisme qui est moins une aventure de la
forme comme le cubisme qu'une révolution de la pensée qui explore les sources de l'inconscient. Certains, comme le
Barcelonais Joan Mirô (1893-1983), le plus surréaliste des surréalistes selon André Breton,
ou Chagall, utilisent volontiers la gouache alors que d'autres combinent le collage et l'aquarelle. C'est le cas de
Francis Picabia (1879-1953), sorte de rastaquouère mondain et fortuné qui débute dans
l'impressionnisme avec de belles toiles des bords du Loing ou de l'Yonne, invente le futurisme et rejoint le courant
surréaliste et les autres figures de ce mouvement comme Max Ernst (1891-1976), membre des Blahau reiter, ou
André Masson (1896-1987), l'auteur de dessins automatiques et de tableaux de sable.
On ne peut oublier Salvador Dali (1904-1969), peintre éclectique particulièrement doué qui
nourrissait sa publicité avec une intelligence et une ingéniosité toujours fort réjouissante telles les outrances de sa
méthode paranoïa critique (pour Dali et sa méthode l'Angélus de Millet est beau « comme la rencontre fortuite
sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie » ; telles aussi ses proclamations narcissiques et
délirantes :« Plus fort que les cyclotrons et les ordinateurs cybernétiques, je peux en un instant pénétrer les secrets
du réel ..à moi l'extase...à moi sainte Thérèse d'Avila ! Moi, Dali, réactualisant le mysticisme espagnol, je vais
prouver par mon œuvre l'unité de l'univers en montrant la spiritualité de toute substance ». Que de tels excès aient pu
lui permettre d'acquérir une célébrité que ses toiles seules auraient suffi à justifier laissent rêveur.

53- L'aquarelle aux Etats-Unis.
Pendant la première moitié du XXème siècle, la France et l'Europe occidentale sont des creusets pour l'art nouveau, même
si beaucoup d'artistes s'expatrient volontiers aux Etats-Unis, soit par décision délibérée comme Dali, Marcel Duchamp ou
Chagall, soit pour fuir les persécutions racistes et politiques, particulièrement en Allemagne. La situation s'inverse
après la seconde guerre mondiale, c'est New-York qui supplante Paris.
54- Aux Etats-Unis l'aquarelle avait une longue histoire qui débute avec Winslow Homer
(1836-1910). Sa mère, aquarelliste, est son premier professeur. Illustrateur, il couvre la guerre de
sécession. En 1881, d'un séjour en Angleterre il rapporte des aquarelles. Le post-impressionniste Maurice
Prendergast (1858-1924), membre vers 1908 du groupe Ashcan (boite à ordures), donne de belles aquarelles.
James Abbott McNeill Whistler (1834-1903), Mary Cassat, John Singer Sargent
(1856-1925), le plus européen des peintres américains, amoureux de Venise comme Turner, complètent cette
petite liste. Dès 1866, aux Etats-Unis, avait été créée une association des aquarellistes.

55- Depuis on peut citer Edward Hopper (1882-1967) , Roxland Hilder, John
Pike, David Millard et les non figuratifs, Georgia O'Keffe, Sam Francis ou john Marin (1870-1953) ,
un spécialiste de l'aquarelle attiré par le mouvement plastique français dont on voit ici le pont de
Brooklyn de 1912.
Aux Etats-Unis, si certains restent fidèles à l'aquarelle comme O'keffe ou Hopper, d'autres l'ignorent du fait de la
taille gigantesque de leurs œuvres. Avec le courant expressionniste abstrait ou Action painting, on assiste à une
floraison de talents, à une grande diversité des œuvres, à l'adjonction fréquente de commentaires soi-disant destinés à
éclairer le spectateur. Tout cela crée une inflation rendant difficile un jugement de valeur.

De ce courant expressionniste émerge le canadien jean Paul Riopelle (1923-2002). Riopelle a
passé plusieurs années à perfectionner la technique du all-over, qui consiste à éliminer toute forme de perspective dans
le tableau au moyen d'éclats de peinture en couches multiples, technique picturale emblématique de l'artiste américain
Jackson Pollock (1912-1956). Pollock était un peintre iconoclaste et alcoolique, considéré
comme le père de l'expressionnisme. Il a apporté une spontanéité nouvelle au geste artistique, influençant grandement
l'école de peinture américaine. Le mouvement expressionniste n'avait aucune unité stylistique autre que d'étaler de la
couleur sur une toile. Pollock le faisait en provoquant des écoulements, des éclaboussures de peinture selon une sorte
de rituel religieux, proche d'une activité automatique. Turner ne procédait pas autrement lorsqu'il laissait tomber la
couleur sur la feuille encore humide produisant ainsi marbrures et dégradés.
C'est à la suite de sa participation à une exposition, en 1943, que l'obtention d'un contrat avec la collectionneuse
Peggy Guggenheim et le soutien d'un célèbre critique le propulsent sur la scène artistique new-yorkaise. En 1949, le
magazine Life publie un article sous le gros-titre suivant : Jackson Pollock est-il le plus grand peintre vivant des
États-Unis ? C'est la gloire !

56- On admet depuis que les œuvres de Pollock, d'abord scrutées par les critiques, puis tenues
en haute estime, ont apporté une contribution inestimable à l'art et qu'elles ont influencé des générations d'artistes
après sa mort. Au marché de l'art les œuvres de Pollock se portent bien, ses aquarelles oscillent de quelques centaines
à 2 ou 3 millions d'Euros, ses huiles crèvent le plafond de 45 millions d'Euros et une peinture murale, que lui avait
commandée en 1943 Peggy Guggenheim pour sa maison de Manhattan, est estimée à 140 millions de dollars.
Parmi les nombreux autres abstraits américains appartenant au mouvement expressionnisme abstrait, on peut citer
Franz Kline (1910-1962) aux œuvres en noir et blanc, Mark Rothko (1903-1970), Clyford Still (1904-1980) qui peignait à
l'aquarelle et à la gouache. Leurs œuvres n'avaient aucune homogénéité de style mais leur production était massive et
riche d'expérimentation.
57- Conclusion
Au cours de ce panorama nous avons brièvement retracé une histoire de l'aquarelle, elle est apparue comme parfaitement
superposable à l'histoire de la peinture à l'huile. Les noms des aquarellistes que nous avons rencontrés sont ceux de la
plupart des grands peintres que vous connaissez. Certains ont été oubliés comme Van Gogh, Toulouse Lautrec, Daumier et
bien d'autres qui ont aussi produit des œuvres à l'aquarelle. Les grands mouvements de la peinture, romantisme,
impressionnisme, cubisme, art abstrait ont trouvé eux-mêmes leur expression dans des aquarelles souvent bien loin de
l'esquisse préparatoire. Ce n'est donc pas par leur rareté que les aquarelles seraient des œuvres mineures. Vous avez pu
constater, tout particulièrement dans les œuvres de l'école anglaise, que les aquarelles pouvaient être des tableaux
aussi travaillés que des huiles et, si ce n'était leur taille plus réduite, elles rivaliseraient avec les toiles des
grands maîtres. Ce n'est donc pas par leur médiocrité technique que les aquarelles seraient des œuvres mineures.
La plupart des peintres reconnus ont donc tous, à un moment ou à un autre, produit des aquarelles et des gouaches,
parfois dans le même style que leurs huiles, parfois dans des styles différents. Certaines de ces aquarelles ont même
été vendues à des prix considérables (une aquarelle de Cézanne est adjugée 25 millions de dollars lors d'une vente aux
enchères). Chemin faisant, nous avons aussi rencontré des peintres presque essentiellement aquarellistes : les Sokolov,
les Benois, les Prendergast ; ils sont souvent peu connus mais leurs aquarelles sont admirables et rivalisent
esthétiquement avec bien des huiles. Rappelons aussi que l'aquarelle est une forme d'expression largement utilisée en
Extrême-Orient où les maîtres chinois et japonais ont peint de magnifiques paysages et motifs floraux. Ce n'est donc pas
par leur médiocrité esthétique que les aquarelles seraient des œuvres mineures.
On reproche parfois aux aquarelles leur petite taille et leur fragilité dans le temps. Or certaines, comme le Phaéton que
nous avons vu, rivalisent par leurs dimensions avec des huiles. En outre les pigments actuels sont plus résistants à la
lumière ce qui rend les œuvres plus pérennes. Rien dans tout cela qui fasse des aquarelles des œuvres mineures.
En revanche l'aquarelle est desservie par l'image qui est généralement véhiculée : elle serait une activité de loisir,
accessible à tous, historiquement réservée aux jeunes filles de bonne famille : une sorte de passe-temps chic ne
produisant que des œuvresttes dépourvues de contenu artistique et peu prisées par les professionnels. Elle est aussi
desservie par les cours d'aquarelle que vante la publicité, cours dans lesquels on insiste exagérément sur la technique
et ses astuces qui permettent de réaliser la belle aquarelle conforme à l'idée généralement admise : peinture légère et
translucide, favorisant l'immédiateté et l'incertain. Voilà ce qui ne laisse guère de place à l'acte créateur et à la
personnalisation de la technique qui font pourtant de cette peinture à l'eau un véritable moyen d'expression.
Par son histoire, par ses productions, par sa technique même aux si nombreuses variantes, l'aquarelle n'aurait donc rien
d'un art mineur. Et d'ailleurs, depuis les révolutions picturales du début du XXème siècle, la distinction entre art
majeur et art mineur est devenue totalement floue, entraînant un déplacement des critères d'appréciation et leur
réduction à une seule question : est-ce de l'art ou non ?
En peinture, une œuvre artistique présente une dimension esthétique, elle provoque une émotion, un ressenti admiratif ou
répulsif mais jamais l'indifférence. De plus elle véhicule une pensée créatrice ; elle n'est ni une photographie, ni une
reproduction exacte du sujet bien qu'elle suppose un sujet, fut-il une image intérieure comme chez Kandinsky, voire le
produit d'une gestuelle impulsive et originale. Car, comme le disait Goethe « Qu'y a-t-il de plus important que le sujet
? ». En effet le sujet est majeur car il suscite une curiosité, un besoin d'intégrer les formes et les couleurs perçues
pour en faire une traduction personnelle. En ce sens, l'œuvres d'art est un langage, elle porte un message qui ne demande
qu'à être apprécié des specateurs. Et l'aquarelle peut porter ce message aussi bien qu'unne huile ou tout autre moyen
d'expression.
Alors pourquoi l'aquarelle serait-elle injustement considérée comme un art mineur ou dévalué ? Mais comme dans le domaine
artistique goûts et couleurs ne sont finalement qu'appréciation personnelle, j'espère que la petite incursion dans le
monde de l'aquarelle vous a permis de vous faire une opinion. Art majeur ou art mineur, l'aquarelle ? A vous de répondre !
Je vous remercie de votre attention.
J.R 5/2025